20/09/2014
Réformes de l'orthographe : chapitre VII Elle s'est laissé séduire
La réforme de 1990 n’aborde l’accord, fameux, du participe passé que par le cas particulier du verbe laisser : « laissé » est rendu invariable quand il est suivi d’un infinitif, de façon identique à « fait », qui est toujours invariable, que ce soit avec l’auxiliaire « avoir », même quand l’objet est placé avant le verbe, ou en emploi pronominal. La raison en est que laisser, comme faire, joue ici un rôle d’auxiliaire.
On écrira donc :
Elle s’est laissé séduire (comme elle s’est fait admirer).
Je les ai laissé partir (comme je les ai fait partir).
La tablette qu’elle a laissé tomber (comme la montre qu’elle a fait changer).
Mais bien sûr : Elle s’est faite toute seule !
On gagne en simplicité mais c’est très loin de régler la question du participe passé, qui est l’un des sommets de la langue française et fera donc l’objet de quelques billets à venir (rappels du Berthet et exemples).
Pour vous appâter, cher public, voici ce qu’on peut lire dans une notice de médicament : « Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre ». Horreur : ici, le complément d’objet direct du sujet « vous » n’est pas « la dose » mais le verbe « prendre », qui n’est pas placé avant le sujet mais après. Donc « oublié » ne s’accorde pas avec la dose (féminin). Il reste invariable !
07:58 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
19/09/2014
Irritations : langage texto et séries en continu
Je repense au soi-disant « langage texto » et à ses « merveilleuses trouvailles typographiques »…
À dire vrai, il y a au moins deux langues texto : celle à base de français et celle à base d’anglais. Ainsi ai-je été perplexe, l’autre jour, par le sigle « mdr » en bas d’un texto… Non, cela ne signifie pas « merci de répondre » mais « mort de rire ». Le problème, c’est qu’on nous a gavés, Sophie Marceau la première, avec « lol » (pour laughing out loud). À ce propos, vous êtes-vous interrogés sur la construction de cette expression anglaise ? C’est l’occasion de se rappeler de sa vieille prof. d’anglais du lycée, qui disait : « prenez d’abord la postposition et ensuite le verbe » (les exemples de l’époque, c’était « to swim back », reculer en nageant). Cette règle donne ici : « exploser (out) en riant (laughing) très fort (loud) ».
Bon, revenons au texto. Comme il accepte par construction (sms) peu de mots et comme nos contemporains sont pressés (où est la poule, où est l’œuf ?), il est bourré d’abréviations (et de fautes de français) dont se délectent les linguistes. Mais quelqu’un s’est-il avisé du fait que les téléphones modernes proposent, dans le menu Réglages, des raccourcis, qui, une fois déclarés, permettent d’écrire vite tout en composant des textos lisibles : si vous programmez par exemple « vs » ou « apm », votre texto contiendra « vous » et « après-midi »…
Autre irritation de la semaine : « NETFLIX arrive », « c’est génial des centaines de vidéos en ligne », « on va avoir la même chose que les Américains », etc., etc. Ça fait des semaines que cela dure, pas besoin de publicité, les journalistes font le boulot…
Le bouquet, c’est l’arrivée en France, pour lancer le truc, du PDG américain de NETFLIX. Il accorde une interview exclusive (!) à France Inter et, naturellement, c’est en anglais. À la question : « allez-vous produire et diffuser des séries françaises ? », la réponse est tout sauf claire ; il botte en touche, indiquant qu’il dispose du plus grand répertoire de séries au monde. Ne nous faisons pas d’illusion : le but de NETFLIX sera de recycler en France le plus possible de séries américaines déjà amorties et de dépenser le moins d’argent possible pour ces veaux de Français (chers à De Gaulle) qui adorent téter le lait de la vache d’outre-Atlantique et qui, en plus, disent merci.
Autre moment fort de l’entretien : quand on lui rappelle que les discussions avec la ministre Aurélie Filipetti se passaient mal… Coup de bol, elle a été virée et la nouvelle, Fleur Pellerin, ancienne de l ‘économie numérique, a parfaitement compris l’intérêt de déverser des tsunamis de bouillie américaine dans les cerveaux disponibles de nos concitoyens.
À ma connaissance, on n’a jamais beaucoup parlé sur les ondes de séries françaises (comme par exemple « La famille formidable » ou « Fais pas ci, fais pas ça », sans doute « trop beauf » ou « trop franchouillard » ?) mais on déroule le tapis rouge aux productions industrielles américaines… pourquoi ? à qui profite le crime ?
Dernière chose sur ce sujet : le terme « streaming »… pourquoi n’a-t-il jamais été francisé ? Ne peut-on pas dire « en continu » ?
Voici ce qu’en dit Wikipedia : streaming (terme anglais, de stream : « courant », « flux », « flot ») ; diffusion en flux (terme recommandé par la Commission générale de terminologie et de néologie) ou lecture en continu, lecture en transit (suggestions de l'Office québécois de la langue française). L'OQLF propose également la locution adverbiale « en continu » pour qualifier les procédés de lecture en continu ou diffusion en mode continu (selon le lexique de l'AFNIC, voir http://www.afnic.fr/doc/lexique/d#diffusioncontinue).
Encore une fois, la créativité et l’absence de consensus entre les organismes de francisation ne nous facilitent pas la tâche.
Moi, je propose, comme les Québécois, lecture en continu.
Gardons espoir néanmoins. Un journal comme Le Revenu utilise en général les termes français et écrit les termes anglais en italiques. Dans l’exemple ci-dessous, du coup, on oublie streaming et on comprend ce qu’on lit…
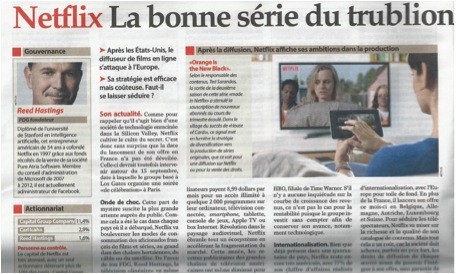
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)
18/09/2014
Réformes de l'orthographe : chapitre VI Les accents
On aborde aujourd’hui le cas des ¨, ´, `et ^, c’est-à-dire de mes chers accents.
Et là, cher public, il va falloir vous accrocher un peu.
D’abord, le tréma.
Il interdit que l’on prononce deux lettres successives en un seul son (voir la différence entre lait et naïf).
La rectification consiste à le déplacer quand il est positionné sur la mauvaise lettre (cf. la première liste dans l’aliéna suivant) et à le rétablir quand il manque (cf. la seconde liste).
On écrira donc : aigüe (au lieu de aiguë !), ambigüe, ambigüité, exigüe, exigüité, contigüe, contigüité et la fameuse cigüe de Socrate.
Et d’autre part : il argüe (et toute la conjugaison du verbe argüer, qui se prononce ar-gu-er et non pas comme narguer !), gageüre, rongeüre… reconnaissons que la vie quotidienne des Français ne va pas être bouleversée par ce changement d’écriture qui met en accord la graphie avec la prononciation.
Ensuite le circonflexe.
Sur les voyelles a, e et o, rien ne change.
Mais sur les voyelles i et u, il n’est maintenu que dans les cas suivants :
- La terminaison des conjugaisons, au passé simple, à l’imparfait du subjonctif (si, si, ça existe !) et au plus-que-parfait du subjonctif : nous suivîmes, nous voulûmes, vous suivîtes, vous voulûtes, qu’il suivît, qu’il voulût, qu’il eût suivi, il eût voulu… sur le modèle du verbe aimer. Et donc : nous voulûmes qu’il prît la parole ; il eût préféré qu’on le prévînt. Ce qui veut dire, a contrario, que l’on écrira dorénavant : il apparait (et non plus il apparaît)…
- Dû, jeûne, mûr, sûr, croître : on conserve l’accent circonflexe car il apporte une distinction de sens fort utile (par rapport à l’article du, au jeune qui n’en veut, au mur de la maison, au bœuf sur le toit et à la conjugaison du verbe croire). Mais on ne la met pas sur les dérivés ni sur les composés de ces mots : sureté, accroitre…
- Dû, mûr et sûr ne prennent pas d’accent au féminin ni au pluriel (car il n’y a plus d’ambigüité)
Certaines anomalies étymologiques sont rectifiées. On écrira désormais :
§ le participe passé mu (et non plus mû) comme su, tu, vu et lu ;
§ plait comme tait et fait ;
§ piqure comme morsure
§ traine et traitre, comme gaine et haine) ;
§ assidument, continument, crument, dument, goulument…
Mais les noms propres et leurs adjectifs dérivés ne sont pas modifiés (Nîmes et nîmois).
Et enfin les accents aigus et graves…
- on accentue sur le modèle de semer, les futures et conditionnels des verbes du type céder ; en clair : je cèderai, je cèderais, j’allègerai, je considèrerai…
- on écrira : aimè-je ?, puissè-je ? (vous l’utilisez souvent, vous ?)…
- on ajoute des accents aux mots suivants : asséner, démiurge, québécois, recéler, réfréner… (je n’ai reproduit que les mots les plus courants) ;
- on modifie l’accent sur les mots suivants : allègement, allègrement, assèchement, cèleri, crèmerie, règlementaire (et les autres mots de la même famille), évènement, sècheresse… (je n’ai reproduit que les mots les plus courants). De ce fait, la graphie redevient conforme à la prononciation.
- on accentue, conformément à la prononciation actuelle, les mots d’origine étrangère : artéfact, critérium, désidérata, duodénum, facsimilé, linoléum, média, mémento, mémorandum, placébo, référendum, satisfécit, sénior, vadémécum, véto (d’origine latine) et aussi allégro, braséro, diésel, édelweiss, imprésario, pédigrée, pérestroïka, péséta, révolver, séquoïa, sombréro, trémolo… (je n’ai reproduit que les mots les plus courants)
Ça se complique encore quand on attaque les verbes en –eler et –eter : on les conjuguera sur le modèle de peler et acheter : l’eau ruissèle (et non plus elle ruisselle), l’eau ruissèlera, l’homme de ménage époussète ou époussètera, le jeune étiquète ou étiquètera.
Et idem pour les noms en –ement qui en sont dérivés : amoncèlement, ensorcèlement, martèlement, morcèlement, nivèlement, ruissèlement… (je n’ai reproduit que les mots les plus courants).
Voilà, c’est fini…
Rassurez-vous, braves gens : dans sa bonté (et sa sagesse), l’Académie a stipulé que les amoureux des anciennes graphies pouvaient les conserver… Ouf !
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)



