27/09/2014
Se marier d'accord, mais en français
Les lois Barre et Toubon, et peut-être d’autres, rappellent que l’usage du français est obligatoire dans les écrits de l’administration. D’ailleurs la Constitution stipule : la langue de la République est le français.
J’ai donc été outré de voir des mentions en anglais dans les bans publiés à la Mairie d’une ville royale d’Île de France ; ici, c’est la profession des futurs époux qui est en anglais… (sachant qu’ils habitent en Alsace, on aurait, à la limite, compris qu’ils le soient en allemand !).

Comme disait Francis Blanche, « j’ai immédiatement contacté la Mairie ». Voici ce que le service de l’État-civil m’a répondu :
« Je vous confirme que vous avez raison, je vous remercie de l’attention et de l’intérêt que vous nous portez.
Effectivement cela n’aurait pas du se produire, la rectification est en cours.
Veuillez trouver ci-dessous, un extrait de la Loi rappelant ceci : »
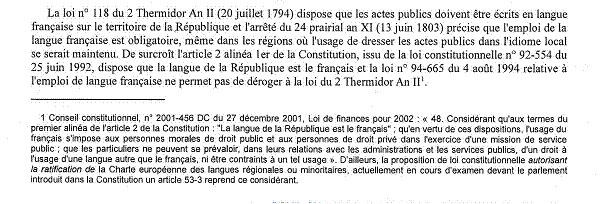
Bizarrement, faire respecter l’usage de sa langue maternelle et même d’une Loi constitutionnelle est un combat… il faut donc se battre pour le français.
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Tags : franglais, français | Lien permanent | Commentaires (0)
26/09/2014
Une soirée devant la télé
Le jour où l’homme providentiel s’est produit et promu au 20 heures de France 2, chaîne du service public, j’ai regardé – un peu – la télévision.
Peu importe les images, j’ai entendu ceci :
(Laurent Delahousse) « Assumez-vous la droite attitude ? »
Cette question profonde mérite que l’on s’y arrête. En français de Molière ou de Victor Hugo, cela voudrait dire : assumez-vous une attitude honnête, franche, directe, linéaire ? On l’aurait formulé « assumez-vous une attitude droite ? » et la question n’aurait plus eu aucun sens car qui y répondrait non ?
En réalité, pour faire savant, Lolo construit sa question à l’anglosaxonne, avec le déterminant d’abord (la Droite française) et le déterminé ensuite (l’attitude), et il veut simplement dire : « assumez-vous votre positionnement à droite du spectre politique ? ». Perversion de la syntaxe…
Heureusement, il se rachète, en quelque sorte, en parlant peuple et jeune quelques instants plus tard :
(Laurent Delahousse) : « Vous dites-vous C’est juste pas sérieux ? ».
J’ai déjà commenté cet usage abusif, à l’anglosaxonne, de l’adjectif "juste", je n’y reviens pas.
Puis, Lolo plonge dans la redondance : au lieu de dire « êtes-vous capable de… ? », il dit « êtes-vous en capacité de… ? » (certains disent aussi : « avez-vous la capacité de… ? », à croire qu’ils parlent à des outres !).
J’ai vu de la pub… là, on présentait un parfum et on prononçait son nom (dahlia divin) à l’anglaise, à moins que ce ne soit dans une autre langue, inconnue de moi.
J’ai regardé une partie d’une enquête sur les lunettes pas chères, en dix minutes… On y parlait de low cost, expression d’autant plus récurrente que les Français tirent le diable par la queue (c’est une métaphore, que vous avez identifiée, bien sûr). Soit dit en passant, cost c’est plutôt le coût (de revient) et non pas le prix (payé par le client)… Mais ne chipotons pas, c’est pas cher, et les Français en redemandent, même au prix ( !) d’une qualité bas de gamme, de dangers pour la santé et du chômage du beau-frère ; quand on n’a pas de sous, on n’a pas de sous. Pourquoi ce franglicisme ? Évidemment, comme tout cela est vendu par des e-opticiens, l’anglais s’impose… Mais on peut dire « à bas prix », « pas cher », « à prix cassé », etc.
Enfin, le lendemain matin, j’ai entendu une humoriste se moquer du bel Arnaud et dire qu’il multipliait les selfies à San Francisco… Quel mot compliqué pour, simplement, se prendre en photo ! Les peintres diraient « autoportrait », je reconnais que « autophoto » ne serait pas très euphonique mais combien de mots d’usage courant ne le sont pas non plus !
Avez-vous une idée ?
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Tags : franglais, français | Lien permanent | Commentaires (0)
25/09/2014
Irritations II
Regardons du côté des produits de beauté, ici un démaquillant. Voici les inscriptions qui y figurent :
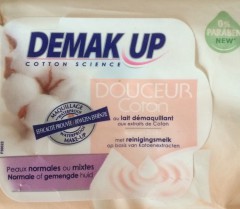
En zoom, c’est encore mieux :

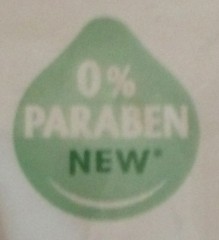

Ce charabia est-il raisonnable ?
Faudra-t-il un jour boycotter les produits dont l'emballage sera orné de mentions en anglais ?
En attendant, écrivons aux fabricants, aux laboratoires pharmaceutiques, à l'Oréal… et au Bureau de vérification de la publicité (qui porte bien mal son nom) pour protester et rappeler la Loi.
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Tags : publicité, franglais | Lien permanent | Commentaires (0)



