02/12/2014
Écrire et relire
On n'en finirait pas de s'agacer...
Je sais bien que je peux lasser mes lecteurs à la fois avertis du problème et indemnes du défaut ; mais tant pis, je râle encore une fois.
On lit de plus en plus de textes truffés de fautes d'orthographe et de grammaire, ou plutôt - ne soyons pas méprisants - de coquilles. Quand il s'agit de journalistes, d'écrivains, de personnes diplômées, en effet, on n'imagine pas qu'ils aient oublié les règles, encore moins qu'ils ne les aient jamais apprises. Non, ce sont des coquilles (à propos, savez-vous que ce terme est fort ancien ? et pour trouver son origine, enlevez donc une consonne au milieu…).
Et les coquilles arrivent à tout le monde, simplement les gens ne relisent plus leur texte. Vite, aller toujours plus vite !
Premier exemple: le bouquin "Jours de collège" de Louise Cuneo et Sophie Delcourt (Bartillat, 2014). C'est le journal, reformulé par une journaliste, d'une prof. d'histoire débutante, Normalienne de formation, lors de sa première année dans un collège de banlieue parisienne en ZEP. Bien que toutes les difficultés racontées soient connues et aient fait l'objet de pas mal de livres déjà, c'est intéressant et déprimant ; quelle jeunesse ! et quelle misère sociale ! l'un expliquant sans doute l'autre.
Mais côté français, aïe, aïe, aïe : une coquille toutes les cinq pages, au moins ; articles ou conjonctions oubliés, "s" oubliés, phrases bancales...
Où est le temps où c'étaient des Normaliens, justement, qui corrigeaient la prose de leurs contemporains chez les éditeurs avant publication ?
Second exemple, pour ne pas être trop long : un éditorial en forme de réponse à un lecteur dans le journal d'un Comité d'entreprise envoyé aux salariés et retraités, appelés "bénéficiaires".
Rien de sert de paraphraser ni de geindre, je vous livre les phrases telles quelles.
"il m'arrive quelques fois d'y répondre" ; "tout juste un légitime devoir de réponse" ; "vous informant sur les activités" ; "en faveurs des bénéficiaires" ; "existe dans le sommaire quelques informations" ; "la décision d'être en capacité de communiquer" ; "mon incapacité grandi au fur et à mesure" ; "j'ai bonne mémoire contrairement à vos propos" ; "mon aptitude mémorielle personnelle" ; "quand à la sempiternelle lutte des classes" ; "en imposant un concept de désuétude de cette réalité" ; "voilà ce qui a desservie la conscience de classe" ; "de surcroit" ; "sachez que jamais je ne cesserais d'exhorter les valeurs qui sont miennes" ; "je suis perfectible comme tout à chacun" ; "par causalité, voilà pourquoi je fais référence…" ; "j'affectionne leurs citations" ; "qui a en charge de gérer vos activités" ; "des défauts que vous me permettrez de tenir secret" ; "je travaille à leurs extinction" ; "vous faites part, je vous cite…" ; "Et Alors ?" ; "les salariés n'on pas droit à offrir... ?" ; "est-il honteux de vendre Français ?" ; "votre emportement à vouloir virer…" ; "qui rêve lui a n'en pas douter" ; "m'insulter qu'en à la valeur de mon engagement" ; "mon parcours aux seins des entreprises" ; "les mandats tenus atteste" ; "je vous feras grâce des actions menées" ; "j'en arrêterais là de ma réponse" ; "tout à chacun puisse juger" ; "ce type d'échange ne fais en rien évoluer la problématique" ; "oublier toutes formes de politesses" ; "un Collègue, moi-même, qui a fait le choix" ; "je conclurais par ces propos"...
Certains ont dit qu'à 5-0, la Deutsche Mannschaft aurait dû lever le pied en demi-finale et éviter à la Selecaõ l'humiliation. De même, à un tel niveau d'accumulation de fautes (de coquilles) ce serait peut-être de la charité chrétienne de passer outre et de parler d'autre chose...
On a dit aussi que certains responsables syndicaux faisaient "exprès" de mal parler pour faire peuple. À l'opposé, on pourrait penser que notre éditorialiste a essayé de "faire intellectuel" et s'est mélangé les pinceaux...
Mais gardons l'idée que c'est de la précipitation, de la distraction, que ce sont des coquilles.
Quelle est donc la morale de cette histoire ?
D'abord qu'il faut relire après avoir écrit ; c'est une question de respect des futurs lecteurs ; cela permet aussi parfois de s'apercevoir que certaines idées ont été mal présentées et qu'il faut récrire certains passages.
Ensuite que la probabilité de laisser des coquilles augmente avec la longueur des phrases et la longueur du texte ; donc, être concis et faire des phrases courtes.
Pour moi, la sanction va être immédiate : comme j'étais en retard pour ce billet, je n'ai guère relu… à vos commentaires !
11:51 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
01/12/2014
Jean d'O., on t'aime (addendum)
Marin de Viry, un vrai critique littéraire, lui, a publié dans le Marianne du 9 juin 2012, une analyse que je trouve très pertinente, bien qu’assez sévère, de l’œuvre de Jean d’Ormesson, à l’occasion de son « entrée » dans la collection Bouquins (six romans).
Bien mieux que je n’aurais pu le faire, il distingue deux « manières » dans la prose de notre Jean d’O. :
« Quand (il) produit lui-même la fiction : (c’est un) ronron extatique. Quand nous avons des histoires ou des vies extérieures à son imagination : l’auteur tend le jarret pour se mettre à la hauteur de son sujet – et quels sujets : Chateaubriand, les sœurs Mitford, l’histoire de sa famille – et fait de petits bonds pour le surplomber ».
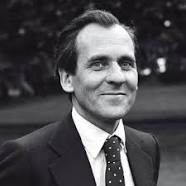
« (Dans le premier cas), c’est toujours l’été (…), l’érotisme traîne, l’amour est compliqué… ; vous rajoutez des pinèdes, des cyprès, de l’autodérision de fils de famille, des jeunes femmes prises à la taille qui égrènent des propos spirituels sur un coin de table… ».
« Je suis probablement nul mais je le dis si bien que je vous laisse me trouver très brillant si ça vous chante ».
« Cette aristocratique mise à distance signe son ralliement à une génération d’auteurs qui sont autant de royaumes indomptés : Morand, Nimier, Dutourd, Druon, etc. ». J’ajouterais bien Michel Déon à tous ces dandys qui semblent vivre de l’air du temps et balader partout dans les lieux à la mode leur éternelle jeunesse.
« Au total, c’est une machine à ne voir que l’agréable en tout ».
« D’Ormesson a inventé l’errance dans la lumière ».
« Mais personne ne songe à se faire rembourser le spectacle : c’est ça qui est fort ».

Je suis d’accord avec tout cela : les lecteurs habituels du Figaro et les spectateurs assidus de Vivement dimanche l’adorent. C’est tout de même mieux de Marc Lévy et Guillaume Musso, non ?
08:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
30/11/2014
Irritations VII : Saint Nicolas
Bon an mal an, en écoutant la radio, on trouve chaque jour à s’échauffer la bile…
Ainsi, sur France Inter, dans la Matinale du 28 novembre 2014, a-t-on pu entendre une journaliste parler trois ou quatre fois de performance à propos d’une représentation théâtrale…
Mais, surprise, une autre a prononcé le mot sweat shirt : souète cheurte, c’est-à-dire à l’américaine, alors qu’on entend généralement : souite cheurte, c’est-à-dire sweet shirt… Il est vrai que c’était une interprète qui traduisait un Américain de Ferguson, et le propre de l’interprète, c’est de connaître les deux langues qu’elle met en correspondance. Et ce n’est pas le cas de beaucoup de nos compatriotes, qui sont à l’aise avec le franglais mais ne connaissent ni l’anglais ni le français.
Ces derniers jours, on ne nous a pas parlé du Sommet de la Francophonie (voir mon billet d’hier).
En revanche, on nous a bassinés avec Thanksgiving, jour du grand pardon outre-Atlantique. Et ça, ce ne serait rien !
On croyait Halloween rangé par les sorcières ces dernières années mais non, il est revenu en force ; alors Thanksgiving en plus ou en moins…

Non, ce ne serait rien si les puissants du commerce international n’en avaient profité pour nous fourguer le Black Friday (avec les majuscules s’il vous plaît), qui s’ajoutent aux soldes permanents d’une société de consommation en panne. Car le lendemain de Thanksgiving, c’est cadeaux !
Claude Hagège dit que l’anglais, c’est la pensée unique… ceux qui ont des oreilles finiront pas entendre.
 Le 6 décembre, on ne nous parlera pas non plus de Saint Nicolas… coincé qu’il est entre les citrouilles et le Père Noël…
Le 6 décembre, on ne nous parlera pas non plus de Saint Nicolas… coincé qu’il est entre les citrouilles et le Père Noël…
Saint Nicolas ne venant plus à moi, comme il le faisait au temps de mon enfance dans les Hautes Vosges, j’ai décidé d’aller au devant de lui.
Cap à l’Est, U.S. go home !
08:00 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)



