08/12/2014
Dis pas ci, dis pas ça (V)
Dans son petit livre de mise au point, l’Académie, pour recommander ou bannir, se fonde sur quelques principes qui sont aussi les miens depuis longtemps : rester simple dans son expression, être logique et cohérent, utiliser les mots qui existent au lieu d’attraper tous les néologismes qui passent, tirer profit de la variété et de la précision de notre langue, au besoin « recycler » des mots passés de mode… mais elle rappelle aussi assez souvent l’origine et la « trajectoire » des mots, c’est-à-dire l’étymologie, ainsi que les exceptions et quelques paradoxes de l’usage qui, parfois, laissent perplexes (ainsi, « clôturer » ne doit être employé qu’au sens propre, dans le monde physique : « clôturer un champ », alors qu’on tolère le substantif « clôture » au figuré : « clôture de la Bourse »).
Je vous propose aujourd’hui de balayer le chapitre de la lettre C. Il contient des articles dont le contenu m’a fait plaisir (courriel et mél., contrôle…).
Commençons par lever l’incertitude que nous avons tous sur les verbes qui autorisent la construction personnelle ou impersonnelle. On peut dire et écrire : « Nous verrons ce qui se passera » aussi bien que « Nous verrons ce qu’il se passera, l’Académie considérant que la nuance est souvent indiscernable et constatant que les meilleurs écrivains emploient l’une ou l’autre des formulations. Libertad !
L’arbitrage entre « C’est » ou « Ce sont » est plus compliqué. On retiendra que « le pluriel est de meilleure langue », sauf dans quelques cas comme « C’est vous tous qui avez décidé ».
Avec « Ci-inclus » et « Ci-joint », on franchit un autre seuil de difficulté. Il y a trois cas de figure :
§ la locution a la fonction d’épithète et est placée « avant » ; on accorde ; « La pièce ci-jointe » ;
§ la locution est nettement adverbiale, en particulier en étant placée « après » ; on n’accorde pas ; « Ci-joint la copie des pièces » ;
§ dans les autres cas, ça dépend et donc ça varie… Bonjour l’hésitation.
Bien sûr, à la lettre C, il y a aussi des termes franglais… Je n’insiste pas sur « confusant » (de l’anglais confusing), qui n’a aucune raison de remplacer troublant, perturbant, déconcertant, prêtant à confusion, etc.
Et maintenant, le fameux « Contrôle » et son double, l’anglais Control. Son histoire est intéressante et éclairante. Au départ, il y a le « rôle », qui est une liste inscrite sur un rouleau de papier ; puis, le « contre-rôle », qui servait à vérifier l’exactitude de ce qui était inscrit sur le rôle et qui a donné « Contrôle ». Il ne faut employer « Contrôle » que dans ce sens de vérifier, et non pas dans le sens anglais de maîtriser, conduire, commander. Tout le sel de cet article, et le rédacteur de l’Académie ne le sait sans doute pas, est que, dans les entreprises, le « Contrôle interne » s’est répandu et que ses experts passent leur temps à répéter que ce n’est pas de la vérification pointilleuse mais une assurance de la maîtrise des activités. Alors qu’on fait appel généralement à la logique et à l’étymologie pour inciter les gens à « bien parler», il faut donc dans ce cas précis les enjoindre à lire un mot « Contrôle » en lui attribuant le sens de « maîtrise », alors qu’il signifie bien « vérification ». C’est la schizophrénie de l’entreprise et, certains diront, la Lingua quintae respublicae…
L’Académie dit bien « courriel » pour les messages électroniques (e-mail) et « mél. » uniquement pour les adresses, dans le même emploi que « tél. ». S’il n’y avait que ce critère, sur ces seuls deux mots, je pourrais donc postuler à l’Académie avec une chance de succès…
Mon dernier paragraphe est pour M. : une rumeur (un canular) a couru il y a quelques mois dans les réseaux sociaux, selon laquelle l’Académie accepterait « ils croivent » à côté de « ils croient ». Il n’en est rien : bien que cette forme soit fréquente dans certaines régions, depuis fort longtemps, et pas uniquement dans les banlieues…, elle est incorrecte. Malgré des ressemblances, « croire » ne se conjugue pas comme « boire » ou « savoir » !
08:00 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
07/12/2014
Dis pas ci, dis pas ça (IV)
Dans le petit bouquin de l’Académie, il y a encore les mots employés de travers :
« appétence », dont la terminaison en –ence fait savant, utilisé à la place de appétit (ou goût marqué ou désir).
« blindé (de monde) », correct dans le langage militaire et dans l’argot au sens de « endurci, protégé » mais à éviter dans le langage courant au sens de « plein, rempli » !
Le fameux « au temps pour moi », dont la graphie courante « autant pour moi » est déconseillée, à la fin d’un article assez peu clair.
Les tournures boursouflées « au niveau de l’horaire », « au plan international », « à la base, je pensais avoir raison », « à l’endroit d’un tel crime », alors que l’on peut (doit) dire « quant à l’horaire », « sur le plan économique », « dans un premier temps, je pensais avoir raison » et « pour un tel crime ».
L’archi-pléonasme « au jour d’aujourd’hui » (il y a trois fois la même notion temporelle, puisque « hui » vient du latin hodie, jour) bizarrement tolérée du bout des lèvres…
Les yeux porcins de l’éleveur de porcs… et la carte électorale qui est de bien plus grandes dimensions que la carte d’électeur.
Le vernis de juridisme qui s’attache à « acter », qui ne doit justement s’employer que dans l’expression « acter une décision » mais sûrement pas dans « acter des avancées ».
 L’insupportable jargon de la SNCF qui masque ses retards et ses éventuelles turpitudes par ses sempiternels « accidents-voyageur » : cette apposition intempestive est ambiguë et par là contraire à l’esprit et aux règles de la langue. Rien de moins ; nul doute que la SNCF en tremble encore !
L’insupportable jargon de la SNCF qui masque ses retards et ses éventuelles turpitudes par ses sempiternels « accidents-voyageur » : cette apposition intempestive est ambiguë et par là contraire à l’esprit et aux règles de la langue. Rien de moins ; nul doute que la SNCF en tremble encore !
Le français, ce n’est pas si difficile que cela ; restons simples !
08:00 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
06/12/2014
Dis pas ci, dis pas ça (III)
Ensuite, il y a évidemment le gros morceau du franglais et de tous ces mots qui permettent de frimer : brief, débriefer, buzz, booster, overbooké, surbooké, blacklister, best-of (pour se limiter aux lettres A et B ; le reste, comme disaient mes profs de Terminale, je vous laisse le voir à la maison…).
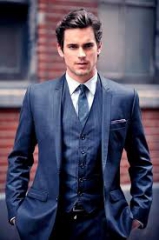 Là-dessus, je trouve que l’Académie n’est pas très bonne… à la fois trop timorée, paralysée par son impuissance (comment lutter contre un tsunami, tout en disant que ce n’est qu’une tempête ?) et surtout, feignant d’ignorer que proposer, par exemple, de remplacer « être surbooké » par « n’avoir aucun moment de libre », c’est peine perdue… Qui osera, dans une ambiance de travail où il importe avant tout de montrer qu’on est dans le coup, utiliser ce genre de périphrase qui paraîtra pédante ou désuète ?
Là-dessus, je trouve que l’Académie n’est pas très bonne… à la fois trop timorée, paralysée par son impuissance (comment lutter contre un tsunami, tout en disant que ce n’est qu’une tempête ?) et surtout, feignant d’ignorer que proposer, par exemple, de remplacer « être surbooké » par « n’avoir aucun moment de libre », c’est peine perdue… Qui osera, dans une ambiance de travail où il importe avant tout de montrer qu’on est dans le coup, utiliser ce genre de périphrase qui paraîtra pédante ou désuète ?
C’est un manque d’imagination ou un manque de travail sur le sujet ; il faut proposer aux francophones de bonne volonté des transpositions concises, pertinentes, efficaces. Il faut s’intéresser aux connotations, aux nuances, attachées à chaque mot car les Français y sont hypersensibles, contrairement aux Américains qui utilisent « Windows » quotidiennement sans état d’âme : s’il s’agit de désigner quelque chose d’un peu nouveau ou d’un peu différent, il leur faut un mot à part. Sur ce sujet-là, le PETIT DICO d’Alfred Gilder est bien meilleur.
Bon, je vous donne quand même les emplois recommandés pour la liste de termes franglais ci-dessus : réunion préparatoire, faire le bilan, rumeur / bourdonnement / bouche à oreille, augmenter / stimuler / développer / accélérer, figurer (être) sur (une) liste noire, florilège / le meilleur de / sélection.
Mais l’Académie consacre aussi un article entier aux anglicismes. Et que dit-elle ?
Que parler d’une invasion est excessif…
Que les emprunts à l’anglais sont un phénomène ancien (merci, on le savait… et alors ?). Et de citer une demi-douzaine de mots banals avec leur période d’entrée dans notre vocabulaire.
Qu’en plus des emprunts de mots, il y a des « emprunts sémantiques », qui donnent une nouvelle acception à des mots français existants comme « conventionnel » ou « négocier ».
Et aussi des réintroductions (coach, challenge…) et des calques (guerre froide, cols blancs et cols bleus, homme de la rue…).
Et elle admet que le phénomène s’est accéléré depuis cinquante ans.
Les chiffres sont intéressants : le Dictionnaire des anglicismes en dénombrait 3000 en 1990. Comme le vocabulaire courant comprend 60000 mots, cela ferait 5 % d’anglicismes mais l’Académie divise le ratio par deux, arguant que la moitié seraient déjà vieillis ! Cela étant, le Dictionnaire des mots anglais du français en dénombre 5 % en 1998… Raté !
Quand on veut aboutir à un résultat, tous les moyens sont bons : l’Académie décrète alors que beaucoup de ces mots sont peu fréquents dans la langue courante, cantonnés qu’ils seraient dans des domaines spécialisés !
Le Dictionnaire de l’Académie française, quant à lui, en est à 38897 mots répertoriés pour l’instant, et sur ce total, il ne décèle que 686 mots d’origine anglaise (soit 1,76 %), à comparer avec 753 mots d’origine italienne (Viva Italia)… ça ne m’étonne plus que Zidane se soit fâché très fort en finale ! L’arabe, en l’occurrence, fournit 224 mots (0,58 %). C’est à croire que l’essentiel des mots empruntés commencent par une lettre de la deuxième moitié de l’alphabet.
Bonne fille, l’Académie concède tout de même qu’il faut surveiller certains abus comme la propension à multiplier les tournures passives, les constructions en apposition et les nominalisations. ; et qu’on « emploie un anglicisme vague pour ne pas se donner la peine de chercher le terme français existant parmi plusieurs synonymes ou quasi-synonymes » : par exemple, « finaliser », « performant », « collaboratif », « dédié à » ou pire encore, dit-elle, « cool », « speed », « fun », etc.
On en est à la quatrième page de l’article que l’Académie, qui pense qu’il n’y a pas d’invasion, en rajoute en abordant les emprunts inutiles : « feedback », « speech », « customiser », « news »… sans que l’on comprenne très bien ce qui distingue cette nouvelle catégorie des précédentes. Elle se réjouit de constater, à la suite de R. Étiemble, que « starter », « speaker », « lift » et d’autres ont disparu, comme, pense-t-elle, « pitch » et « afterwork ».
Elle savoure le fait que l’on utilise ordinateur, logiciel, vidéo à la demande, biocarburant, voyagiste (ah bon ?), covoiturage, monospace, navette, passe (le badge, pas les maisons). Mais justement, c’est le résultat, souvent excellent, d’une lutte acharnée contre l’invasion, par quelques esprits inventifs et pertinents ! La défense du français, combien de divisions ?
08:00 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)



