29/12/2014
Dis pas ci, dis pas ça (XI)
Par manque d’anticipation, j’ai loupé la publication du billet quotidien le dimanche 28 décembre 2014… ce qui est rassurant et très satisfaisant, c’est que votre fidélité, Public, n’en pas été affectée, puisque vous avez été 59, exactement comme la veille, à consulter le blogue ; certains d’entre vous en ont peut-être profité pour rattraper leur retard en lisant d’anciens billets qu’ils n’avaient pas vu… Tant mieux.
Mais il est temps de reprendre les choses en main.
Voici donc le I d’Océan atlantique, ou plutôt la suite du I, en tant que billet du 28.
Commençons par « improbable », qui signifie « qui a peu de chances de se produire ». L’Académie, tout en citant Michelet « ville improbable » et Maigret « adresses improbables », s’insurge gentiment contre le tic de langage qui met cet adjectif à toutes les sauces (personnage improbable, dénouement improbable…). Les journalistes en sont friands. L’argument des Immortels est intéressant : « Les mots meurent de n’être pas employés mais s’ils le sont à mauvais escient, ils perdent saveur et vigueur ». Seul hic : comment demander à 150 millions de francophones de ne pas « abuser » d’une formule que Michelet et Simenon ont employée et qui est correcte ? Si tout le monde usait et abusait des tics de Bach ou de K. Jarret, faudrait-il confisquer les pianos ?
 Bien plus gênant, à mon avis, est la construction interrogative indirecte incorrecte. Mais là encore, l’Académie se trompe de débat : elle pointe du doigt des phrases comme « Dites-nous quand reviendrez-vous » (il faut dire « Dites-nous quand vous reviendrez »… phrases que je n’ai jamais entendues. Alors qu’à longueur d’antenne (si l’on peut dire…), on entend la faute inverse, à savoir : « Ce rôle vous a appris quelque chose ? » (au lieu de « Ce rôle vous a-t-il appris quelque chose ? ». Le champion de ce type d’incorrection, dans ceux que j’écoute : David Pujadas, sans doute ; ceux qui parlent bien : Patrick Cohen, Laurent Delahousse. Entendu à la radio le Président de la République (François Hollande) dire "Pourquoi la Gauche ne la voterait pas ?", au lieu de "Pourquoi la Gauche ne la voterait-elle pas ?" (France Inter, la matinale, 5 janvier 2015)
Bien plus gênant, à mon avis, est la construction interrogative indirecte incorrecte. Mais là encore, l’Académie se trompe de débat : elle pointe du doigt des phrases comme « Dites-nous quand reviendrez-vous » (il faut dire « Dites-nous quand vous reviendrez »… phrases que je n’ai jamais entendues. Alors qu’à longueur d’antenne (si l’on peut dire…), on entend la faute inverse, à savoir : « Ce rôle vous a appris quelque chose ? » (au lieu de « Ce rôle vous a-t-il appris quelque chose ? ». Le champion de ce type d’incorrection, dans ceux que j’écoute : David Pujadas, sans doute ; ceux qui parlent bien : Patrick Cohen, Laurent Delahousse. Entendu à la radio le Président de la République (François Hollande) dire "Pourquoi la Gauche ne la voterait pas ?", au lieu de "Pourquoi la Gauche ne la voterait-elle pas ?" (France Inter, la matinale, 5 janvier 2015)
Je passe sur l'imitation de l’anglais « to introduce someone to someone else » à la place de « présenter quelqu’un à quelqu’un d’autre », c’est du franglais snob de bas étage.
Bien plus sérieux est l’emploi du verbe « être » à la place du verbe « aller » dans des constructions comme : « Il a été à Paris » au lieu de « Il est allé à Paris ». Il y a plus subtil : « Ce rôle lui aurait bien été », au lieu de « Ce rôle lui serait bien allé ». « Il est mieux », au lieu de « Il va mieux ». Au restaurant, le serveur demande « Ça a été ? », au lieu de « Ça vous a plu ? » ou mieux « Cela vous a-t-il plu ? ».
Billet amendé le 5 janvier 2015, 12 h 30
11:16 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)
27/12/2014
Dis pas ci, dis pas ça (X)
Si je me limitais au « G » aujourd’hui, je n’aurais que deux mots à vous signaler…
D’abord gérer, qui est devenu un mot passe-partout : à la fois ça fait bien (moderne) de « gérer », et ça dispense de chercher le mot juste, pour aller vite (encore une fois, moins on cherche le mot juste, plus on perd l’habitude de le trouver !). On peut naturellement « gérer ses affaires », on peut gérer tout ce qui est matériel, dans le sens de « administrer », « veiller à la bonne marche de ». Mais évitons d’utiliser « gérer » pour son divorce (là, il y a une solution : ne pas divorcer…), pour ses échecs, ses doutes et, pis encore, ses enfants (là aussi, il y a une solution mais ce serait dommage de ne pas en avoir). Pire que tout, l’ellipse « je gère »…
Ensuite, « gré » : on sait gré à quelqu’un de…, on saurait gré, on saura gré et non pas « on sait gré » ! « Gré » s’emploie avec le verbe « savoir » et non pas avec l’auxiliaire « être ».
Du coup, j’enchaîne avec le « h ».
Je commence avec les liaisons dangereuses : il y a des « h » d’origine germanique qui sont aspirés et des « h » d’origine gréco-latine qui ne le sont pas. Le « h » de « haricot », comme celui de « handicap », est aspiré, il interdit donc la liaison, au singulier comme au pluriel, et cela a des conséquences sur la graphie aussi bien que sur la prononciation : on écrira « le haricot » et « un beau haricot » (et non pas « l’haricot » et « le bel haricot »).
« Impacter » est encore une forme inspirée de l’anglais ; ne l’employons pas à la place de « affecter » ou « modifier ».
08:25 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)
26/12/2014
Mandarin, pain d'épices et chocolat
Dans mon enfance, on fêtait Saint Nicolas, le 6 décembre, ainsi que je vous l’ai déjà narré, et on recevait un Pain d’épice qui avait la forme du saint homme. On était surtout frappé par sa légende, qui voulait qu’il ait redonné vie à trois petits garçons découpés en morceaux et mis au saloir par un boucher indélicat – c’est Bettelheim qui aurait adoré –. À l’origine, Saint Nicolas avait plutôt libéré trois soldats prisonniers mais cette histoire manquait de sel, si j’ose dire… L’engouement pour Saint Nicolas en Lorraine date des années 1050, à l’époque où des marchands rapportèrent de Bari (Italie) une relique – une phalange, je crois – d’un saint mort en 346 en Asie Mineure (aujourd’hui la Turquie). Cette relique arriva à Port, à côté de Nancy (et d’ailleurs ville quatre fois plus peuplée que Nancy en ce temps-là), que l’on rebaptisa ultérieurement Saint Nicolas du Port.
On tremblait par ailleurs à cause du Père Fouettard, qui flagellait les enfants désobéissants, sans savoir que ce faire-valoir n’avait été inventé qu’en 1500 et quelques, sous forme de caricature de Charles-Quint.
Bref, je parlais à l’instant des Saint Nicolas en pain d’épices et j’y reviens. De visite à Nancy début décembre, sur les traces de mes ancêtres, je me suis mis en quête de ma madeleine à moi. Enfer et damnation, aucun magasin en ville n’en proposait ; j’avais bien localisé un magasin spécialisé en banlieue mais il n’a jamais ouvert pendant que je pouvais m’y rendre. On a fini par dénicher des Saint Nicolas dans un Leclerc de centre commercial, au fin fond d’un magasin croulant sous les Père Noël en chocolat. D’où vient cette fascination des Français pour le chocolat ? pour le whisky, je comprends, mais le chocolat ? En fait, on est les premiers dans les classements qu’on peut…
Retour en Île de France ; à St Germain, on trouve sans problème tous les Saint Nicolas en pain d’épices qu’on veut ! Heureux qui comme Ulysse…
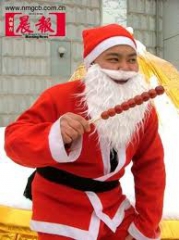
De là à penser que ceux de Nancy venaient de Chine… il n’y a qu’un pas qui me fait la transition avec un sujet connexe : les Chinois fêtent Noël. Bien sûr le Noël païen, sans Enfant Jésus ni crèche, mais avec le Père Noël ! Un Père Noël qui a souvent les traits de Bouddhas hilares.
C’est intéressant parce que, face à moi qui défend l’homme à la crosse contre le barbu rouge et blanc, il y a des centaines de millions de Chinois qui protestent contre l’envahissement de cette mode occidentale et demandent le retour aux fêtes traditionnelles. À chacun ses ancêtres ; la mondialisation n’a pas encore définitivement gagné !
09:44 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)



