21/03/2019
"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique II
Dans la biographie de Dominique Bona, il y a quelques passages confus, comme celui qui concerne les résultats scolaires de Romain : on ne comprend pas très bien si, finalement, il a été brillant ou non (page 24 et suivantes) : « … il figure dès l’année suivante au tableau d’honneur » et plus loin « un seul accessit en six années d’étude, et en allemand, où il est infiniment meilleur » (meilleur qu’en quelle matière ?). Autre phrase sibylline page 43 : « même s’il continue de donner à Wilno son nom polonais (Vilna étant celui que les Lithuaniens se reconnaissent) »…
Le personnage de Gary, tel que décrit par Dominique Bona, est à l’image de la couverture de l’édition Folio 3530 de 2011 : assez peu sympathique (bougon, renfrogné, hautain, sûr de lui…).
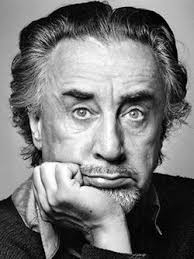
On retient le séducteur invétéré, le macho viril, l’obsédé par la création de son œuvre littéraire mais aussi le touche-à-tout (même si ses incursions dans le cinéma n’ont guère été concluantes), le polyglotte (russe, polonais, anglais, français, et quel français !), le communicant génial qui est la coqueluche des médias américains dans les années 60 et 70 lorsqu’il est consul général de France à Los Angeles, l’homme courageux, l’amateur de défis, et surtout cette obsession de renouvellement qui produira une œuvre très variée et qui trouvera son apogée dans les quatre romans publiés sous le nom d’Ajar, et écrits « d’une autre manière ».
En 1935, Romain Kacew (c’est son nom russe) réussit à publier dans l’hebdomadaire Gringoire sa première nouvelle « L’orage » (page 57). Dans le même numéro, il y a un texte de Francis de Croisset, longtemps collaborateur de Robert de Flers. Dans Gringoire, qui sera l’organe de la droite française musclée, notre vieille connaissance Paul Reboux publie un portrait d’Abel Bonnard (voir mes billets sur le triptyque de Michèle Maurois). Mais le fondateur Joseph Kessel, Stefan Zweig, Francis Carco, André Maurois… en sont aussi des collaborateurs fidèles. Que du beau monde !
On apprend plus loin (page 154) que Romain et Lesley « habitent une chambre qu’ils louent au marquis de Saint Pierre, père de Michel, l’écrivain débutant qui vient de publier, en 1945 lui aussi, Contes pour les sceptiques ». Encore une vieille connaissance…
L’analyse de Dominique Bona sur le roman « Les racines du ciel » est assez curieuse mais positive : « Saoûlé de points de vue, de jeux de lumière, le lecteur finit par se frayer son propre chemin dans la brousse, il peut choisir son camp, le narrateur qu’il préfère (…). À chacun ses éléphants… C’est ce que cet extraordinaire roman, avec sa rengaine, réussit à créer – une atmosphère de liberté, où le lecteur est libre de choisir son credo ». Elle insiste donc sur la composition du roman « en récits juxtaposés, à la fois répétitifs et différents ». Je n’ai pas ce souvenir-là mais il est intéressant d’apprendre que « ces trucages de composition » ont été reprochés à Romain Gary, qui aurait mal assimilé l’exemple des Américains Faulkner ou Dos Passos… (page 198). Dans ces conditions, on pourrait y ajouter l’Anglais Lawrence Durrell (sauf que son « Quatuor d’Alexandrie » date de 1963).
Kléber Haedens se plaint d’avoir eu à surmonter « la fatigue que donne la répétition implacable des mêmes idées et des mêmes thèmes » et « condamne surtout le style et s’indigne qu’on puisse imprimer un livre chargé d’un aussi grand nombre de fautes ». Il semble qu’en effet le livre ait été publié très vite, sans relecture attentive et qu’il souffre d’un nombre considérable d’erreurs de syntaxe et de conjugaison. Dominique Bona excuse son tempérament fougueux mais note « de nombreuses répétitions, quelques phrases en rocailles (?), des inversions obligatoires négligées, des liaisons intempestives et son style rebelle aux subjonctifs, en particulier aux imparfaits du troisième groupe » (page 200). Et elle ajoute « en dépit de ses prix de français au lycée de Nice »… Ah bon ? Première nouvelle (cf. ma remarque au début du présent billet).
07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
18/03/2019
Toujours et encore, ce débat sur la place du français... en France
Les faits : les organisateurs du Salon du Livre 2019 à Paris ont cru intelligent, moderne, astucieux, attractif (vis-à-vis des éditeurs non francophones)… de baptiser certains espaces « littérature Young Adult », « Live » ou « Bookroom ». Quelle bêtise ! quel snobisme crasse ! Quelle insulte à Gary, Kundera, Ionesco, Becket et tant d’autres, plus encore qu’à Chateaubriand et Hugo !
Ni une ni deux, une pétition sur le site du Monde a rassemblé les protestations légitimes de plus d’une centaine d’auteurs et d’intellectuels.
Ni trois ni quatre, l’inévitable Gaspard Koenig, pourfendeur vigilant de tout ce qui n’est pas purement « libéral », s’est fendu d’un article dans Les Échos (6 février 2019) pour clamer courageusement « Non au nationalisme linguistique ».
Ce sémillant jeune homme convoque la linguiste Henriette Walter et Léon Tolstoï pour dénoncer les affreux souverainistes qui demandent aux Ministres responsables de « renforcer la protection des Français les plus jeunes face aux agressions de l’uniformité linguistique mondiale » et pour prôner, en deux mots comme en cent, le laisser-faire et la fuite en avant chers aux néo-libéraux.
Son argumentation, archi-classique, tient en peu de phrases :
- L’anglais a absorbé dans le passé quantité de mots français (et alors ?)
- Le français, dans son passé prestigieux (à l’âge classique), a été lui-même dominateur et envahissant (Tolstoï aurait rédigé en français des passages entiers de Guerre et Paix). Je peux ajouter que « Crime et châtiment » est parsemé d’expressions « en français dans le texte ». Et alors ?
- Notre réaction est un aveu de faiblesse : « Quand on a confiance en soi, en sa capacité créative comme en sa destinée nationale, on ne redoute pas les influences étrangères ». Fort bien ; appliquons cette recette à tous les combats (féminisme, antiracisme, écologie, etc.) et attendons qu’ils aient suffisamment confiance en eux : rien ne changera tant qu’ils n’auront pas triomphé !
- Le globish n’est qu’une « monnaie linguistique universelle » commode et les Anglais sont les plus à plaindre du lot car ils entendent chaque jour leur langue massacrée… (je verse une larme pour tous les Anglais dépités et je ne commente pas cet argument sans intérêt)
- La lecture et le marché du livre reculent (ça, c’est vrai) ; « il faudrait peut-être trouver des moyens ingénieux de moderniser les formes éditoriales plutôt que de combattre des moulins à vent avec une plume d’oie » ; des moyens ingénieux ? lesquels ? on n’en saura pas plus, sauf que c’est « ce que font des start-up audacieuses » ! On est sauvé car des start-up s’occupent de la question…
Reste la conclusion, opportuniste autant que bizarre : « Sous ses allures sympathiques, cette pétition participe de l’actuel repli souverainiste (…). Oui à la littérature française ; non au lepénisme linguistique ».
Allez, restons-en là ; c’est assez de publicité donnée à des arguments maintes fois rabâchés et toujours aussi peu convaincants.
Mon mot de la fin à moi sera le suivant : mais pourquoi donc doit-on toujours se battre pour cette évidence qu’en France, on parle et écrit en français ?
14/03/2019
"Romain Gary" (Dominique Bona) : critique I
J’aime bien Romain Gary, du moins ses livres ; « Les racines du ciel » (Prix Goncourt 1956), « La promesse de l’aube » (1960), « La vie devant soi » (Prix Goncourt 1975) sont des chefs d’œuvre ; j’ai beaucoup apprécié « Lady L. » (1963) écrit en hommage à sa première épouse, un peu moins « Au-delà de cette limite, votre ticket n’est plus valable » (1975), consacré au vieillissement et à ses renoncements ; « La nuit sera calme » (1974) est un entretien fictif qui permet de mieux connaître Romain Gary. Jusqu’à présent, j’ai un peu buté sur « Europa » (1972) et il me reste à lire « Éducation européenne » (1945) et « Les cerfs-volants » (1980), quasiment le premier et le dernier livre de l’écrivain.
Reste l’homme. Ce qu’il raconte de lui dans « La promesse de l’aube » est romancé ; on en retient qu’il était originaire de Russie, qu’il a grandi sans père à Nice, que sa mère avait une ambition dévorante pour lui, qu’il a été aviateur et résistant pendant la 2èmeguerre mondiale. Je savais aussi qu’il a été un gaulliste inconditionnel, qu’il a fait carrière dans la diplomatie – son poste le plus connu étant consul de France à Los Angeles – qu’il a épousé en secondes noces l’actrice Jean Seberg – d’une beauté stupéfiante – et qu’enfin, elle et lui ont mit fin à leurs jours, à quelques années d’intervalle.
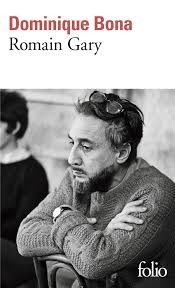
Voilà donc pourquoi je me suis plongé avec intérêt dans la biographie pour laquelle Dominique Bona – maintenant Académicienne – a obtenu en 1987 le Grand Prix de la biographie de l’Académie française. J’ai déjà parlé dans ce blogue de Dominique Bona, célèbre pour ses ouvrages consacrés à André Maurois, Camille Claudel, Berthe Morisot et Paul Valéry, dans lesquels elle choisit systématiquement le point de vue psychologique – quel est donc ce personnage, que cherche-t-il, pourquoi agit-il ainsi ? – et sentimental – les passions du personnage, les soubresauts de sa vie amoureuse –.
Dans son « Romain Gary », Dominique Bona ne suit qu’approximativement la trame chronologique et ne commente les œuvres que pour les replacer dans l’évolution de son héros. En fait elle avance par thème : la Russie, le résistant, le coup de foudre (Jean Seberg), le cinéma, la diplomatie, le gaulliste, les femmes, la supercherie (Émile Ajar) et le coup de chapeau final.
Le présent billet n’a pas pour objet de commenter l’œuvre passionnante de Romain Gary mais la biographie que lui a consacrée Dominique Bona. Et l’appréciation que je porte sur cette biographie est très mitigée car le style en est quelconque et parfois relâché. Ainsi, page 24 de l’édition Folio : « Désinvolte, elle a repoussé les derniers séducteurs et s’est dédiée tout à Romain ».
Par ailleurs, elle représente sans doute un travail important de recherches, d’entretiens avec des témoins et de recoupements, sept ans seulement après la disparition de l’écrivain. C’est apparemment la première biographie publiée mais ce n’est pas un texte qui épuise le sujet (est-ce possible ?), puisqu’aujourd’hui on apprend encore des détails sur les femmes de Romain Gary et sur la farce littéraire en lisant Wikipedia…
07:00 Publié dans Bona Dominique, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)



