18/04/2019
"L'étoile du sud" (Jules Verne) : critique II
On peut même lire « L’étoile du sud » à un troisième niveau : la façon de voir le monde des Français à la fin du XIXème siècle. Fascination envers la science et ses pouvoirs, ethnocentrisme, bonne conscience européenne, universalisme, géopolitique. Jules Verne évoque en effet le développement de la recherche des diamants et l’accaparement progressif des terres des Boers – ce qui veut dire « paysans », ici des immigrés huguenots – par les Anglais, avec les autochtones africains en arrière-plan (« Les Anglais étaient, à son sens, les plus abominables spoliateurs que la terre eût jamais portés (…) Rien d’étonnant si les États-Unis d’Amérique se sont déclarés indépendants, comme l’Inde et l’Australie ne tarderont pas à le faire ! Quel peuple voudrait tolérer une tyrannie pareille ! Ah ! monsieur Méré, si tout le monde savait toutes les injustices que ces Anglais, si fiers de leurs guinées et de leur puissance navale, ont semées sur le globe, il ne resterait pas assez d’outrages dans la langue humaine pour les leur jeter à la face ! » page 46 de l’édition de Crémille, 1990). « Je suis né à Amsterdam en 1806 (…) mais toute mon enfance s’est passée au Cap, où ma famille avait émigré depuis une cinquantaine d’années. Nous étions Hollandais et très fiers de l’être, lorsque la Grande-Bretagne s’empara de la colonie, à titre provisoire disait-elle ! Mais John Bull ne lâche pas ce qu’il a une fois pris, et en 1815 nous fûmes solennellement déclarés sujets du Royaume-Uni, par l’Europe assemblée en Congrès ! » (page 47, dans laquelle Jules Verne résume une partie de l’histoire de l’Afrique du Sud, qui se joue à trois : les Boers, les Anglais et les peuplades africaines).
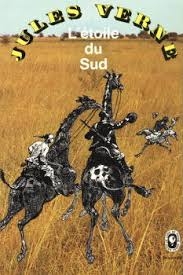
Les caractères y sont simplistes et en général inspirés des préjugés et stéréotypes de l’époque quant aux caractéristiques supposées des Français, des Anglais, des Écossais, des Chinois et des Africains. Par exemple, page 66, « Ce raisonnement, éminemment chinois, acheva la cure ». À propos de son aide noir, Matakit : « Aucune besogne ne le rebutait, aucune difficulté ne paraissait être au-dessus de son courage. C’était à se dire, parfois, qu’il n’y avait pas de sommet social qu’un Français, doué de facultés semblables, n’eût pu prétendre à atteindre. Et il fallait que ces dons précieux fussent venus se loger sous la peau noire et le crâne crépu d’un simple Cafre ! Pourtant Matakit avait un défaut – un défaut très grave – qui tenait évidemment à son éducation première et aux habitudes par trop lacédémoniennes qu’il avait prises dans son kraal. Faut-il le dire ? Matakit était quelque peu voleur, mais presque inconsciemment (…) Et Cyprien, tout en le regardant dormir, songeait à ces contrastes si bizarres qu’expliquait le passé de Matakit au milieu des sauvages de sa caste » (pages 70-71).
Par ailleurs, il faut de l’argent « pour acheter un claim de premier choix et une douzaine de Cafres capables de le travailler ». (Un claim est un titre de propriété minière, conférant le droit d'exploiter sur une superficie déterminée et aussi le terrain renfermant du minerai (or, diamant, uranium. Source : dictionnaire Larousse.fr).
Naturellement d’écologie et de protection de la diversité on n’entend pas parler (Romain Gary et ses « Racines du ciel » ne sont pas encore passés par là !) : « Il avait déjà tué trois lions, seize éléphants, sept tigres, plus un nombre incalculable de girafes, d’antilopes, sans compter le menu gibier » (sic !).
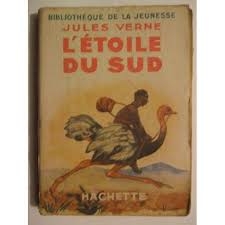
Un dernier commentaire sur la langue de Jules Verne : ici et là apparaissent quelques mots rares ou devenus rares. « billevesées » (propos, idée vide de sens ; sottise, baliverne – surtout au pluriel –, d’après Larousse.fr), « des tonneaux de bière et de vin gerbés de distance et distance » (empiler des charges – gerbes de céréales, fûts, sacs, etc. – les unes sur les autres) et « la fête épulatoire » (mot inconnu de mes dictionnaires).
07:00 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Roman, Verne Jules | Lien permanent | Commentaires (0)
16/04/2019
De, des et d'
Voici une facétie du français.
Il convient de dire et d’écrire : « Notre jardin présente à cette époque…
- des fleurs magnifiques (pas de problème) ;
- de magnifiques fleurs (problème : la plupart des gens remplacent « de » par « des ») ;
- d’étonnantes fleurs jaunes sur les kerria japonica ».
07:00 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
15/04/2019
"L'étoile du sud" (Jules Verne) : critique I
« L’étoile du Sud », publié en 1884, est un roman « classique » de Jules Verne, déclinant ses thèmes de prédilection : la science, l’aventure, la géographie, les passions humaines (amour, cupidité, jalousie…) et même géopolitique, sauf qu’il s’agit initialement d’un texte écrit par un autre (Paschal Grousset) et que Jules Verne a remanié.
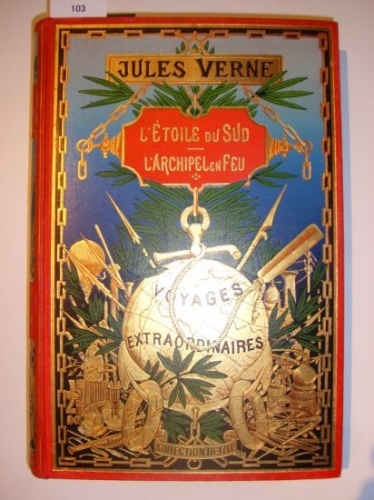
Il se passe en Afrique du Sud où Cyprien Méré, jeune ingénieur de l’École des Mines de Paris (Jules Verne adore les grandes écoles et plusieurs de ses héros sont Polytechnicien ou Mineur), étudie les gisements de diamants. Il est amoureux d’Alice Watkins mais se heurte au refus de son père quand il fait sa demande en mariage, sauf d’avoir une situation suffisamment avantageuse. Il se lance alors dans la fabrication d’un diamant artificiel, fabrication apparemment couronnée de succès puisqu’il obtient un diamant noir, l’Étoile du Sud (symbole de l’hémisphère sud), mais qui va lui attirer beaucoup d’ennuis. La pierre disparaît, ce qui permet à Jules Verne d’introduire dans son récit un peu statique, une course-poursuite à travers le bush du Transval ; tous les prétendants à la main d’Alice sont là et c’est donc comme une sorte de tournoi qui est organisé pour la conquérir. Dès lors les rebondissements s’enchaînent et l’on va de surprise en surprise (c’est la spécialité de Jules Verne), sur le diamant, sur le voleur, sur le mariage et sur le caractère des protagonistes.

Ce roman qui semble sans prétention est agréable à lire et comme toujours avec cet auteur populaire, peut être lu à deux niveaux :
- une aventure exotique qui se termine bien
- et par ailleurs une mise en scène des passions et des défauts des hommes (Wikipedia énumère : la spoliation, thème récurrent dans tous les romans des Voyages extraordinaires ; la justice, qui finit toujours par triompher ; la cupidité – en l’occurrence des Anglais – qui sera à l’origine de la guerre des Boers quinze ans plus tard et que Jules Verne semble annoncer ; la punition due à « l'annihilation des richesses par une abondance » de celles-ci, rendant leur valeur toute relative et tuant la passion et l'engouement des humains pour le matérialisme (puisque les diamants qui seraient fabriqués artificiellement ruineront toute l’activité d’exploration et d’extraction dans les mines) ; la responsabilité des hommes : « Bien des infortunes en ce monde sont ainsi mises au compte d'une malchance mystérieuse, et n'ont pour base unique, si l'on descend au fond des choses, que les actes mêmes de ceux qui les subissent ! »).
07:00 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Roman, Verne Jules | Lien permanent | Commentaires (0)



