03/04/2015
Respectez nos paysages
J’ai appris l’existence de l’association « Paysages de France » dans la revue Alternatives économiques (numéro de février 2015, je crois).
 Son président, Pierre-Jean Delahousse (notez le tiret entre Pierre et Jean, c’est un seul prénom, à la mode française et même européenne ; sachant qu’il s’agit d’une inversion qui semble « gratuite », du prénom classique Jean-Pierre…) y dénonce les infractions très nombreuses à la loi, que commettent les afficheurs et la grande distribution, en plantant « des panneaux publicitaires, parfois gigantesques, jusque dans les parcs naturels régionaux et des enseignes au sol dont la hauteur excède parfois de 400 % la taille maximale autorisée par le code de l’environnement ».
Son président, Pierre-Jean Delahousse (notez le tiret entre Pierre et Jean, c’est un seul prénom, à la mode française et même européenne ; sachant qu’il s’agit d’une inversion qui semble « gratuite », du prénom classique Jean-Pierre…) y dénonce les infractions très nombreuses à la loi, que commettent les afficheurs et la grande distribution, en plantant « des panneaux publicitaires, parfois gigantesques, jusque dans les parcs naturels régionaux et des enseignes au sol dont la hauteur excède parfois de 400 % la taille maximale autorisée par le code de l’environnement ».
Il pointe aussi du doigt la complicité de nombreux préfets qui refusent de mettre en œuvre les dispositions prévues pour faire cesser les infractions, alors même que l’association a obtenu 80 jugements en sa faveur. Et n’est-ce pas le plus grave ? C’est comme dans les films d’action : le voleur est le voleur mais si le gendarme devient voleur à son tour, on ne peut plus avoir confiance en rien ni personne… On nous bassine avec le soutien aux entreprises, avec les charges excessives qu’elles supportent, avec la nécessaire suppression de toute contrainte, avec les subventions sans contrepartie dont elles doivent bénéficier… pourquoi pas… Et quand elles enfreignent la loi, on ne les sanctionne pas non plus ?
prévues pour faire cesser les infractions, alors même que l’association a obtenu 80 jugements en sa faveur. Et n’est-ce pas le plus grave ? C’est comme dans les films d’action : le voleur est le voleur mais si le gendarme devient voleur à son tour, on ne peut plus avoir confiance en rien ni personne… On nous bassine avec le soutien aux entreprises, avec les charges excessives qu’elles supportent, avec la nécessaire suppression de toute contrainte, avec les subventions sans contrepartie dont elles doivent bénéficier… pourquoi pas… Et quand elles enfreignent la loi, on ne les sanctionne pas non plus ?
 L’affichage peut avoir des effets dévastateurs sur le paysage. Et il n’y a pas que les chiffres d’affaire, la consommation et le PIB ! Il y a aussi la douceur de vivre, l’environnement dégagé et pur, le calme, le repos des yeux et des oreilles, et de beaux paysages avec pour seule parure, la nature…
L’affichage peut avoir des effets dévastateurs sur le paysage. Et il n’y a pas que les chiffres d’affaire, la consommation et le PIB ! Il y a aussi la douceur de vivre, l’environnement dégagé et pur, le calme, le repos des yeux et des oreilles, et de beaux paysages avec pour seule parure, la nature…
Notre Pierre-Jean remarque qu’aucun afficheur n’a jamais installé de panneau dans son propre jardin. En revanche, chez les autres, ils savent faire et ils aiment.
Écoutons-le : « La publicité, dans son véritable sens, consiste simplement à rendre public, à faire connaître. Et même à ouvrir les yeux ». Non pas à polluer et à nous rendre débiles.
J’ajoute, pour revenir à l’objet de ce blogue, que ces panneaux illégaux sont aussi des repères à franglais, à formules attrape-nous, à jeunes femmes en maillot de bain pour vendre des voitures, à mensonges par omission et à contre-vérités.
À nous de montrer à ces marques et à ces publicitaires que leur invasion de nos espaces vitaux se retourne contre eux.
PS. Voir ici l’article de Radio Canada sur les succès de l’association à Grenoble :
http://paysagesdefrance.org/IMG/pdf/2015-03-07-radio-cana...
07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)
02/04/2015
Finding a lot of French terms in a French newspaper devoted to luxury
Retour sur mon Figaro...
Côté langage, c’est une autre affaire ! C’est un déluge de franglais !
Je vous fais l’inventaire, rapidement.
Dès l’édito : « concept store » masculin, un « powerdressing » masculin féminin parfaitement assumé, cette esthétique « boyish » à large spectre.
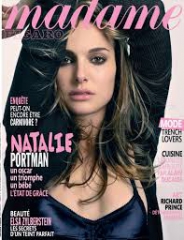 Et ensuite : le formidable « come back » de Valentino, le cortège de « looks », intemporel et « fashion », un « top » en soie, « Heritage Spirit Moonphase » (une montre Montblanc), le « brushing », la « pin-up », la « Fashion Week » à Paris, une silhouette en « trench » ceinturé, la fameuse dégaine « tomboy », sur les « catwalks » du printemps, l’œil noirci de « liner », cuir « stretch », un « dressing » pour pépés « glamour », les étapes des « fitting », les « sneakers » griffés et les chaussons de « skate », une « short list » des coiffures à privilégier, en « liftant » le visage, le « total look » chemise-pantalon large, la « French touch » de sa marque, des collections plus « luxury casual », son « bespoke denim », elle habille le fameux « boy next door », les influences « sportwear », un « sweat-shirt » Premier baiser,
Et ensuite : le formidable « come back » de Valentino, le cortège de « looks », intemporel et « fashion », un « top » en soie, « Heritage Spirit Moonphase » (une montre Montblanc), le « brushing », la « pin-up », la « Fashion Week » à Paris, une silhouette en « trench » ceinturé, la fameuse dégaine « tomboy », sur les « catwalks » du printemps, l’œil noirci de « liner », cuir « stretch », un « dressing » pour pépés « glamour », les étapes des « fitting », les « sneakers » griffés et les chaussons de « skate », une « short list » des coiffures à privilégier, en « liftant » le visage, le « total look » chemise-pantalon large, la « French touch » de sa marque, des collections plus « luxury casual », son « bespoke denim », elle habille le fameux « boy next door », les influences « sportwear », un « sweat-shirt » Premier baiser,
Je vous ai fait grâce des « smokings », « designers » et autres « leaders » ou « managers ». Trop galvaudés.
Et là, seules représailles possibles : arrêtez de vous habiller chez Dior, Chanel et Lansel !
07:30 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)
01/04/2015
Figaro et Figara
Comme j’ai cinq minutes – plus, ce serait péché – je feuillette le (gros) cahier « So Figaro », dont le titre aujourd’hui est « JEUX DE GENRE, la mode se décline au féminin comme au masculin ». Et d’aligner des pages et des pages, des photos et des photos, pour nous convaincre que le mieux du mieux aujourd’hui, c’est que les femmes s’habillent et se parfument comme les hommes et lycée de Versailles !
 Quoi ! le Figaro qui a milité, sauf erreur de ma part, contre le mariage pour tous et a soutenu la Manif’ pour tous, le Figaro qui a tiré à boulets rouges sur la théorie du genre (et heureusement) et les initiatives malheureuses de Mme Belkacem autour de ce thème, le même Figaro nous glorifie « le mélange des genres » pendant 35 pages, format A2 !
Quoi ! le Figaro qui a milité, sauf erreur de ma part, contre le mariage pour tous et a soutenu la Manif’ pour tous, le Figaro qui a tiré à boulets rouges sur la théorie du genre (et heureusement) et les initiatives malheureuses de Mme Belkacem autour de ce thème, le même Figaro nous glorifie « le mélange des genres » pendant 35 pages, format A2 !
Florilège :
« Jean Paul Gaultier, qui mettait déjà ses hommes en jupe il y a trente ans, lui… ». Remarquez que son prénom est écrit sans trait d’union, à l’américaine ; c’est chic, non ?
« … son étole en cachemire, sa crème de jour et son grand cabas de cuir, aussi joli au bras d’un homme après tout ». Honni soit qui mâle y pense.
« Sur les podiums des grandes maisons comme des jeunes créateurs, la mode est à l’unisexe. Masculin et féminin se brouillent, s’hybrident et captent l’air du temps », le tout sous la (grande) photo d’un jeune homme ( ?) avec un sac à main !
« Au creux de leur cou, ces femmes glissent des notes musclées, piochées au rayon masculin ».
Soyons honnête : comme souvent, le contenu du dossier n’est pas entièrement dans la tonalité – volontairement provocatrice – de son titre. Et, à l’intérieur, on trouve, deux articles très classiques : les « nouvelles » femmes tiennent à leur tenue hyper-féminine au travail, même quand il n’y a pas d’hommes dans les parages, donc pas de séduction à exercer ; et les « nouveaux » hommes représentent l’eldorado des vendeurs de produits de luxe, puisqu’ils s’y sont mis, eux aussi.
Beaucoup de théorie du genre pour rien, en fait : c’était uniquement un moyen d’attirer le lecteur pour qu’il voie les marques et soit attiré par les produits.
07:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)



