12/04/2015
Mademoiselle Albertine est partie
"Mademoiselle Albertine est partie !".
Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que cette séparation sans s'être revus était justement ce que je désirais, et, comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle me privait de réaliser (et auxquels la certitude de sa présence chez moi, pression de mon atmosphère morale, avait permis d'occuper le premier plan de mon âme, mais qui à la première nouvelle qu'Albertine était partie ne pouvaient même plus entrer en concurrence avec elle car ils s'étaient aussitôt évanouis), je m'étais trouvé subtil, j'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus.
Mais ces mots "Mademoiselle Albertine est partie" venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps ; il fallait la faire cesser immédiatement.
Cet extrait de La Recherche est moins connu que sa première phrase, mondialement célèbre, "Longtemps je me suis couché de bonne heure" ou que l'expérience de la madeleine ou que les tourments du coucher, et, si elle donne une idée de l'écriture de Marcel Proust - ses fameuses phrases imbriquées et interminables - , ce n'est pas la phrase la plus longue de l'œuvre.

Mais il en représente un tournant ; quand Albertine s'en va sans prévenir, c'est la souffrance irrépressible qui se déchaîne. Et le dénouement approche.
Oui, Albertine est partie, sans explication, et le soleil s'est levé pourtant...
Comprenne qui pourra.
08:50 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
10/04/2015
Palmarès
Comme dirait Régis Debray (dans "L'erreur de calcul"), aujourd'hui on note, on classe, on évalue tout, les statistiques sont reines ; et les sondages, n'en parlons pas.
Justement, le Figaro a fait demander à un échantillon représentatif de Français, quels étaient leurs écrivains passés et contemporains préférés.
Pour les anciens, pas de grosse surprise : on trouve sur le podium Hugo, Pagnol et Verne ; puis Zola, Maupassant et La Fontaine.
Je ne sais pas très bien ce que veut dire "préféré" : est-ce l'écrivain qu'on lit ou relit assidûment ? ou celui dont on pense qu'il a le plus apporté à la littérature ? Le plus facile à lire ou le plus révolutionnaire ?
Mystère… d'autant que l'on interroge un pays qui lit de moins en moins...
Bon, Hugo mis à part, "mes grands écrivains" arrivent 8ème (Camus), 12ème (Balzac), 24ème (Duras), 29ème, aïe, aïe, aïe (Proust), 31ème (Chateaubriand)… Mes goûts ne sont pas conformes, tant pis.
La 20ème place de Maurice Leblanc (le père d'Arsène Lupin, qui a enchanté mon enfance et que Jean d'O adore également…) m'a étonné et ravi, la 7ème d'Alexandre Dumas m'a fait plaisir (relisez, dans Ange Pitou, les dialogues à Versailles, ou bien la fin du Vicomte de Bragelonne, et vous verrez quel écrivain était Dumas).
Jetons un œil aux contemporains : Lévy (Marc), Jean d'O et Musso prennent les premières places ; en somme ceux dont on vante les nouveaux opus sur les panneaux de la SNCF et sur les bus parisiens.
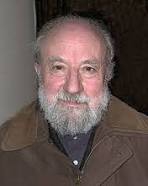
Et j'ai bien rigolé de voir les médailles en chocolat de Le Clézio (18ème) et Modiano (20ème), que j'ai éreintés dans ce blogue. Ainsi que la 30ème place de Michel Butor… quelqu'un le connaît donc encore ? N'était-ce pas un des compagnons de la bande des trois du Nouveau Roman, avec Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet, dans les années 50-60 ?
06:00 Publié dans Actualité et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
09/04/2015
Les conseilleurs ne sont pas les lecteurs
J'adore les conseils de lecture ; si quelqu'un (de recommandable !) vous confie sa passion pour un livre ou pour un auteur, ça vaut le coup d'aller y voir.
Un des mes amis du GRECO TdSI, YG, prof. à Montréal, m'a conseillé, dans le bus qui allait à Mirabelle, "Le siècle des lumières" d'Alejo Carpentier, je ne l'ai pas regretté. Il est vrai que je lui avais parlé de mon goût pour la littérature sud-américaine.
Plus improbable et plus chanceux est le cadeau de Noël de FP : "L'amour au temps du choléra" de Gabriel Garcia-Marquez ; ce fut une révélation ! Depuis, j'ai presque tout lu de ce prix Nobel de littérature.
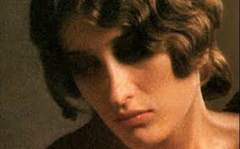 J'avais lu que, pour Anne Sinclair et pas mal d'autres gens connus, le chef d'œuvre ("absolu" comme ils disent, les intellos germanopratins), c'était "Belle du Seigneur" d'Albert Cohen. Je me suis précipité, c'en était un, effectivement.
J'avais lu que, pour Anne Sinclair et pas mal d'autres gens connus, le chef d'œuvre ("absolu" comme ils disent, les intellos germanopratins), c'était "Belle du Seigneur" d'Albert Cohen. Je me suis précipité, c'en était un, effectivement.
Et tant d'autres, y compris des "listes de lecture", des "bibliographies commentées" publiées par tel ou tel revue.
En fait, soyons honnête, j'enjolive le truc ! Combien de conseils n'ai-je pas suivi, parce que ce n'était pas le moment, parce que je détestais le genre (science-fiction, fantastique, policier…) ?
Mais quand c'est le moment, quand c'est le genre… je n'hésite pas.
C'est vous dire que j'ai suivi les conseils de lecture de l'article sur la littérature qui soigne, dont je vous ai parlé.
Et j'ai donc attaqué récemment l'un de ces livres conseillés. Voici ce que racontent les premières pages (florilège) :
"Tout ce qui a été étalonné dans la dépendance première tend à refluer vers l'empreinte qui l'attire sans finir". Non seulement j'aimerais comprendre ce genre de phrase mais j'aimerais aussi savoir l'écrire. C'est tellement profond que l'on s'y noie.
"Chacun doit franchir cette passe étrange où tout ce qui était découverte au fond de l'âme découvre qu'il ne découvrira plus".
"Passer de la passion à l'amour est une ordalie".
Et ainsi de suite… je ne dis pas que ça ne va pas être passionnant in fine, je ne sais pas encore, je m'accroche. J'ai le mauvais souvenir de "Femmes", que, malgré un titre alléchant, j'ai abandonné au bout de 50 pages, faute de ponctuation.
Le livre est conseillé à ceux qui ont du mal à triompher d'une rupture douloureuse. Voyons.
Je vous en reparlerai.
PS. Ordalie, d'après le Dictionnaire Hachette de notre temps : "épreuve judiciaire dont l'issue, réputée dépendre de Dieu ou d'une puissance surnaturelle, établit la culpabilité ou l'innocence d'un individu".
11:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



