07/04/2015
Lectures (VII)
Avant 3M, Proust, et avant Proust, Balzac, et même Pascal…
Je m’explique : 3M a inventé ces rectangles collants (mais pas trop, c’est là que c’est génial), qui, sous le doux nom de « post-it », font la joie des bureaux français depuis dix ou quinze ans, en permettant de « coller provisoirement » des ajouts ou des remarques sur un document papier, de les annoter en un mot. C’est une prouesse physico-chimique mais c’est tout car on annote depuis toujours, les écrivains n’étant pas les derniers à raturer, biffer, surcharger, ajouter, corriger…
 La palme revient au premier d’entre eux, le maître de la littérature francophone du XXè siècle, Marcel Proust. Il est célèbre, parmi d’autres innombrables traits, pour avoir usé et abusé de ses fameuses « paperolles », petits bouts de papier qu’il collait à tous les endroits de ses épreuves qu’il désirait corriger.
La palme revient au premier d’entre eux, le maître de la littérature francophone du XXè siècle, Marcel Proust. Il est célèbre, parmi d’autres innombrables traits, pour avoir usé et abusé de ses fameuses « paperolles », petits bouts de papier qu’il collait à tous les endroits de ses épreuves qu’il désirait corriger.
Trois siècles avant, il paraît que Pascal avait mis au point un système équivalent. Et entre les deux, Balzac, ce forçat des lettres.
Michel Crépu recopie page 200 de son bouquin « Lectures » un portrait de Balzac au travail, dû à Théophile Gautier ; le voici.
« Quand il avait longtemps porté et vécu un sujet, d’une écriture rapide, heurtée, pochée, presque hiéroglyphique, il traçait une espèce de scénario en quelques pages, qu’il envoyait à l’imprimerie, d’où elles revenaient en placards, c’est-à-dire en colonnes isolées au milieu de larges feuilles.
Il lisait attentivement ces placards, qui donnaient déjà à son embryon d’œuvre ce caractère impersonnel que n’a pas le manuscrit, et il appliquait à cette ébauche la haute faculté critique qu’il possédait, comme s’il se fût agi d’un autre. Il opérait sur quelque chose ; s’approuvant ou se désapprouvant, il maintenait ou corrigeait, mais surtout ajoutait.
Des lignes partant du commencement, du milieu ou de la fin des phrases, se dirigeaient vers les marges à droite, à gauche, en haut, en bas, conduisant à des développements, à des intercalations, à des incises, à des épithètes, à des adverbes.
Au bout de quelques heures de travail, on eût dit le bouquet d’un feu d’artifice dessiné par un enfant. Du texte primitif partaient des fusées de style qui éclataient de toutes parts. Puis c’étaient des croix simples, des croix recroisetées comme celles du blason, des étoiles, des soleils, des chiffres arabes ou romains, des lettres grecques ou françaises, tous les signes imaginables de renvois qui venaient se mêler aux ratures… ».
Cela rendait fous les typographes, qui se repassaient les placards, « ne voulant pas faire chacun plus d’une heure de Balzac ».
Michel Crépu conclut : « S’ils avaient su, les pauvres, ce qui les attendait avec Proust ».
07:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
30/03/2015
Lectures (VI)
Michel Crépu a lu l’Africain de J.-M.G. Le Clézio, « évocation simple d’une enfance africaine, puis des retrouvailles (avec son père, médecin anglais), à la fin ». Il a aimé : « Chef d’œuvre évident ».
Il cite et je recopie : « Vers le nord et l’est, je pouvais voir la grande plaine fauve semée de termitières géantes, coupée de ruisseaux et de marécages, et le début de la forêt, les bosquets de géants, irokos, okoumés, le tout recouvert par un ciel immense, une voûte de bleu cru où brûlait le soleil, et qu’envahissaient, chaque après-midi, des nuages porteurs d’orage ».
Et il conclut « Le vrai Le Clézio est là ».
Ça me donne envie de le lire, ce livre que j’ai dans ma bibliothèque depuis longtemps, chiné ici ou là.
En écrivant, j’écoute « The secrets of the dead sea » d’Érik Truffaz, c’est tout à fait l’ambiance qu’il me fallait.
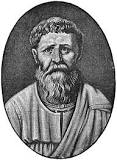 Au détour de la page 177, il déboule tout d’un coup sur Saint Augustin. C’est aussi le moment où je lâche prise ; je vous avais prévenu dans le premier billet « Lectures », il est terrible côté philosophie !
Au détour de la page 177, il déboule tout d’un coup sur Saint Augustin. C’est aussi le moment où je lâche prise ; je vous avais prévenu dans le premier billet « Lectures », il est terrible côté philosophie !
Observant une pause avec Plotin, il retourne à « certaines pages des Confessions qu’il aime particulièrement ». Et ça, ça ne serait rien ; il possède plusieurs traductions et il les compare !
Il faut absolument que je vous donne quelques-uns des morceaux de bravoure de ces pages transcendantes (justement, je suis passé à « Time will tell » de « Tower of power », en public, et ça plane).
« Naturellement, le tutoiement (ou vouvoiement) est, si je puis dire, la christian touch des Confessions, tout ce qui distingue radicalement Augustin du Plotin de ses années néoplatoniciennes ». Si quelqu’un pouvait m’expliquer…
« On ne saurait mieux définir la lectio divina de la grande tradition monastique dont parle le bénédictin Jean Leclercq dans son livre «L’amour des lettres et le désir de Dieu ». J’l’ai pas lu.
Plus loin, je lis « insistance sur la nécessité d’apprendre les finesses de la langue, sa texture, sa matérialité même, pour entrer à l’intérieur de l’Écriture. Pas de contemplation digne de ce nom sans une relation d’intimité à la vie du langage, sans un savoir rhétorique ». Là, ça me parle plus ; ainsi donc, les efforts que je fais pour bien parler et écrire le français pourraient me servir un jour à quelque chose…
Je termine ce billet accompagné du Chicago de « Saturday in the park », et ça suffit à mon bonheur pour l’instant.
07:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
19/03/2015
Lectures (V)
Donc, un matin d’avril 2004, un mardi, M. Crépu décide « solennellement » de relire tout Balzac.
Voici l’ambiance : « Deux heures du matin, petit vent dans la cheminée, froid sibérien dans la cour » !
« Mise en jambe avec Louis Lambert, La maison du chat qui pelote, puis haute mer immédiate avec le Lys dans la vallée. Le Lys, ce sont les Hauts de Hurlevent sur les bords de l’Indre, un ouragan en Touraine ».

Et voici comment il rend l’impression que lui donne cette lecture : « La violence du paysage qui entoure le château de Clochegourde comme une frondaison énorme. Le paysage tourangeau si calme, si doux, emporté par une lame de fond. Au centre, il y a ce petit caillou blanc où vivent le comte acariâtre et la comtesse en chrétienne romantique, martyre et folle amoureuse, les enfants maladifs, Félix tel un hanneton détaché de Paris, etc. : le vertige sentimental est compris à l’intérieur d’un vertige végétal ».
Chapeau bas, non ?
07:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



