31/01/2015
Les filles de rêve ne sont pas décevantes (V)
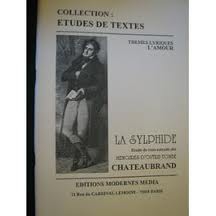 On sent que A. Corbin écarte la sylphide de Chateaubriand car elle naît d’une confession un peu psychiatrique et non pas d’une création poétique ou romanesque. C’est très subtil, réfléchissez bien. Elle aussi se retrouve entre Diane et Vénus.
On sent que A. Corbin écarte la sylphide de Chateaubriand car elle naît d’une confession un peu psychiatrique et non pas d’une création poétique ou romanesque. C’est très subtil, réfléchissez bien. Elle aussi se retrouve entre Diane et Vénus.
Graziella fut réédité près de « quatre-vingts fois » (sic). Encore un qui n’a pas lu tous les billets de ce blogue. On lit aussi « Pour avoir considéré la jeune fille transfigurée par les larmes, l’image de Graziella… » ; c’est une phrase qui n’a pas été relue. Foin de la belle écriture, A. Corbin inclut cette égérie de Lamartine dans les filles de rêve ; après tout, c’est lui le patron !
Aurélia (de Gérard de Nerval) subit le même sort que la sylphide car elle ressortit plus de la rêverie que du rêve (sic). Historiquement, sa figure coïncide avec la dissolution progressive de la figure (de la fille de rêve), à partir du milieu du XIXè siècle.
Avec une exception, célébrissime : Yvonne de Galais. Elle a certains traits de Diane et clôt la cohorte, « dont on aura, je pense, saisi la cohérence ».
On peut rêver…
08:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
30/01/2015
Les filles de rêve ne sont pas décevantes (IV)
Quant on arrive à Juliette, on apprend un mot rare : reviviscence (qui me fait penser à l’anglais revival) et on comprend que, disparaissant tragiquement, elle ne peut être acceptée dans la « cohorte » et rejoint l’autre camp, sœur d’infortune de Chimène, Phèdre, Hermione, Pauline, Bérénice, Andromaque, Iphigénie… (si j’ai bien compris). Bizarrerie, la fiancée d’Hippolyte, Aricie, aurait été repêchée par A. Corbin si Racine avait davantage développé sa figure. Pour une fois que c’est pas la faute à Voltaire !
Ophélie, « à la fois virginale et subtilement érotique, figure une fille de rêve intensément mystérieuse ; rendue inaccessible par son égarement et par sa nature même ». Et de trois.

La Belle au bois dormant de Charles Perrault est « un modèle de fille de rêve porteur d’un bonheur en rupture avec les malheurs ou la mort des précédentes… et lui a conféré une grande extension sociale ».

Le verdict sur Paméla n’est pas clair. Il semble qu’elle en soit mais, pour la première fois, avec l’âme sensible. Ça n’a pas l’air d’être rédhibitoire, bien au contraire. A. Corbin en profite pour glisser quelques formules bancales comme « l’effraction oculaire » ou « l’ouvrage de second rayon ». Passons.
Charlotte (celle de Werther et donc de Goethe) est une fille de rêve, bien que pas du tout évanescente.
Virginie aussi ! C’est le grand amour de Paul, raconté par Bernardin de Saint Pierre).
08:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
29/01/2015
Les filles de rêve ne sont pas décevantes (III)
Concernant Iseut « Gardons-nous toutefois de surestimer cette figure de rêve qui demeure, somme toute, ambiguë » nous prévient A. Corbin. Mais alors, il n’y aurait que Diane comme vraie fille de rêve ? Les autres, elles font de la figuration, pour remplir 162 pages ? On croyait qu’il nous les avait sélectionnées, les vraies, les incontestables… et elles nous filent entre les doigts, chapitre après chapitre !
À propos de ces filles, savez-vous qu’on peut parler de leurs « appas » (ce qui séduit, ce qui charme et, dans un sens vieilli, « formes épanouies du corps féminin qui éveillent le désir » d’après le Hachette de 1991), alors que la pâture qui attire les animaux que l’on veut prendre s’appelle l’appât ? Malheureusement, l’appât est aussi ce qui exerce une attraction sur quelqu’un…
 Cela m’amène à Béatrice, celle de Dante (fin du XIIIè siècle), qui, nous dit A. Corbin, est « le modèle absolu de la fille de rêve ». Mamma mia, en voici une autre ! On a donc à ce stade la matrice essentielle et le modèle absolu. Voyons la suite…
Cela m’amène à Béatrice, celle de Dante (fin du XIIIè siècle), qui, nous dit A. Corbin, est « le modèle absolu de la fille de rêve ». Mamma mia, en voici une autre ! On a donc à ce stade la matrice essentielle et le modèle absolu. Voyons la suite…
Manque de chance pour elle, « pour incarner totalement la fille de rêve, (il) manque à Laure (celle de Pétrarque) la virginité ». En effet, elle a eu la mauvaise idée de se marier. Lot de consolation, d’après A. Corbin, « elle ne saurait paraître fille de Vénus ». Alors quelle est-elle donc ?
J’ai déjà évoqué Dulcinée ; je n’y reviens pas car A. Corbin, dans le chapitre qui lui est consacré, parle surtout de Don Quichotte. Pauvre fille… Il abuse également de néologismes : proto-sexologie, pathologiser…
08:00 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



