18/11/2015
Mes amis, que reste-t-i(l) à ce dauphin si genti(l) ?
Et ça continue comme ceci (chacun a chanté, étant enfant, le Carillon de Vendôme) :
"Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry…"

Tout cela pour se poser la question suivante. Faut-il dire et écrire, par exemple, "les étendues qu'il reste à découvrir" ou bien "les étendues qui restent à découvrir" ?
L'oreille ne fait guère la différence, c'est pour cela que la chanson utilise la rime en "i".
Cela m'intriguait depuis longtemps et je m'apprêtais à soumettre le point à l'Académie via son site internet (rubrique Dites-Ne dites pas) quand j'ai découvert la "solution" dans le "Valeurs actuelles" du 12 novembre 2015, sous la plume du grammairien Philippe Barthelet, que mes lecteurs connaissent. Voici ce qu'il en dit.
"Les deux, selon que l'on veut mettre l'accent sur les étendues elles-mêmes ou sur l'action de les découvrir".
Il a fait des recherches dans les dictionnaires : Littré donne "la chose qui reste à faire", l'Académie "voilà ce qui reste du dîner" et le célèbre Grévisse est d'avis que "avec rester, on emploie qu'il ou qui, à son choix". Mais Jules Renard écrit dans son Journal "Tous les livres qu'il me reste à lire", tandis qu'un professeur soupirera à propos "de toutes les copies qui me restent à corriger".
Faut-il dire "le temps qu'il me reste ?" ou bien "le temps qui me reste ?".
C'est incertain, même si, dans l'absolu, il faudrait se demander si le temps en question peut être compté ou non…, d'où l'emploi du "personnel" ou de "l'impersonnel".
Bref, chacun fera au mieux, selon sa sensibilité ou ses habitudes.
Mais savoir qu'on est libre, n'est-ce pas ce qui plaît le plus aux Français ?
07:31 Publié dans Histoire et langue française, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
11/11/2015
O comme Pivot, comme "mots", comme orthographe
Voici ce qu'écrit Bernard Pivot dans "Les mots de ma vie" (Albin Michel - Plon, 2011) à l'entrée "Orthographe" :
"… je suis ce ramoneur qui s'étonne que leurs rédacteurs fassent des fautes d'orthographe sur des enseignes, dans des publicités, sur la page d'accueil des sites internet, sur des cartes de restaurant, etc. Je m'indigne qu'elles y restent, soit parce que personne ne les a remarquées, soit parce qu'on n'a pas voulu rectifier, cela ayant été jugé sans importance".
Je pense à la jolie Loréna, qui disait "Il y a quand même des choses plus graves", à propos, non pas de l'orthographe, mais du franglais. Il y a toujours "plus grave" quand on ne s'intéresse pas à un sujet ou quand il ne nous touche pas.
Quand il étudiait au Centre de formation des journalistes, il y avait des exercices de détection et de correction de coquilles : "Un professeur distribuait à chaque élève la même page d'un journal. Le jeu consistant à déceler le plus vite possible la coquille, la faute d'orthographe ou de français contenue dans les surtitres, les titres, les sous-titres ou les intertitres". Je ne sais pas si cet exercice a perduré. Mais le fait qu'il ait existé prouve qu'à cette époque, il y avait déjà des coquilles dans les journaux, puisque les élèves en cherchaient et en trouvaient !
Pivot dit ensuite : "(La célèbre dictée) m'a valu la reconnaissance et même l'affection de beaucoup de professeurs de français des écoles et des collèges, et l'inimitié de certains pontes de l'Éducation nationale qui étaient hostiles à cet exercice jugé vieillot, incompatible avec un enseignement moderne dont ils s'efforçaient de l'expulser".
"Mais l'on est bien obligé de constater qu'elle (l'orthographe) ne jouit plus du prestige qui était le sien et qu'elle est tenue aujourd'hui par beaucoup de gens, surtout les jeunes, pour qualité négligeable, superflue. Autrefois, cinq fautes à la dictée vous privaient du certificat d'études, même si votre devoir de maths était parfait".
"Le malheur veut que, de l'orthographe valeur quasi sacrée, nous soyons passés en quelques décennies à l'orthographe considérée comme valeur facultative et ornementale. Nous avons versé d'un excès dans un autre".
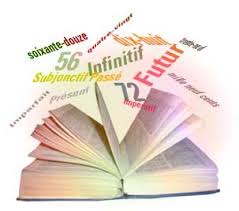
C'est aussi mon avis. Les personnes auxquelles nous faisons remarquer une entorse à l'orthographe, si elles n'en conçoivent pas de la honte et de la rancune, nous reprochent de considérer comme primordiaux des détails sans importance. Elles se trompent car nous ne nous trompons pas dans la hiérarchie des valeurs : le fond est bien le plus important… mais la forme doit d'abord être correcte afin qu'on l'apprécie à sa juste valeur.
08:13 Publié dans Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)
10/11/2015
Sur quelques points de grammaire et de vocabulaire… (II)
Le livre de M. Courault "Manuel pratique de l'art d'écrire", paru en 1956, est une mine pour qui s'intéresse au français et à la correction de la langue, écrite en l'occurrence.
Cette année-là, il déplorait déjà "le recul rapide de la conjugaison du 3ème groupe au profit de néologismes barbares du premier ; le discrédit du subjonctif, même au présent ; l'ignorance des ressources offertes par le jeu des mots et des temps à l'expression concise de nuances fines ; la disparition du passé simple, l'inaptitude croissante à l'intelligence, donc à l'emploi, d'une construction inversée, d'une ellipse un peu vigoureuse, etc.".
Et encore : "Indigence et perversion du vocabulaire, recul des connaissances grammaticales et syntactiques".
"Nombre d'adolescents déjà tiennent le livre pour un moyen de culture désuet". Et dire qu'à l'époque, la télévision balbutiait et peu de familles possédaient un téléviseur. Pas de jeux vidéos, pas de téléphones mobiles, pas d'internet !
"Le dévergondage verbal de la Radio marque d'une estampille officielle de grossiers solécismes et des barbarismes offensants".
Bigre !
Le coup porté à la langue ne date pas d'hier. On le savait, évidemment ; mais la vitesse de propagation du mal a dû augmenté, malheureusement.
Mais, pour revenir à M. Courault, soulignons qu'il ne se contente pas de déplorer ; il a agi, à travers son livre, avec des convictions et une "méthode" : d'abord les commentaires cinglants du professeur ne suffisent pas à faire progresser ses élèves ; ils faut qu'il apprennent à connaître pour ensuite reconnaître leurs fautes ; ensuite, les exemples tirés des grands auteurs de la littérature les aideront à comprendre les évolutions de la langue et leur responsabilité quant au maintien de la "bonne langue" ; le gros du travail reviendra à l'élève, qui aura de nombreux exercices à faire, avec recours fréquent au dictionnaire ; la correction de la langue est une vertu négative, il faut y ajouter les mérites de la forme (le style…).
Et de commencer par les barbarismes : forger un mot nouveau sans nécessité ou employer un terme existant dans un sens contraire à tous les usages. L'origine peut en être une fausse étymologie, la paronymie (termes présentant des ressemblances de forme, comme rebattre les oreilles / rabattre sa prétention), la méconnaissance d'une forme ancienne (l'affaire est dans le lac / l'oiseau est pris dans un lacs) et l'ignorance pure (aéroplane / aréopage).
Le premier chapitre se termine par les néologismes : créer un mot nouveau pour désigner une chose ou une idée nouvelles. "Tout mot d'une langue a commencé par être un néologisme". Et même, "des termes communément employés par la langue parlée actuelle ont été d'abord des intrus mal accueillis par les grammairiens et les linguistes : exactitude fut, au XVIIème siècle qualifié de monstre ; Voltaire protesta contre égaliser ; l'académicien Royer-Collard dit, à propos du verbe baser : s'il entre, je sors".
Dans les années 70, les professeurs de français s'insurgeaient encore contre baser et imposaient l'usage de fonder. On peut sans doute donner le même destin à finaliser...
Victor Hugo a créé le mot moustachu, Flaubert le mot autopsier...

PS. René Girard, philosophe, anthropologue des désirs et de la violence, spécialiste de littérature et des religions, académicien français, est décédé le 5 novembre 2015 à Stanford (Californie) à 91 ans.
07:30 Publié dans Franglais et incorrections diverses, Règles du français et de l'écriture | Lien permanent | Commentaires (0)



