13/02/2015
Il ou elle-ment
L'adverbe a la cote, semble-t-il...
Je connaissais le fameux "possiblement" de Jacques Brel, qui n'est pas dans mes dictionnaires et dont je ne sais toujours pas s'il est licence poétique ou wallonisme.
Il y a les sempiternelles réponses "absolument", "carrément", "totalement", aux questions "ça va ?" ou "tu es partant ?".
Quand j'étais enfant, dans les Vosges, on disait : "Elle est rudement belle".
Récemment (!), j'ai noté, dans la bouche d'Hélène Jouan (France Inter, le téléphone sonne, 11 février 2015), le mot "urgemment", pour dire "de façon urgente". Toujours cette obsession d'aller vite...
Il est vrai qu'a contrario, on entend à longueur de journée l'adjectif "juste" utilisé, comme un adverbe, à la place de "tout simplement".
Voilà, c'était tout bêtement un coup de projecteur (et non pas un focus !) sur les adverbes dans le langage quotidien, qui demande à être enrichi. Je compte sur vous.
07:30 Publié dans Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)
12/02/2015
Écrivains contemporains de langue française : Michel Déon (XIII)
Pour moi, il y a trois Michel Déon écrivain : l’auteur primé et célèbre des Poneys sauvages, du Taxi mauve et du Jeune homme vert ; l’auteur prolifique de romans ou de journaux de voyage (Je vous écris d’Italie, Je ne veux jamais l’oublier…) ; le jeune « Hussard » qui habitait dans les îles grecques et qui a raconté cette période de sa vie dans Le rendez-vous de Patmos et le Balcon de Spetsaï.
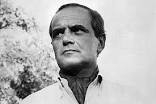 Malheureusement pour moi et pour lui, je l’ai lu dans l’autre sens : j’ai été emballé par ses nouvelles de la mer Égée, après m’être passionné pour la Grèce, son ciel bleu, ses témoignages architecturaux des débuts de la démocratie, la musique de Mikis Théodorakis et les « Songs from a room » de Leonard Cohen, ses maisons blanches et son régime crétois.
Malheureusement pour moi et pour lui, je l’ai lu dans l’autre sens : j’ai été emballé par ses nouvelles de la mer Égée, après m’être passionné pour la Grèce, son ciel bleu, ses témoignages architecturaux des débuts de la démocratie, la musique de Mikis Théodorakis et les « Songs from a room » de Leonard Cohen, ses maisons blanches et son régime crétois.
Beaucoup plus tard, j’ai repris le filon « Déon »… et je suis tombé de haut avec ses bavardages de dilettante et les intrigues improbables de sa deuxième manière. Malgré son titre prometteur, « Je ne veux jamais l’oublier » (1950), qui raconte le grand amour d’un dandy parisien à Venise, Florence et Paris, est superficiel, artificiel, sans profondeur. « Un souvenir » (1990), malgré un argument attirant (retrouver son premier amour en Angleterre, au moment des bilans) est lui aussi écrit dans un style relâché. L’idée du dialogue avec l’adolescent qu’était alors le narrateur n’est pas bonne ; le téléfilm (avec Daniel Prévost), émouvant, a fait bien mieux, ce qui est tout de même très rare pour un film ; il a d’ailleurs changé la fin. Pourquoi ?
Et si c’est pour nous refaire le coup de « À nous les petites Anglaises », autant aller voir du côté d’Alain Fleisher et de son « Amant en culottes courtes », débridé et vraiment érotique.
J’ai lu, je crois, « Je vous écris d’Italie » mais n’en ai pas gardé trace…
Comme quoi la vaccination, ça ne marche pas : je repique (…) dans le Déon de « Tout l’amour du monde » (1955) quelques années plus tard. Bis repetita : dandysme, cosmopolitisme, superficialité, avec beaucoup de culture autour. Il se place en disciple de Paul Morand qui, soit dit en passant, a frôlé la collaboration. On lit néanmoins quelques belles pages, et surtout les deux derniers chapitres sur Bellagio et sur la Grèce, lyriques et prémonitoires. La fin, très belle, donne envie de garder le livre, tout de même…
Enfin, dernier Déon en date dans mon parcours de lecture, « La montée du soir » (1987). Là, il essaie de mettre du style mais c’est raté… c’est plat et sans souffle, malgré quelques touches qui se veulent poétiques.Le scénario lui-même est peu crédible : une femme distante mais consentante, qui n’est pas sûre d’aimer les hommes, une maîtresse qui part sans crier gare avec le mari d’une amie considéré comme nul, des allers et retours pour retrouver sa canne de marche tombée dans un ravin… Ça doit globalement être pensé comme une métaphore de la vieillesse (« quand tout nous abandonne… ») mais dans le genre, Léo Ferré a fait mille fois mieux (« Avec le temps »).
Reste ses livres qui ont reçu des prix, ceux de la période irlandaise et Académie française… désolé, je ne les ai pas lus… ça reste à faire, pour pouvoir conclure. Mais d’ores et déjà, dans la famille « écrivains mineurs », à tout prendre, je préfère mon Jean d’O.
Ah, j’oubliais, qui est-il ?
Voici ce qu’en dit Wikipedia :
« Édouard Michel, dit Michel Déon, né à Paris le 4 août 1919, est un écrivain, romancier, dramaturge, et académicien français. Il a tout d'abord adopté Michel Déon comme nom de plume avant d'en faire son patronyme légal (autorisation accordée par le Conseil d'État du 19 octobre 1965). Il est généralement rattaché au mouvement des « Hussards ». Après une enfance passée entre le 16e arrondissement de Paris et la Côte d'Azur (sic), il fait des études de droit tout en songeant déjà à une carrière littéraire ». À 95 ans, il est vice-doyen de l’Académie française.
08:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
11/02/2015
Austérité, quand tu nous tiens...
L'austérité est clairement le sort de la Grèce, et depuis cinq ans… Est-elle le sort de la France ?
On se chamaille là-dessus. Certains ne voient pas le rapport entre l'austérité (qu'ils nient) et, par exemple, la demande de la Cour des Comptes au gouvernement, de diminuer les dépenses publiques, en particulier dans les Services publics...
En tous cas, l'austérité a accouché d'un adjectif : austéritaire.
J'ai entendu Jean-Luc Mélenchon l'utiliser à la télévision, juste après la victoire de Syriza. Je l'ai lu également dans le Marianne du 9 janvier 2015, sous la plume d'Alexis Lacroix : "Ces trente dernières années, la cage d'acier globalitaire a concouru à asphyxier les plus fragiles, en les comprimant dans la camisole austéritaire, et à les désorienter…". Vous remarquerez que, pour le même prix, on en a eu deux : "globalitaire" était gratuit.
ICB, dans un message personnel, s'offusquait de ce néologisme ; bien sûr le terme n'est pas (encore) dans les dictionnaires ; et le mot "austérité", dans les dictionnaires, se réfère au caractère "austère", à la rigueur morale.
Mais, bon, sans jouer à l'Académicien ni au lexicologue, que je ne suis pas, je ne suis pas hostile à ce genre de nouveauté dans la langue : on a bien "velléité" et "velléitaire" ! La construction de l'adjectif ne semble pas aberrante ; et son apparition traduit bien que le fait que la langue sert à exprimer les préoccupations du moment. Le retour de la croissance (?) signera peut-être l'oubli du nouvel adjectif...
C'était bien le point de vue d'Étiemble que disait que duffle-coat disparaîtrait avec le vêtement. Manque de chance, le vêtement est revenu dans les rayons, après quarante ans d'absence.
À mon avis, malheureusement, "austéritaire" va faire son trou (dans les dépenses publiques)...
08:39 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)



