14/03/2016
Les pierres sauvages (Fernand Pouillon) : critique
Je crois que c'est dans l'émission de François Busnel consacrée aux livres préférés des Français que j'ai entendu parler de ce livre, cité comme "en passant" par l'un de ses invités, François Cluzel peut-être ou Robin Renucci. Voir mon billet du 12 décembre 2014 (comme le temps passe vite…).
J'ai donc acheté ce livre, en format Poche, avec d'autres qui étaient recommandés par tel ou tel, et je l'ai lu.

Quel enchantement !
Il se trouve que je connaissais, pour l'avoir visité dans les années 2000, le lieu qui est le sujet du roman : l'abbaye du Thoronet, en Provence. Sa construction, au XIIème siècle, est confiée par l'abbé de Notre-Dame de Florielle à un maître d'œuvre expérimenté dont F. Pouillon imagine le journal.
Sa façon de rendre l'ambiance du Moyen-Âge, la foi de ces moines cisterciens et la difficulté de leur mission, est impressionnante, et son style admirable. J'ai noté un seul anachronisme, au début du récit, quand il écrit qu'en arrivant au Thoronet le moine se sent "en vacances"… Sinon, tout au long de ces 250 pages, pas une seule phrase bancale ni faute d'orthographe ; au lieu de cela, une écriture pittoresque, précise, elliptique, riche… un régal. Il y a du Giono et aussi du Eco dans ce roman.
"Réguliers, les sabots du cheval arabe frappent le chemin. En empruntant la sente, les pas hésitent un instant, prennent de l'élan, se précipitent, gravissent le talus. Les fers raclent terre et pierrailles sous l'effort des jarrets. Les sons parviennent amortis dans la traversée des taillis, s'éclaircissent après le premier lacet. L'écho double le petit trot dans la descente. Nouvel élan, nouvel effort, c'est le passage de la source. Silence : le remblai détrempé absorbe les sabots alourdis. Puis les pas irréguliers escaladent la dernière côte, imprécis ils abordent la ligne droite à grands degrés, plus rapides, scandés, arrivent sur l'aire, s'approchent, s'arrêtent. Glissement, cliquetis, frottements de cuirs, piaffements secs et espacés de chasse-mouches, ronflement de naseaux. Anneaux, mors, gourmettes, mouvements vifs d'encolure, tintinnabulent en sons clairs ou éteints. L'homme engourdi traîne ses jambes maladroites. la porte s'ouvre, le cavalier apparaît décapité, le cou plié vers l'épaule, le visage se penche, regard clair, teint mat : Jacques, chevalier du Temple, entre".
 Fernand Pouillon était lui-même architecte et s'était enthousiasmé, comme Le Corbusier, pour cette abbaye abandonnée à la Révolution mais restaurée au titre des Monuments historiques dès 1840.
Fernand Pouillon était lui-même architecte et s'était enthousiasmé, comme Le Corbusier, pour cette abbaye abandonnée à la Révolution mais restaurée au titre des Monuments historiques dès 1840.
Il multiplie, naturellement, les détails sur les métiers, sur les corporations, les outils et le travail des matériaux.
Il montre la passion du maître d'œuvre pour les pierres extraites de la carrière toute proche, souvent de mauvais qualité, mais qu'il utilise selon le vœu de simplicité extrême de Saint Bernard (la Règle) et qu'il remplit d'une fonction quasi-mystique. C'est fascinant.
Enfin, et ce n'est pas le moindre intérêt de ce roman, c'est aussi un véritable manuel de gestion de projet, qui en aborde tous les aspects : relation avec la maîtrise d'ouvrage, planification, gestion des risques, réactivité, gestion des hommes… Impressionnant.
"Chantier, dernier chantier, tu me les rappelles tous. Je vous revois, fantômes dans la brume, paisibles sous la neige. Vous apparaissez roses, irréels, dans l'aube naissante : laudes.

Purs dans le vrai soleil du matin : prime, tierce.
Tristes, fatigués, poussiéreux après-midi : sexte.
Mornes, quand les hommes vous quittent après none.
Sereins dans la lumière d'or qui étire ses ombres à l'infini : vêpres.
Aplatis par le crépuscule, les volumes fondent, s'habillent d'un gris uniforme d'adieu : complies.
Matines : réveils de lune blafards, hagards comme nous, simplifiés à l'extrême ; ils sont clarté et néant de l'ombre, pareille à la nuit, sans matière, en couleur de linceul".
"Les pierres sauvages" est un livre qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin, que l'on garde pour le relire et que l'on recommande.
07:30 Publié dans Écrivains, Histoire et langue française, Littérature, Livre, Pouillon Fernand, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)
10/03/2016
La Francophonie, c'est pas ce que vous croyez (épilogue)
Vous l'avez compris, la Francophonie (avec un F majuscule) ne consiste pas essentiellement à préserver le français tel qu'il est aujourd'hui à Paris ni à essayer de faire parler français le plus de gens possible dans le monde. Son dessein est bien plus vaste et dépasse d'ailleurs la question d'une seule langue : pour promouvoir la diversité culturelle menacée par la mondialisation (qui impose le globish partout), elle défend le plurilinguisme. Par exemple, on l'a vu, en développant en Afrique l'enseignement simultané du français et d'une langue locale.
Voici une autre initiative, qui résonne particulièrement à mon oreille : l'intercompréhension.
Il s'agit de s'exprimer dans sa langue maternelle, tout en comprenant ses interlocuteurs qui font de même, sachant que tous s'expriment dans l'une des langues romanes (français, espagnol, italien, portugais, roumain et catalan). Il s'agirait ainsi de rassembler une communauté d'un milliard de locuteurs dans le monde.
Sur le plan stratégique, c'est une façon habile de se rapprocher de nos cousins linguistiques pour endiguer la marée de l'anglais qui les marginalise tout autant que nous, au lieu de lutter chacun dans son coin (la Francophonie, l'espace hispanophone, etc.). Qui se ressemble s'assemble.
Sur le plan opérationnel, c'est réaliste car toutes ces langues sont issues du latin et on peut donc penser qu'il est assez facile d'acquérir de bonnes notions dans les langues parentes.
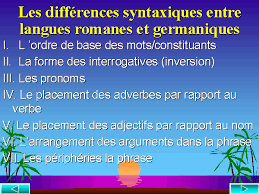
L'Organisation internationale de la Francophonie lance ces jours-ci un CLOM sur le sujet, destiné aux enseignants francophones.
Cette idée me rappelle ce que je connaissais sous le nom de "méthode canadienne" : dans ce pays bilingue, chacun était censé pouvoir parler sa langue maternelle (anglais ou français). Mais avec l'intercompréhension en langues romanes, on introduit une autre communauté, celle des langues issues directement du latin.
En somme, on reconstruit une sorte de République des Lettres, à l'envers (des langues nationales vers le latin) et destinée, non plus aux seuls lettrés, mais à tous...
Et on démonte aussi un (petit) pan de la tour de Babel !
En cas de succès, imaginez une réunion européenne dans laquelle les représentants de la France, de l'Espagne, de l'Italie, du Portugal et de la Roumanie se comprendraient directement, sans passer par le globish...
PS. Je me demande ce que pensent nos amis espagnols de Madrid de l'inclusion du catalan dans la liste de ces langues romanes, alors que le corse et l'occitan, par exemple, n'y sont pas...
10:52 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie, Histoire et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)
07/03/2016
La Francophonie, c'est pas ce que vous croyez (V et fin)
Huitième idée reçue : le français serait en perdition dans le monde
Pas du tout ! Bien sûr, le français n'est pas comme l'anglais LA langue de communication mondiale… Mais sa place est encore enviable. Jugez-en.
L'Organisation des Nations Unies a six langues de travail : l'anglais et le français y cohabitent avec le chinois, le russe, l'espagnol, l'arabe et le portugais. Et les pays francophones y pèsent le tiers.
Le français est langue officielle de 29 pays dans le monde, en plus d'être langue nationale, langue d'enseignement ou langue étrangère enseignée dans de nombreux autres. C'est la deuxième langue la plus apprise au monde.
L'Organisation internationale de la francophonie compte 80 États ou gouvernements.
On estime qu'il y a 274 millions de personnes capables de parler français dans le monde.
Selon le classement à partir de dix critères effectué par le site portalingua, les cinq langues prépondérantes sont l'anglais (largement), le français et l'espagnol, puis l'allemand et le néerlandais. Étonnant, non ?
Selon la taxonomie de Calvet, il y a dix langues "supercentrales" : l'anglais (la seule "hypercentrale"), l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, le russe, l'hindi, le malais, le swahili et le portugais.
Bref, quelle que soit la façon de classer, on retrouve toujours le français !
Et cela devrait continuer car la croissance démographique de l'Afrique francophone va accroître encore son importance numérique.

Neuvième idée reçue : le concept de francophonie serait récent
Nous avons déjà vu que non… et le terme "francophone" est encore plus ancien puisqu'il a été créé par un géographe français, Onésime Reclus, en 1880, dans son ouvrage "France, Algérie et Colonies".
Voilà, nous avons énoncé et corrigé neuf idées reçues sur la francophonie. Force est de constater que cette grande idée généreuse et ambitieuse n'a pas la faveur des médias ; d'une part parce qu'elle est à contre-courant de la pensée unique actuelle (le néolibéralisme, la concurrence à outrance, les droits de l'individu et l'individualisme, l'ouverture à tous les vents, la technologie sans modération…) et d'autre part parce qu'elle crée très peu d'événements susceptibles de "faire l'actualité".
Et d'où viennent donc les éléments de ces cinq billets qui nous ont permis de jouer au jeu des neuf erreurs ?
Ils sont extraits d'un CLOM de l'Université Lyon III, cours que l'on pouvait suivre en ligne sur internet au dernier trimestre 2015 et qui était intitulé "La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique". Nous étions 5000 à travers le monde…
Salut en passant à Marijuz, Fatima et Shelton, d'Amérique du Sud et d'Afrique !
PS. CLOM : cours en ligne, ouvert et massif (en anglais MOOC)
07:30 Publié dans Actualité et langue française, Francophonie | Lien permanent | Commentaires (0)



