03/03/2016
Vive la République, vive les Lettres (II)
Le livre de Marc Fumaroli, en plus d’être remarquablement bien écrit, est, bien sûr, une synthèse sur l’histoire littéraire du Moyen-Âge à l’époque classique, dans laquelle on sent sa sympathie pour ces esprits savants, passionnés et solidaires. Il ne le dit pas mais leur réseau d’hommes cultivés est, dans sa pratique, aux antipodes de la mondialisation sans foi ni loi, de la concurrence exacerbée et des divertissements faciles.
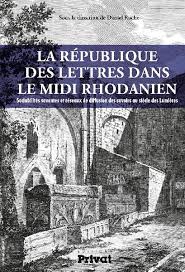 Il y a de l’élitisme, sans doute, chez Marc Fumaroli et chez ceux qu’il admire : les Pétrarque, Erasme, Nicolas de Peiresc, Bembo, Budé, Lipse, Gassendi… mais aussi de la solidarité, un goût pour la recherche et pour la « conversation » en marge de ce qui se fait à l’Université de l’époque… Ils vont utiliser l’imprimerie, la correspondance, les voyages, et constituer des bibliothèques privées. Leur langue va rester longtemps le latin. La « conversation » entre lettrés est à ce point un mode prioritaire d’échange et d’entretien de l’amitié que M. Fumaroli lui consacre un chapitre entier.
Il y a de l’élitisme, sans doute, chez Marc Fumaroli et chez ceux qu’il admire : les Pétrarque, Erasme, Nicolas de Peiresc, Bembo, Budé, Lipse, Gassendi… mais aussi de la solidarité, un goût pour la recherche et pour la « conversation » en marge de ce qui se fait à l’Université de l’époque… Ils vont utiliser l’imprimerie, la correspondance, les voyages, et constituer des bibliothèques privées. Leur langue va rester longtemps le latin. La « conversation » entre lettrés est à ce point un mode prioritaire d’échange et d’entretien de l’amitié que M. Fumaroli lui consacre un chapitre entier.
À l’origine, il y a le souhait de retrouver les textes des auteurs antiques, qui ont été protégés dans les monastères mais à l’occasion déformés et interprétés. Cet effort se fait dans le cadre de l’Europe chrétienne, sans opposition avec l’Église.
« L’alliance entre RESPUBLICA LITTERARIA et Respublica christiana fut dès les origines étroite. Pétrarque et ses héritiers n’ont opposé leurs studia humanitatis à la science scolastique des universités du nord de l’Europe que pour réformer et revivifier l’Église par l’étude savante des Pères des premiers siècles , et par une véritable résurrection érudite de l’Antiquité chrétienne, inséparable de la civilisation gréco-latine de l’Empire romain ».
Cependant…
« Cette grande aspiration des humanistes italiens à renouer avec le génie et la foi antiques, une fois transplantée dans le nord gothique et scolastique de l’Europe, a pris un tour infiniment plus dangereux pour l’unité de la Respublica christiana et pour l’orthodoxie romaine. Beaucoup moins tenu par la tradition italique, l’humanisme du Nord a penché très tôt vers le libre examen et une « modernité » théologique littéraire et scientifique difficile à admettre par l’Église romaine » (page 70).
(À suivre)
07:30 Publié dans Essais, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
29/02/2016
Vive la République, vive les Lettres (I)
La République, tout le monde connaît : la Première (1792-1804), la Deuxième (1848-1852), la Troisième (1870-1940), la Quatrième (1944-1958), la Cinquième et actuelle (1958- ).
Les Lettres, tout le monde connaît : Corneille, Chateaubriand, Balzac, Hugo, Zola, Proust et tant d’autres ; la littérature quoi !
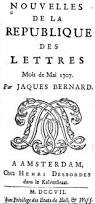 Mais la République des Lettres, kézako ?
Mais la République des Lettres, kézako ?
Il faut, pour le savoir, se plonger dans le merveilleux dernier livre de Marc Fumaroli « La République des Lettres » (Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2015).
En 459 pages grand format, l’Académicien et ancien professeur au Collège de France, en compilant et révisant des articles qu’il a déjà donnés sur le sujet, nous explique qu’il s’agit d’un réseau de personnes savantes qui ont cultivé, à travers l’Europe, à la fois la connaissance, la recherche et l’amitié, avant la création des Académies officielles, puis en parallèle avec elles.
Cette République des Lettres, qui s’est dégagée du latin pour s’exprimer progressivement dans les langues romanes, est donc le précurseur, à la fois des Académies (mais sans leur rapport au Pouvoir), des Sociétés savantes, du tourisme culturel, des réseaux de recherche, de l’Europe sans frontière et du travail en réseau.
« Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, on appelait République des Lettres, cette société qui se cooptait elle-même dans la société et qui réunissait, pour coopérer dans le même usage studieux du loisir, par-delà les professions et les conditions ecclésiastiques et laïques, et même par-delà les frontières et les confessions, par la correspondance et les voyages, tous ceux qui œuvraient pour le bien commun de l’Europe de l’esprit, érudits et savants…
… de leur propre chef, sur leurs propres ressources, ces abeilles collaborant et conversant entre elles, dans le même otium studiosum (NDLR : loisir studieux) infatigable, accumulaient et augmentaient le miel et la cire de la remémoration historique, source vivante et sans cesse renouvelée des lumières du savoir et de la douceur des mœurs civiles.
Le syntagme « République des Lettres » eut un synonyme au XVIIIème siècle : l’Europe littéraire, où l’adjectif « littéraire » embrasse à la fois les belles-lettres et l’ensemble des disciplines érudites et savantes, théologie, droit, histoire, histoire naturelle, philosophie morale et politique, rhétorique et poétique des lettres et des arts, etc. »
On l’a vu dans ces quelques lignes, l’écriture de Marc Fumaroli est élégante, harmonieuse, balancée, riche ; c’est un plaisir renouvelé à chaque chapitre de le lire, même si la concaténation des différents articles nuit un peu à l’homogénéité de l’ensemble.
Nous en verrons d’autres exemples dans de prochains billets, qui éclaireront le concept de République des Lettres.
---------------------------
Remarque : « kézako », écriture phonétique de « quèsaco », vient de la locution occitane « Qu’es aquò ? » qui signifie « Qu’est-ce que c’est ? ». Attesté en 1730 (A. Piron) (Source : wiktionary)
07:30 Publié dans Essais, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
25/02/2016
"L'instant présent" (Guillaume Musso) : critique
Voyons maintenant le cas de notre deuxième chouchou des libraires (celui des plages et des trains de banlieue) : Guillaume Musso.
Je viens de lire son dernier livre « L’instant présent ».
 Dans la veine de sa « deuxième manière » (voir le billet que je lui ai consacré le 21 septembre 2015), il s’agit d’un suspense psychologique, son héros – ordinaire – étant placé dans une situation extraordinaire, à savoir l’obligation de vivre vingt-quatre années de sa vie en vingt-quatre journées seulement.
Dans la veine de sa « deuxième manière » (voir le billet que je lui ai consacré le 21 septembre 2015), il s’agit d’un suspense psychologique, son héros – ordinaire – étant placé dans une situation extraordinaire, à savoir l’obligation de vivre vingt-quatre années de sa vie en vingt-quatre journées seulement.
Le style de G. Musso est plus soigné que celui de M. Levy, bien que ses descriptions ne soient pas plus riches ni ses études de caractère plus fouillées ; ici encore, l’essentiel est de dérouler à un rythme soutenu une histoire à rebondissements, de telle façon que le lecteur ne lâche pas le livre avant sa chute (cela arrive à la montée ou à la descente dans le RER…).
Comme son précédent roman (« Demain »), il se passe aux États-Unis ; à croire que la référence au modèle américain est un passage obligé (« Elle et lui » se passe à Paris mais ses héros sont américain et anglais…). Cela étant, par sa connaissance de New-York et par sa façon d’émailler son texte de termes américains, G. Musso réussit à créer cette ambiance.
En lisant, on pense à Jean-Christophe Grangé, la violence en moins, et ce n’est pas étonnant puisque G. Musso lui-même le cite comme l’un de ses modèles.
L’histoire est délibérément invraisemblable, c’est la loi du genre puisque nous sommes dans le « fantastique ordinaire » mais, une fois que l’on en a accepté les prémisses, il est vrai qu’on a envie d’en connaître l’épilogue. Du coup, les 370 pages grand format se lisent aussi en deux ou trois jours ; c’est du « consommable » mais bien construit (autant de chapitres que de journées, avec malheureusement des paragraphes numérotés 1, 2, 3, etc. qui donnent l’impression d’un cours) et écrit correctement. Il paraît, G. Musso dixit, qu’on peut (doit ?) lire ses livres à deux niveaux : les péripéties d’abord, la réflexion philosophique ensuite.
Bon, c’est vrai que le chemin de croix de ce jeune Américain obligé de consommer 24 années de sa vie en 24 jours, donne le vertige en nous faisant réfléchir sur le temps, sur sa relativité surtout, car son entourage, lui, voit bien passer les 24 années l’une après l’autre…
Notre critique, Alexandre Gefen s’était esbaudi de trouver dans le roman des citations ou des évocations de Saint Augustin, de Baudelaire et de Shakespeare… Sans être aussi enthousiaste, je reconnais que les pensées qui sont mises en exergue de chaque chapitre sont bien choisies et sont remarquables ; elles contribuent à sortir l’ouvrage de l’ornière des romans de gare.
« Où pouvais-je m’enfuir en me fuyant moi-même ? »
(Saint Augustin)
« L’expérience, ce n’est pas ce qui arrive à un homme, c’est ce qu’un homme fait avec ce qui lui arrive »
(Aldous Huxley)
« … j’ai songé alors que ce qui est violent, ce n’est pas le temps qui passe, c’est l’effacement des sentiments et des émotions. Comme s’ils n’avaient jamais existé »
(Laurence Tardieu)
« Aimer est une aventure sans carte et sans compas, où seule la prudence égare »
(Romain Gary)
« La route de l’enfer est si bien pavée qu’elle ne réclame aucun entretien »
(Ruth Rendell)
« Le passé est imprévisible »
(Jean Grosjean »
et dans la même veine
« Je me demande ce que le passé nous réserve »
(Françoise Sagan)
Plus prosaïques, les manchettes de journaux lues par notre héros datent l’avancement de l’histoire : accident de voiture de Lady Di, élimination de la France en Coupe du monde de foot en Corée, etc. Ce n’est pas déplaisant.
Concernant l’écriture, j’ai quand même trouvé quelques fautes :
- page 102 : « Alors que j’essuyai une larme sur ma joue, je ne pus… » ; j’aurais écrit « Alors que j’essuyais… » ;
- page 102 : « … j’essayais néanmoins de m’imaginer avec un bambin… ou d’aller le chercher à l’école » (phrase bancale) ;
- page 119 : « le premier coup de matraque du vigile m’atteint à l’abdomen et me coupa le souffle » ; comme « couper » est au passé simple, « atteindre » doit l’être aussi. Or le passé simple de « atteindre », c’est « atteignit » car il se conjugue comme « peindre » !
- page 166 : « Disons qu’elle s’en est accommodée » ; les verbes pronominaux, réfléchis ou non, sont ma bête noire, comme ils le sont pour Bernard Pivot ; mais j’aurais écrit « elle s’en est accommodé » ;
- page 167 : « tandis que je ramassais sur le sol… je le regardai traverser le parc » ; j’aurais écrit « regardais » car « regarder » est une action d’une certaine durée ;
- page 171 : « Je n’ai aucun souvenir de ce qu’il s’est passé ensuite » ; je sais bien que les deux formes existent et qu’on a le droit de choisir selon le sens mais j’aurais écrit : « … de ce qui s’est passé » ; G. Musso emploie cette formule à plusieurs reprises ;
- page 209, plus ambigu : « Soudain, je commençais à avoir des doutes… » ; normalement, l’imparfait convient pour une action longue, répétée ; or « Soudain » indique que c’est instantané ; j’aurais écrit « Soudain, je commençai à avoir des doutes » ;
- page 212 : « les meilleures lasagnes qu’elle eut mangées de toute sa vie » ; le participe passé est bien accordé mais « eut » est mal écrit ; il mérite un accent circonflexe car « qu’elle eût mangées » est un plus-que-parfait du subjonctif ; c’eût été différent si G. Musso avait écrit « quand elle eut mangé ses lasagnes… » !
- page 308 : « pour ne pas qu’il me voit convulser » ; l’horreur ! D’abord le verbe « convulser » n’existe pas ; ensuite, on peut écrire « pour ne pas voir mes convulsions » ou « pour qu’il ne voie pas mes convulsions » mais jamais « pour ne pas qu’il… ». À la décharge de G. Musso, cette faute était déjà signalée en 1956 (Manuel pratique de l’art d’écrire, M. Courault, page 22). En plus troisième horreur, « pour qu’il ne… » doit être suivi du subjonctif. En effet, en pareil cas, nos instituteurs nous recommandaient de remplacer le verbe du premier groupe par un du troisième. Je choisissais souvent « cuire », donc « pour qu’il ne cuise pas », CQFD.
Mais G. Musso écrit avec raison :
- page 202 : « nous ne pûmes pas aller très loin ? Nous nous assîmes donc sur l’un des bancs… » ; chapeau !
- page 307 : « … je l’ai entendue dire à quelqu’un… qu’il s’occupait bien d’elle » parce que l’on peut remplacer « dire » par « disant » (à savoir : « elle disant qu’il s’occupait bien d’elle », « elle » est bien le sujet de « dire ») ;
- idem page 319 : « je ne l’avais pas vue grandir » (« elle grandissant » ; « elle » est bien le sujet de « grandir »). Voir H. Berthet, « Résumé d’orthographe », page 23 ;
- « anagramme » est bien féminin (page 327).
Voyons pour conclure ce qu’en dit notre critique de Marianne : « un polar métaphysique, écrit sans effort de style mais cultivé et ambitieux, et habile dans sa manière de nous faire réfléchir sur l’inauthenticité de notre rapport au temps (NDLR : ?). Une leçon de vie consolatrice, pas plus idiote que celle que l’on trouve dans nombre de récits plus chic. La grande surprise de cette sélection ».
Faut pas exagérer !
Livre prenant ? Oui. À recommander ? Non. À garder ? Non.
Lecture réservée à ceux qui aiment le fantastique et qui veulent se changer les idées sans se fatiguer.
07:30 Publié dans Écrivains, Franglais et incorrections diverses, Livre, Musso Guillaume | Lien permanent | Commentaires (0)



