22/06/2015
Court-circuit sur la transmission
Dans son livre "Ma France", le philosophe allemand Peter Sloterdijk raconte son idylle - jamais consommée - avec notre pays et analyse le curieux destin de la philosophie allemande, qui a été un temps "ingérée", évaluée, puis "régurgitée" par les philosophes français.
Je ne vais pas essayer de vous résumer son article dans le Marianne du 17 avril 2015. Sachez seulement qu'il assène cette assertion : "Le rêve français s'évapore et finalement s'immobilise. Et immobilise toute tentative de penser la vie, l'homme, l'histoire".
Bigre...
Somme toute, c'est assez "allemand" cette façon de nous renvoyer dans nos buts. On songe à la célèbre définition du football par Gary Linneker : "C'est un jeu qui se joue avec un ballon entre deux équipes de 11. Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne".
Mais ce n'est pas de football que je voulais vous parler ni d'ailleurs de l'amicale rudesse de nos meilleurs ennemis d'Outre-Rhin.
Il se trouve qu'en parlant de Jacques Derrida "grand philosophe à la fois surprenant et inventif", P. Sloterdijk écrit : "C'était sa présence physique qui donnait corps à sa transmission".
Tiens, tiens ! La transmission, dada de notre chère Cécile Ladjali et intitulé du blogue (en panne) de l'avenante Natacha Polony (photos déjà publiées et admirées dans ce blogue).
Et on peut lire ensuite : "Aujourd'hui, on cherche le concret, la productivité ininterrompue d'effets dans le réel. Nous avons vécu l'époque de la mort de Dieu, aujourd'hui nous vivons l'époque de la mort de la bibliothèque, et donc la disparition de la transmission, voire de la filiation".
La bibliothèque ! la bibliothèque et la transmission !
N'est-ce pas étonnant de trouver ces mots qui ont fait l'objet de plusieurs billets dans le blogue ?
Épatants, ces courts-circuits !
08:30 Publié dans Actualité et langue française | Lien permanent | Commentaires (0)
21/06/2015
Y a-t-il plus grave que l'invasion du franglais ?
Sans doute !
D'abord, comme on l'a déjà dit ici, il y a les souffrances, les difficultés de tous ordres, les accidents… Bien sûr. Il y a aussi les évolutions de la société, jugées positives ou non, la micro- et la macro-économie, la bioéthique, naturellement...
Sur le sujet de la langue proprement dit, on peut invoquer le relativisme pour minimiser sa dégradation actuelle. Ainsi mon lecteur FPY m'a-t-il signalé un article du Figaro du 13 avril 1917, reproduit le 18 juillet 2014, intitulé "Le français tel qu'on le parle" et expliquant comment les soldats britanniques communiquaient avec leurs "hôtes" dans la campagne picarde à l'aide d'une sorte de franglais à l'envers, un englench. Par exemple, compree était un mot utilisé par tous pour dire "compris", d'où souvent me no compree ! Il y avait aussi Quand guerre finish, etc. "Il n'y en a plus" était devenu napoo...
Quel rapport avec notre franglais ? quasiment aucun… Les Français ne sont en guerre avec personne sur leur propre territoire (du moins, je ne crois pas…) et de toutes façons, quand ils parlent franglais, c'est avec d'autres Français !
Non, ce que je trouve grave dans le franglais, c'est surtout que cela participe, au-delà du snobisme bébête, d'un renoncement, d'une fascination pour un modèle autre, fascination qui est allée jusqu'à livrer l'Europe de Bruxelles à l'ultra-libéralisme anglo-américain.
Mais sur le même sujet, il y a effectivement peut-être plus grave que l'invasion du franglais (j'ai dit : peut-être) ; c'est la perversion du langage, qu'il soit en bon français ou en jargon.
Alternatives économiques a rendu compte d'un livre récent de François Dupuy, intitulé "La faillite de la pensée managériale" (Le Seuil, 2015) et qui est le tome II de son "Lost in management". Je passe sur la thèse principale ("Sous la pression des objectifs financiers, les dirigeants ne peuvent ou ne veulent plus réfléchir"), pour aller directement aux thèmes qui nous intéressent ici.
Par exemple : "Affirmer que la stratégie de l'entreprise est de devenir numéro 1 du marché, n'est pas une stratégie mais un objectif à atteindre". J'avais déjà pointé la confusion fréquente entre "enjeux" et "objectifs" ; en voilà donc une autre.
"En face (NDLR : des dirigeants, de leurs croyances et de leurs "lubies" ), les salariés ont appris à décoder la vacuité du langage managérial. Trouver des synergies est immédiatement interprété comme des licenciements à venir. Ils savent aussi mesurer l'écart qui sépare les valeurs affichées (loyauté, respect, innovation, travail en équipe…) de la réalité de l'entreprise."
F. Dupuy dénonce une irresponsabilité du discours managérial, capable d'affecter gravement les salariés. La charge est tout aussi sévère contre les business schools. Quant aux cabinets de conseil, impossible de compter sur eux. Apporter une pensée complexe ne fait pas partie de leur business model.
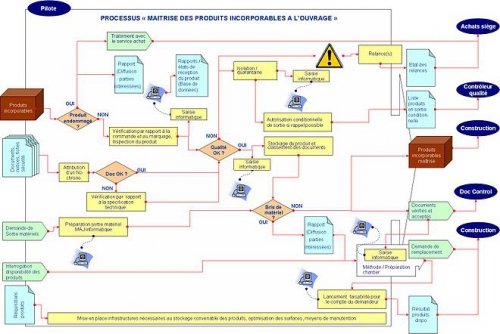
L'auteur plaide pour un retour à la confiance dans les salariés, alors que contrôles, reportings et indicateurs à respecter ont envahi les entreprises.
Vaste programme.
20/06/2015
Revue de presse : Alternatives économiques
Alternatives économiques est une revue mensuelle très intéressante à plus d'un titre (!). Parce qu'elle aborde l'actualité économique sous un angle bien différent de la pensée unique à la Thatcher (TINA et compagnie) et aussi parce qu'elle est produite par une entreprise d'un type original, une SCOP.
Sa présentation est de qualité, la forme mettant bine en valeur le fond. Il m'a semblé cependant qu'elle cédait un peu trop souvent à la facilité (illusoire) et à la mode (qui fait vendre ?) du franglais.
Aussi ai-je décidé de passer au peigne fin le numéro 343 de février 2015. En voici le résultat.
 On n'insiste pas assez, me semble-t-il, sur l'importance cruciale de la ponctuation, en particulier des indispensables virgules, pour la lisibilité et la clarté des écrits. Que penser par exemple de cette phrase, attribuée, page 57, à P.-Y. Gomez et H. Korine, dans leur livre "L'entreprise dans la démocratie" (De Boek, 2009) : "Qui a et au nom de quoi le droit de diriger les entreprises ?". La succession de "a", "et" et "au" sans ponctuation est saugrenue et nuit à la bonne compréhension de l'idée au premier coup d'œil. En l'occurrence, l'idée principale est la suivante : "Qui a le droit de diriger les entreprises ?" et l'idée secondaire, la question qui viner quand on a répondu à la première : "Au nom de quoi ces personnes ont-elles le droit de diriger les entreprises ?". Il convient donc de mettre "à part" cette seconde question, en l'encadrant par des virgules à l'intérieur de la première : "Qui a, et au nom de quoi, le droit de diriger les entreprises ?". Le contenu de l'article est intéressant, si l'on supporte les multiples références au terme corporate governance. On est, par exemple, soulagé d'apprendre que Milton Friedman, le pseudo-Prix Nobel d'économie 1962, au nom duquel le néolibéralisme met des pays à genoux depuis cinquante ans (voyez le sort de la Grèce depuis 2010), affirmait que "la seule responsabilité des dirigeants de l'entreprise est d'accroître les profits pour les actionnaires".
On n'insiste pas assez, me semble-t-il, sur l'importance cruciale de la ponctuation, en particulier des indispensables virgules, pour la lisibilité et la clarté des écrits. Que penser par exemple de cette phrase, attribuée, page 57, à P.-Y. Gomez et H. Korine, dans leur livre "L'entreprise dans la démocratie" (De Boek, 2009) : "Qui a et au nom de quoi le droit de diriger les entreprises ?". La succession de "a", "et" et "au" sans ponctuation est saugrenue et nuit à la bonne compréhension de l'idée au premier coup d'œil. En l'occurrence, l'idée principale est la suivante : "Qui a le droit de diriger les entreprises ?" et l'idée secondaire, la question qui viner quand on a répondu à la première : "Au nom de quoi ces personnes ont-elles le droit de diriger les entreprises ?". Il convient donc de mettre "à part" cette seconde question, en l'encadrant par des virgules à l'intérieur de la première : "Qui a, et au nom de quoi, le droit de diriger les entreprises ?". Le contenu de l'article est intéressant, si l'on supporte les multiples références au terme corporate governance. On est, par exemple, soulagé d'apprendre que Milton Friedman, le pseudo-Prix Nobel d'économie 1962, au nom duquel le néolibéralisme met des pays à genoux depuis cinquante ans (voyez le sort de la Grèce depuis 2010), affirmait que "la seule responsabilité des dirigeants de l'entreprise est d'accroître les profits pour les actionnaires".
Page 62, c'est tout à fait autre chose : "Faut-il brûler les incinérateurs ?". Je trouve qu'il commence bien avec un doux souvenir de la langue d'antan, puisqu'il appelle les fabricants de plâtre "les chaufourniers". Mais très vite, il parle de "médiatiquement correct", décalque de l'envahissant "politiquement correct", lui-même décalque, à la fois syntaxique et sémantique de l'américain politically correct. Depuis quand installe-t-on un adverbe devant un adjectif ? Je n'ai pas d'exemple à l'esprit… et je me dis que la forme normale serait "Ce comportement est, politiquement, incorrect" ou bien "Politiquement, ce comportement est incorrect", rétablissant ainsi les attributs habituels : l'adjectif se réfère au sujet, l'adverbe au verbe. Encore une histoire de virgule donc...
Dans le même article, un encart s'attarde sur l'expression "zéro déchet", apparue en France, dit l'auteur, il y a environ un an (donc début 2014). Sachant que j'allais lire son texte, il se permet une considération linguistique : "Traduction imparfaite de l'anglais zero waste…". Mais n'en dit pas plus. En revanche, sur le fond, on apprend que "personne n'a démontré qu'on pouvait être plus riche, tout en produisant moins de déchets".
Plus grave, le raisonnement incohérent (Cécile L. dirait : une aporie) : un encart précise que les dioxines sont des molécules toxiques produites lors de la combustion de matières contenant du chlore. Et dix lignes plus loin, l'article explique que les incinérateurs produisent bien moins de dioxines que le secteur résidentiel-tertiaire, en raison en particulier du chauffage au bois ! Depuis quand le bois de chauffage contient-il du chlore ?
Et je passe sur le titre "Les chanteurs victimes du streaming".
08:59 Publié dans Actualité et langue française, Franglais et incorrections diverses | Lien permanent | Commentaires (0)



