28/03/2016
"Shâb ou la nuit" (Cécile Ladjali) : critique
J’ai trouvé ce livre de Cécile Ladjali dans une librairie, par hasard, en cherchant autre chose. « Shâb ou la nuit » (Actes Sud, 2013) est présenté comme un roman mais il est autobiographique. Souvent on dit : « ça se lit comme un roman » ; en fait une biographie est bien plus facile à lire et plus prenant que nombre de romans ; et c’est le cas ici.
Le style est simple, direct, le rythme est alerte, c’est un livre que l’on dévore et qui nous en dit long – c’est certainement son but principal – sur ce professeur-agrégé de lettres-écrivain un peu mystérieux.
Voici comment elle décrit, par exemple, l’arrivée de ses (futurs) parents adoptifs à Lausanne : « … le temps s’arrêta. Les aiguilles des horloges tournaient à l’envers pour tricoter un drôle de chandail à leur cœur. Une sorte de linceul pour leur vie d’avant. Ils mouraient à eux-mêmes. Ils allaient rencontrer l’autre » (page 10 de l’édition BABEL chez Actes Sud, 2013). À la page suivante se produit un lapsus qui trouvera plus loin son explication : « La bienveillance… ne suffit pas à rassurer Julie et Robert. (…) Ni Jeannine ni Robert ne répondirent ». Effet de surprise ménagé sciemment ou faute d’inattention de l’auteur, qui appellera ce changement de prénom une « mutation onomastique » (page 29) ? D’ailleurs elle n’hésite pas à employer des mots peu communs : palmature (difformité qui confère aux mains un aspect palmé), faucheux (les opiliones ou opilions, mieux connus sous le nom vernaculaire de « faucheurs » ou « faucheux » sont un ordre d'arachnides, comme les araignées, les scorpions ou les acariens) (page 32), dicible (mon Hachette de 1991 ne signale que « dicibilité », qualité de ce que l’on peut exprimer (page 136). Dans le dialogue entre mère et fille page 252 se glissent des incorrections comme « Voilà ton eau gazeuse » (au lieu de « Voici… »), « C’est sûr que je te ressemble plus à toi qu’à ma mère » (« te » et « toi » sont redondants) et « Je t’ai amené des petites choses de Suisse » (au lieu de « apporté »), « Je voudrais juste comprendre… » au lieu de « seulement » ou « simplement ». Mais c’est sans doute pour rendre l’échange crédible…
On savait qu’elle était « d’origine iranienne », qu’elle enseignait en Seine-Saint Denis (et plus récemment en Sorbonne), qu’elle était passionnée par la littérature et la langue française (rappelons-nous « Mauvaise langue » et « Ma bibliothèque »)… et on découvre une enfance heureuse mais compliquée, avec des parents adoptifs, à Paris d’abord, puis en banlieue, dans le Val de Marne.

Cécile Ladjali ne fait pas dans le romantisme ; de ses souvenirs d’enfance, elle n’écarte pas les détails peu ragoutants, voire sordides ; elle ne cache pas son ambivalence (amour-répulsion) vis-à-vis de sa mère et surtout de son père adoptifs.
À son origine lointaine et son abandon à la naissance s’ajoutent l’origine algérienne, le rapatriement et le service militaire en Algérie de son père.
Il y a donc beaucoup de choses tues dans la famille : sa naissance bien sûr, la guerre d’Algérie et ce qu’y avait fait son père aussi, et jusqu’au mariage de ses parents adoptifs dont il n’y a aucun cliché vu qu’il n’y avait pas d’appareil photo pour les prendre… On pense parfois à « Secrets de famille » d’Irène Frain, livre magistral dont je reparlerai peut-être.
À l’adolescence, comme souvent, elle veut savoir ; elle découvre qu’elle avait été prénommée « Roshan », qui veut dire « lumière » en persan, alors qu’en France, son prénom est Cécile, qu’elle rattache à « Cæcilia », l’aveugle… ce qui lui fera mettre toute son histoire personnelle sous le signe du clair-obscur. Elle retrouvera sa mère biologique, la rencontrera mais tout cela ne fera que la rapprocher définitivement de ses parents adoptifs, disparus entre temps dans la douleur. Tout cela, dit avec des mots simples et parfois crus, est très émouvant.
En même temps, de mauvaise élève qui ne s’intéresse pas à l’école, elle se transforme, par la découverte de la magie des mots, en lectrice effrénée, ce qui lui donne progressivement envie d’écrire. D’où ses études de lettres et sa vocation irrépressible d’écrivain.
C’est un beau livre, plein de perspectives, sur une vie déjà hors du commun, sur la fin de vie aussi, sur les souffrances des hommes ballotés par les guerres, les régimes autoritaires et les sociétés fermées, et qui prennent les décisions qu’ils peuvent, pour s’en sortir, sur la générosité et l’amour aussi, sans forcément les liens du sang, sur le non-déterminisme des parcours – d’Hispahan aux plateaux-télé, en passant par Genève et Champigny sur Marne – et enfin sur l’incroyable pouvoir de la langue (les livres qui ont changé votre vie…).
Un livre qu’on ne lâche pas avant la fin – merveilleux épilogue… –, que l’on recommande et que l’on garde quand on aime Cécile Ladjali.
Version 2 du 30 mars 2016
07:30 Publié dans Écrivains, Ladjali Cécile, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)
24/03/2016
"Sentiments filiaux d'un parricide" (Marcel Proust) : critique
Les « petits » éditeurs semblent s’être fait une spécialité (lucrative ? ce n’est même pas certain…) de re-publier des textes mineurs ou inconnus ou « épuisés » des plus grands auteurs. Il y a aussi les « tirés à part ».
C’est ainsi que « Sur la lecture » de Marcel Proust avait été extrait de « Pastiches et mélanges » par l’éditeur « Mille et une nuits » en 1994 (à dire vrai, ce texte avait été publié plusieurs fois déjà par Proust en diverses occasions).
Et, en mars 2016, les Éditions Allia republient, du même auteur, « Sentiments filiaux d’un parricide ».
Couverture noire en harmonie avec le sujet, qui reproduit une page de journal de l’époque, courte citation de M. Proust en quatrième de couverture… l’éditeur a fait dans l’austère ! De l’austère à 3,10 € les 75 pages en très petit format… Ça se veut œuvre pour bibliophile ou pour « Proustolâtre » mais dans la postface de Gérard Berréby (qui par ailleurs n’est pas présenté ; qui est-ce ?), il y a deux énormes coquilles : d’abord l’article du Figaro est daté de 2013 et ensuite le Directeur du journal est appelé Gaston Camelette… Pas très sérieux !

Sur le fond, l’histoire est curieuse ; Marcel Proust, dans un article du Figaro de février 1907, s’intéresse à un fait divers sordide : un homme riche et connu poignarde sa vieille mère et se donne la mort.
Alors que les journaux des jours suivants voient dans le drame la conséquence d’un dérèglement psychiatrique (mélancolie, schizophrénie ? je ne sais pas trop), Marcel Proust, qui se rappelle d’abord qu’il a croisé cet homme que connaissait son père et avec lequel il a échangé quelques billets courtois de condoléances à l’occasion du décès qu’ils venaient l’un et l’autre de subir, interprète l’acte parricide comme la réédition du geste antique rendu célèbre par les mythes grecs d’Ajax et d’Œdipe.
C’est l’occasion pour lui de déployer en un long article son écriture caractéristique et ses références culturelles.
Mais quelle bizarre démonstration !
C’est au point que le directeur du Figaro, le fameux Gaston Calmette, lui demandera de supprimer sa chute, qui était celle-ci : « Rappelons-nous que chez les Anciens, il n’était pas d’autel plus sacré, entouré d’une vénération, d’une superstition plus profondes, gage de plus de grandeur et de gloire pour la terre qui les possédait et les avait chèrement disputés, que le tombeau d’Œdipe à Colonne et que le tombeau d’Oreste à Sparte, cet Oreste que les Furies avaient poursuivi jusqu’aux pieds d’Apollon même et d’Athênê en disant : Nous chassons loin des autels le fils parricide ».
En fait, donc, Marcel Proust « ne vit pas en M. van Blarenberghe uniquement un homme malade, dont la folie l’aurait mené à tuer sa pauvre mère. Non seulement il ne le présenta pas comme le meurtrier d’un sordide fait divers mais il l’envisagea comme un héros tragique. Son empathie ne se manifesta pas tant à l’égard de la victime que du criminel en faveur duquel, pour citer une expression utilisée dans un autre article du Figaro (…), il rédigea une défense lyrique ».
À moins de vouloir absolument utiliser un fait qui a frappé les esprits de l’époque pour publier un essai censé démontrer l’actualité et l’intemporalité des grands mythes psychologiques et pour réaffirmer son attachement à l’Antiquité, M. Proust, à part les qualités littéraires de son article, semble enfourcher l’habit commode des intellectuels qui ont toujours pu, de tous temps, du fond de leur splendide isolement, afficher de nobles sentiments inaccessibles au vulgaire…
Ou bien vole-t-il, égoïstement et tout simplement, au secours d’un membre de sa classe sociale, ancien élève de Polytechnique, membre du Conseil d’administration d’une grande compagnie de chemins de fer présidée par Papa ?
07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Livre, Proust Marcel | Lien permanent | Commentaires (0)
21/03/2016
"L'ami retrouvé" (Fred Uhlman) : critique
Je crois que c’est Jean d’Ormesson qui, toujours dans cette émission de François Busnel, citait « L’ami retrouvé » de Fred Uhlman comme l’un de ses livres préférés. Pour moi, c’était plutôt un livre pour enfants ou adolescents, et un livre ancien ; je l’avais quelque part mais sans l’avoir lu.
L’autre jour, après la lecture de « Les pierres sauvages », par association d’idées, j’y ai repensé et je suis allé le rechercher.
D’abord ce n’est pas un livre si ancien que cela : il date de 1971 et n’a été traduit en français qu’en 1977.
 Ensuite ce n’est pas un livre pour enfants, pas du tout ; c’est l’histoire d’une amitié entre deux lycéens de classes sociales très différentes, un peu à la façon de « Les désarrois de l’élève Törless » ou de « Le cercle des poètes disparus » mais avec comme cadre la montée du nazisme en Allemagne et l’extermination des Juifs.
Ensuite ce n’est pas un livre pour enfants, pas du tout ; c’est l’histoire d’une amitié entre deux lycéens de classes sociales très différentes, un peu à la façon de « Les désarrois de l’élève Törless » ou de « Le cercle des poètes disparus » mais avec comme cadre la montée du nazisme en Allemagne et l’extermination des Juifs.
C’est un livre petit en épaisseur mais grand par le sujet et par la façon dont il est traité : sobre, plein de poésie et d’amour de la patrie (le Land de Würtemberg) et tendu vers son bref et édifiant dénouement.
Le sujet fait irrésistiblement penser à cette pièce de théâtre qui met en scène deux adultes, l’un aux États-Unis, l’autre à Berlin, que la guerre et le IIIème Reich vont séparer.
La vie de l’auteur elle-même (1901-1985) tient du roman : Allemand, il fuit son pays pour Paris, puis, après un séjour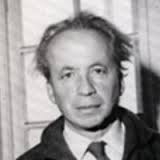 en Espagne où il rencontre son épouse, s’établit en Angleterre ; il y milite pour l’Espagne républicaine et contre les Nazis ; mais à la base, il est peintre et il rencontra la notoriété en exposant ses œuvres.
en Espagne où il rencontre son épouse, s’établit en Angleterre ; il y milite pour l’Espagne républicaine et contre les Nazis ; mais à la base, il est peintre et il rencontra la notoriété en exposant ses œuvres.
Magie du multilinguisme, il écrivit « L’ami retrouvé » dans un anglais simple et élégant.
Un livre émouvant.
07:30 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Roman, Uhlman Fred | Lien permanent | Commentaires (0)



