27/06/2015
Patagonie, mon amour
Jean Raspail s'était fait connaître, dans les années 70, par un roman, "Le camp des Saints", au thème complètement stupide et irréaliste : des émigrants débarquaient en nombre sur la Côte d'Azur et envahissaient la France...
À l'époque, j'étais plutôt "Pouvoir des fleurs" au sens de "Jeunes filles en fleur", j'écoutais mes premiers 33 tours (Chicago, Pink Floyd et José Féliciano) et je découvrais l'École des Nobel… autant dire que les intuitions d'un écrivain classé franchement à droite me passaient largement au-dessus de la tête.
Beaucoup plus tard, j'ai découvert son roman "Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie" (1981), Grand Prix du roman de l'Académie française, dans lequel il raconte la vie, réelle, d'un avoué de Périgueux qui s'était proclamé "roi de Patagonie et d'Araucanie" en 1860.
Déjà, en 1976, dans "Le jeu du roi", l'écrivain avait imaginé qu'un prétendu descendant du roi de Patagonie reconstituait un royaume dans un fort de la côte normande… C'est dire que cette histoire lui tenait à cœur.
Bien avant, donc, qu'un chanteur populaire qui se prend pour un chanteur lyrique, ne s'y réfugie pour échapper au fisc français...
 Ce roman est merveilleux mais ce qui l'est bien plus encore, c'est que Jean Raspail a créé dans sa maison de Provence, le Consulat général de Patagonie, et que des lettres y affluèrent, demandant la nationalité patagonne ! La réalité avait rattrapé la fiction, qui elle-même paraphrasait la réalité.
Ce roman est merveilleux mais ce qui l'est bien plus encore, c'est que Jean Raspail a créé dans sa maison de Provence, le Consulat général de Patagonie, et que des lettres y affluèrent, demandant la nationalité patagonne ! La réalité avait rattrapé la fiction, qui elle-même paraphrasait la réalité.
Il paraît qu'aujourd'hui 5000 Français revendiquent cette nationalité, à la suite de Verlaine, Charles Cros, Camille Flammarion et Zola ! Notre connaissance, Dominique Bona, est sur la liste, de même que Michel Déon.
Les impétrants se reconnaissent dans les quatre mots suivants : tendresse, ironie, fierté et mélancolie, et dans le drapeau bleu, blanc, vert.
La farce sympathique, burlesque et épique continue : en 1998, un commando s'est emparé d'un rocher anglais du type Malouines et en 2012 un hangar à dirigeables a été assailli par la SPASM (Société patagonne d'assistance et de sauvetage en mer).
Tout cela est raconté par un article d'Éric de Montety dans le Figaro du 10 avril 2015.
Quant à Jean Raspail, disparu récemment, il a écrit d'autres romans de la même veine, consacrés à d'improbables dynasties teutonnes, à mi-chemin entre le Maurice Leblanc de 813 et la grande histoire.
07:30 Publié dans Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
21/06/2015
Y a-t-il plus grave que l'invasion du franglais ?
Sans doute !
D'abord, comme on l'a déjà dit ici, il y a les souffrances, les difficultés de tous ordres, les accidents… Bien sûr. Il y a aussi les évolutions de la société, jugées positives ou non, la micro- et la macro-économie, la bioéthique, naturellement...
Sur le sujet de la langue proprement dit, on peut invoquer le relativisme pour minimiser sa dégradation actuelle. Ainsi mon lecteur FPY m'a-t-il signalé un article du Figaro du 13 avril 1917, reproduit le 18 juillet 2014, intitulé "Le français tel qu'on le parle" et expliquant comment les soldats britanniques communiquaient avec leurs "hôtes" dans la campagne picarde à l'aide d'une sorte de franglais à l'envers, un englench. Par exemple, compree était un mot utilisé par tous pour dire "compris", d'où souvent me no compree ! Il y avait aussi Quand guerre finish, etc. "Il n'y en a plus" était devenu napoo...
Quel rapport avec notre franglais ? quasiment aucun… Les Français ne sont en guerre avec personne sur leur propre territoire (du moins, je ne crois pas…) et de toutes façons, quand ils parlent franglais, c'est avec d'autres Français !
Non, ce que je trouve grave dans le franglais, c'est surtout que cela participe, au-delà du snobisme bébête, d'un renoncement, d'une fascination pour un modèle autre, fascination qui est allée jusqu'à livrer l'Europe de Bruxelles à l'ultra-libéralisme anglo-américain.
Mais sur le même sujet, il y a effectivement peut-être plus grave que l'invasion du franglais (j'ai dit : peut-être) ; c'est la perversion du langage, qu'il soit en bon français ou en jargon.
Alternatives économiques a rendu compte d'un livre récent de François Dupuy, intitulé "La faillite de la pensée managériale" (Le Seuil, 2015) et qui est le tome II de son "Lost in management". Je passe sur la thèse principale ("Sous la pression des objectifs financiers, les dirigeants ne peuvent ou ne veulent plus réfléchir"), pour aller directement aux thèmes qui nous intéressent ici.
Par exemple : "Affirmer que la stratégie de l'entreprise est de devenir numéro 1 du marché, n'est pas une stratégie mais un objectif à atteindre". J'avais déjà pointé la confusion fréquente entre "enjeux" et "objectifs" ; en voilà donc une autre.
"En face (NDLR : des dirigeants, de leurs croyances et de leurs "lubies" ), les salariés ont appris à décoder la vacuité du langage managérial. Trouver des synergies est immédiatement interprété comme des licenciements à venir. Ils savent aussi mesurer l'écart qui sépare les valeurs affichées (loyauté, respect, innovation, travail en équipe…) de la réalité de l'entreprise."
F. Dupuy dénonce une irresponsabilité du discours managérial, capable d'affecter gravement les salariés. La charge est tout aussi sévère contre les business schools. Quant aux cabinets de conseil, impossible de compter sur eux. Apporter une pensée complexe ne fait pas partie de leur business model.
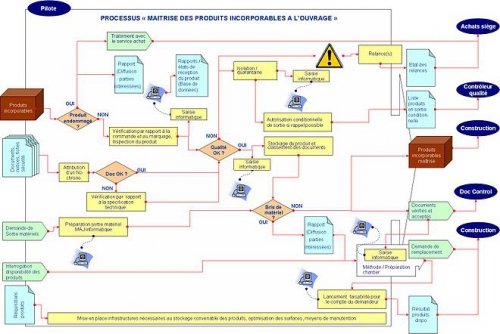
L'auteur plaide pour un retour à la confiance dans les salariés, alors que contrôles, reportings et indicateurs à respecter ont envahi les entreprises.
Vaste programme.
19/06/2015
Dis-moi ta bibliothèque, je te dirai qui tu es (II)
La construction du livre de Cécile Ladjali "Ma bibliothèque" est remarquable car elle ne se voit pas, elle n'est pas ouvertement "cartésienne" ni didactique.
C'est une promenade entre ses rayonnages, à travers la littérature qu'elle aime, avec des souvenirs, avec l'évocation de passions littéraires, avec des analyses et des anecdotes sur les auteurs de son Panthéon personnel.
Avec aussi sa façon à elle d'acheter, de lire et de classer ses livres. Ainsi :
"L'escalier me sert de bibliothèque provisoire. À l'endroit où les marches présentent la surface la plus large, je dépose les derniers livres achetés après m'être adonnée à un petit rituel. Toujours le même. Sur la page d garde, j'écris mon nom, la date et le titre du texte que je suis en train d'écrire… Et puis il est amusant, en rouvrant un roman des années après, de se souvenir dans quel état nerveux nous étions alors, quelle était notre rapport au sens, au temps, au dire, puisque l'œuvre avait été choisie une perlière fois pour aider à la rédaction du texte en cours. Il n'est pas rare que je lise cinq volumes tout frais débarqués de la librairie en même temps, ce qui me conduit à leur trouver des correspondances légitimes, alors qu'aucun lien naturel ne m'y autorise en principe. Mais l'escalier-bibliothèque est le tronc d'un arbre généalogique. C'est lui qui diffuse la sève vers les branches-fouillis au bout desquelles fleurissent les familles d'écrivains que j'invente en lisant. Une fois la lecture de chaque œuvre achevée, je la range dans la bibliothèque et en replace de nouvelles sur les marches de l'escalier". Suit un page de titres et d'auteurs...
"La bibliothèque ajaccienne est petite. Pour y accueillir une centaine d'ouvrages, j'ai reconverti un buffet Art décor. Devant le rectangle du miroir qui surmonte le meuble en bois très sombre, sont posés les livres, si bien qu'on ne voit plus son tain… En Corse, je lis et j'écris beaucoup. Je lis pendant les siestes. J'écris tôt le matin, entre 6 heures et 9 heures. Lorsque le soleil monte, je sais que je ne suis pas la seule à inventer un nouveau roman…".
Dans son livre, on découvre aussi que de nombreux écrivains se sont intéressés à leur bibliothèque ou aux bibliothèques en général.
Par exemple "Cette ordonnance des formes m'évoque la belle couverture du livre de Jacques Bonnet, Une bibliothèque pleine de fantômes (Éditions Denoël), où ce sont les livres ordonnés sur une cheminée de marbre blanc qui apparaissent de façon magique dans le miroir fixé au trumeau".
Mais aussi Hermann Hesse "Une bibliothèque idéale", George Steiner "Les livres que je n'ai pas écrits", Henry Miller "Les livres de ma vie", Brian Stock "Bibliothèques intérieures", et sans parler de Umberto Eco, dont le livre célèbre "Le nom de la rose" est une sorte de métaphore de La Bibliothèque...
08:25 Publié dans Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



