18/04/2019
"L'étoile du sud" (Jules Verne) : critique II
On peut même lire « L’étoile du sud » à un troisième niveau : la façon de voir le monde des Français à la fin du XIXème siècle. Fascination envers la science et ses pouvoirs, ethnocentrisme, bonne conscience européenne, universalisme, géopolitique. Jules Verne évoque en effet le développement de la recherche des diamants et l’accaparement progressif des terres des Boers – ce qui veut dire « paysans », ici des immigrés huguenots – par les Anglais, avec les autochtones africains en arrière-plan (« Les Anglais étaient, à son sens, les plus abominables spoliateurs que la terre eût jamais portés (…) Rien d’étonnant si les États-Unis d’Amérique se sont déclarés indépendants, comme l’Inde et l’Australie ne tarderont pas à le faire ! Quel peuple voudrait tolérer une tyrannie pareille ! Ah ! monsieur Méré, si tout le monde savait toutes les injustices que ces Anglais, si fiers de leurs guinées et de leur puissance navale, ont semées sur le globe, il ne resterait pas assez d’outrages dans la langue humaine pour les leur jeter à la face ! » page 46 de l’édition de Crémille, 1990). « Je suis né à Amsterdam en 1806 (…) mais toute mon enfance s’est passée au Cap, où ma famille avait émigré depuis une cinquantaine d’années. Nous étions Hollandais et très fiers de l’être, lorsque la Grande-Bretagne s’empara de la colonie, à titre provisoire disait-elle ! Mais John Bull ne lâche pas ce qu’il a une fois pris, et en 1815 nous fûmes solennellement déclarés sujets du Royaume-Uni, par l’Europe assemblée en Congrès ! » (page 47, dans laquelle Jules Verne résume une partie de l’histoire de l’Afrique du Sud, qui se joue à trois : les Boers, les Anglais et les peuplades africaines).
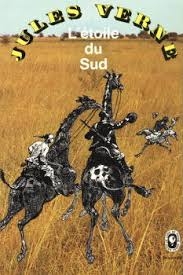
Les caractères y sont simplistes et en général inspirés des préjugés et stéréotypes de l’époque quant aux caractéristiques supposées des Français, des Anglais, des Écossais, des Chinois et des Africains. Par exemple, page 66, « Ce raisonnement, éminemment chinois, acheva la cure ». À propos de son aide noir, Matakit : « Aucune besogne ne le rebutait, aucune difficulté ne paraissait être au-dessus de son courage. C’était à se dire, parfois, qu’il n’y avait pas de sommet social qu’un Français, doué de facultés semblables, n’eût pu prétendre à atteindre. Et il fallait que ces dons précieux fussent venus se loger sous la peau noire et le crâne crépu d’un simple Cafre ! Pourtant Matakit avait un défaut – un défaut très grave – qui tenait évidemment à son éducation première et aux habitudes par trop lacédémoniennes qu’il avait prises dans son kraal. Faut-il le dire ? Matakit était quelque peu voleur, mais presque inconsciemment (…) Et Cyprien, tout en le regardant dormir, songeait à ces contrastes si bizarres qu’expliquait le passé de Matakit au milieu des sauvages de sa caste » (pages 70-71).
Par ailleurs, il faut de l’argent « pour acheter un claim de premier choix et une douzaine de Cafres capables de le travailler ». (Un claim est un titre de propriété minière, conférant le droit d'exploiter sur une superficie déterminée et aussi le terrain renfermant du minerai (or, diamant, uranium. Source : dictionnaire Larousse.fr).
Naturellement d’écologie et de protection de la diversité on n’entend pas parler (Romain Gary et ses « Racines du ciel » ne sont pas encore passés par là !) : « Il avait déjà tué trois lions, seize éléphants, sept tigres, plus un nombre incalculable de girafes, d’antilopes, sans compter le menu gibier » (sic !).
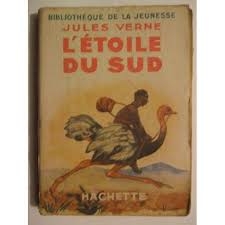
Un dernier commentaire sur la langue de Jules Verne : ici et là apparaissent quelques mots rares ou devenus rares. « billevesées » (propos, idée vide de sens ; sottise, baliverne – surtout au pluriel –, d’après Larousse.fr), « des tonneaux de bière et de vin gerbés de distance et distance » (empiler des charges – gerbes de céréales, fûts, sacs, etc. – les unes sur les autres) et « la fête épulatoire » (mot inconnu de mes dictionnaires).
07:00 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Roman, Verne Jules | Lien permanent | Commentaires (0)
15/04/2019
"L'étoile du sud" (Jules Verne) : critique I
« L’étoile du Sud », publié en 1884, est un roman « classique » de Jules Verne, déclinant ses thèmes de prédilection : la science, l’aventure, la géographie, les passions humaines (amour, cupidité, jalousie…) et même géopolitique, sauf qu’il s’agit initialement d’un texte écrit par un autre (Paschal Grousset) et que Jules Verne a remanié.
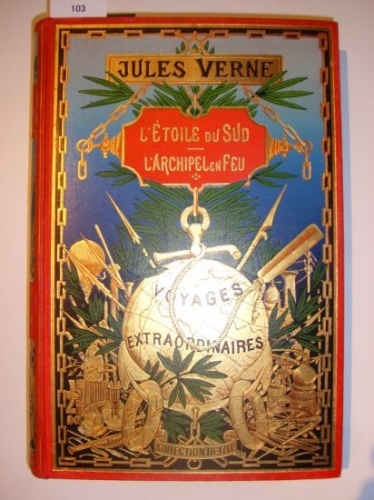
Il se passe en Afrique du Sud où Cyprien Méré, jeune ingénieur de l’École des Mines de Paris (Jules Verne adore les grandes écoles et plusieurs de ses héros sont Polytechnicien ou Mineur), étudie les gisements de diamants. Il est amoureux d’Alice Watkins mais se heurte au refus de son père quand il fait sa demande en mariage, sauf d’avoir une situation suffisamment avantageuse. Il se lance alors dans la fabrication d’un diamant artificiel, fabrication apparemment couronnée de succès puisqu’il obtient un diamant noir, l’Étoile du Sud (symbole de l’hémisphère sud), mais qui va lui attirer beaucoup d’ennuis. La pierre disparaît, ce qui permet à Jules Verne d’introduire dans son récit un peu statique, une course-poursuite à travers le bush du Transval ; tous les prétendants à la main d’Alice sont là et c’est donc comme une sorte de tournoi qui est organisé pour la conquérir. Dès lors les rebondissements s’enchaînent et l’on va de surprise en surprise (c’est la spécialité de Jules Verne), sur le diamant, sur le voleur, sur le mariage et sur le caractère des protagonistes.

Ce roman qui semble sans prétention est agréable à lire et comme toujours avec cet auteur populaire, peut être lu à deux niveaux :
- une aventure exotique qui se termine bien
- et par ailleurs une mise en scène des passions et des défauts des hommes (Wikipedia énumère : la spoliation, thème récurrent dans tous les romans des Voyages extraordinaires ; la justice, qui finit toujours par triompher ; la cupidité – en l’occurrence des Anglais – qui sera à l’origine de la guerre des Boers quinze ans plus tard et que Jules Verne semble annoncer ; la punition due à « l'annihilation des richesses par une abondance » de celles-ci, rendant leur valeur toute relative et tuant la passion et l'engouement des humains pour le matérialisme (puisque les diamants qui seraient fabriqués artificiellement ruineront toute l’activité d’exploration et d’extraction dans les mines) ; la responsabilité des hommes : « Bien des infortunes en ce monde sont ainsi mises au compte d'une malchance mystérieuse, et n'ont pour base unique, si l'on descend au fond des choses, que les actes mêmes de ceux qui les subissent ! »).
07:00 Publié dans Écrivains, Littérature, Livre, Roman, Verne Jules | Lien permanent | Commentaires (0)
14/04/2019
"Macron, un mauvais tournant" (Les économistes atterrés) : critique III
Au début de la partie 8 « Des stratégies alternatives », on retrouve – est-ce un hasard – le constat du livre extraordinaire de Naomi Klein « La stratégie du choc » : « Les institutions européennes imposent le triptyque : austérité budgétaire, compétitivité, réformes structurelles » mais ici les Économistes atterrés se contentent d’écrire sobrement que « Ce tournant, en France comme en Europe, s’appuie sur l’affaiblissement idéologique des classes populaires du fait de la désindustrialisation et de leur ethnicisation ». Chez Naomi Klein, le verdict était beaucoup plus anxiogène (si l’on peut dire), à savoir que ces tournants profitent de toutes les crises et de toutes les faiblesses des pays, quelles qu’elles soient, pour s’imposer, par la contrainte (voir le Chili, l’Argentine, l’Irak, plus récemment la Grèce).
Malheureusement, pour ce qui concerne le livre qui nous occupe, on retrouve encore page 222, la forte affirmation « Il nous faut montrer qu’il existe des alternatives »… 221 pages pour cela ! Et le lecteur attend toujours (11 pages pour les « stratégies alternatives » attendues sur 231 pages de constats critiques et d’analyses pertinentes, cela fait peu ; j’en reviens toujours à mon interrogation récente (cf. mon billet du 12 mars 2019) : où sont les économistes hétérodoxes ?).
À la limite, on voit bien quelle pourrait être cette société souhaitable « égalitaire, sobre, socialiste, mixte (privé à côté du public) » (page 223) mais ce qui nous manque, c’est le ou les scénarios de transition ! Le système actuel (néolibéral) s’appuie non seulement sur les fondements du libéralisme des siècles précédents mais sur les travaux de toute une école de pensée (Milton Friedmann et l’école de Chicago), couronnée au fil des ans par des dizaines de Prix Nobel, par des accords et des traités, nationaux et internationaux qui verrouillent le système, par des institutions (FMI, OCDE, BCE…) qui appliquent la même doxa et répandent – parfois de force – la même bonne parole.
Voyons maintenant ce que proposent nos Économistes atterrés…
« L’objectif d’égalité doit être placé au centre des préoccupations de la société » (page 223).
« Le premier objectif doit être de mettre fin à la domination de la finance » (page 224).
Voici donc en vrac les propositions du dernier chapitre :
- Séparation des banques de dépôt et de crédit
- Justification par les banques de l’emploi des sommes déposées par leurs clients
- Création de fonds pour le développement industriel
- Taxationdes transactions financières
- Interdiction du tradingà haute fréquence et des ventes à découvert
- Interdiction de la concurrence fiscale ou réglementaire entre pays européens (incidemment on voit qu’ils ne prévoient pas de sortir de l’UE mais n’excluent pas un bras de fer)
- Représentation au conseil d’administration des entreprises de toutes les parties constituantes
- Contrôle, voire nationalisation, des entreprises qui atteignent une certaine taille, qui disposent d’un pouvoir de monopole, qui jouent un rôle crucial dans l’évolution économique et sociale
- Fin du statut privilégié d’une couche étroite de dirigeants
- Favoriser la promotion interne plutôt que le parachutage
- Restaurer la logique du droit du travail
- Promotion de chaque salarié, avec des possibilités d’évolution et de carrière
- Limitation du travail intérimaire, des CDD, de la sous-traitance et du faux auto-entreprenariat
- Amélioration des conditions de travail, allègement des cadences
- Développement de l’économie sociale et solidaire
- Appui bancaire aux innovations qui correspondent à de réels besoins sociaux
- Investissements pour réduire les gaz à effet de serre
- Construction de logement
- Programme de rénovation urbaine pour supprimer les ghettos
À noter une phrase prémonitoire, page 227 : « La transition écologique ne peut s’effectuer uniquement par la hausse du prix de l’énergie et des activités polluantes, car les efforts pèseraient lourdement sur les plus pauvres, tandis que les plus riches seraient épargnés ». Il faut être « Marcheur » pour ne pas avoir compris cela, par anticipation. À quoi sert donc la « très grande intelligence » du Premier de cordée ?
Suivent quelques considérations – à très grands traits – sur un pacte écologique et sur un pacte social, tous deux nécessaires (page 228).
« Dans de nombreux domaines, les services publics sont plus efficaces, moins coûteux et favorisent plus la cohésion sociale que les entreprises privées : santé, éducation, transports collectifs » (page 228). Enchanté de cette confirmation mais (1) où sont donc les preuves chiffrées, (2) pourquoi personne ne vient-il dans les médias soutenir la contradiction avec la doxa néolibérale qui vise à éliminer ces mêmes services publics ?
« Ce modèle (social) doit être défendu contre les réformes que veulent imposer les sociétés d’assurance. Le développement des complémentaires santé et des retraites d’entreprise doit être combattu » (page 229).
Sur le chapitre social, le discours est souvent incantatoire, litanie de grandes idées généreuses sans aucune analyse ni de leurs modalités de mise en place éventuelle ni de leur faisabilité ni de leur coût ni de leurs effets secondaires. Exemple : « La France doit se donner des objectifs ambitieux en matière de lutte contre la pauvreté des enfants » (page 229).
Puis on revient à la finance :
- Impôt s’appliquant à tous les revenus des ménages selon leurs capacités contributives
- Annulation de la taxation uniforme des revenus du capital
- Rétablissement de l’ISF
- Poursuites contre les personnes qui s’installent à l’étranger pour des motifs fiscaux (équivalent du dispositif américain Fatca – a-t-on déjà pensé au jeu de mots fat catsà propos de ce dispositif ?)
- Arrêt de la baisse des cotisations sociales (tous les revenus salariaux doivent payer des cotisations, tous les revenus du capital doivent payer les prélèvements sociaux)
- Lutte contre l’optimisation fiscale des grandes entreprises et contre les paradis fiscaux
Sur le chapitre de l’emploi (pages 230 et 231) :
- Formation des nouveaux embauchés par les entreprises
- Parcours d’insertion individualisée proposés par Pôle Emploi aux jeunes en difficulté
- Sécurité professionnelle pour les salariés
- Emploi « de dernier ressort » dans les collectivités locales ou les associations pour les personnes confrontées à un « refus d’embauche »
Concernant l’union européenne :
- Hausse des salaires et des prestations sociales, en particulier pour les bas revenus (dans les pays de la zone euro accumulant les excédents) pour réduire par le haut les déséquilibres commerciaux et juguler les pressions déflationnistes (au lieu, comme actuellement, d’exiger des pays de l’Europe du Sud de baisser les salaires et les dépenses publiques)
- Promouvoir un plan d’investissement européen centré sur la transition écologique
- Militer pour que l’UE se donne clairement des objectifs de plein emploi (au lieu d’avoir les yeux rivés sur l’inflation et sur le pourcentage de déficit comme actuellement)
- Promouvoir des normes sociales et environnementales dans tous les traités commerciaux avant de les signer
- Plus généralement, assumer ses valeurs et son modèle social au lieu de se caler sur le modèle anglo-saxon
- En cas de blocage de l’Allemagne, proposer à l’Europe du Sud un pacte de reconstruction primant sur les règles néolibérales
Comme on le voit, même si elles ne sont ni justifiées ni chiffrées, les propositions ne manquent pas !
Dès que vous aurez lu ce billet (et les deux précédents), précipitez-vous devant votre téléviseur et écoutez Jupiter : combien de ses réponses à la crise des Gilets jaunes correspondront-elles aux propositions des Économistes atterrés ?
07:00 Publié dans Actualité et langue française, Économie et société, Essais, Les économistes atterrés, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0)



