24/03/2016
"Sentiments filiaux d'un parricide" (Marcel Proust) : critique
Les « petits » éditeurs semblent s’être fait une spécialité (lucrative ? ce n’est même pas certain…) de re-publier des textes mineurs ou inconnus ou « épuisés » des plus grands auteurs. Il y a aussi les « tirés à part ».
C’est ainsi que « Sur la lecture » de Marcel Proust avait été extrait de « Pastiches et mélanges » par l’éditeur « Mille et une nuits » en 1994 (à dire vrai, ce texte avait été publié plusieurs fois déjà par Proust en diverses occasions).
Et, en mars 2016, les Éditions Allia republient, du même auteur, « Sentiments filiaux d’un parricide ».
Couverture noire en harmonie avec le sujet, qui reproduit une page de journal de l’époque, courte citation de M. Proust en quatrième de couverture… l’éditeur a fait dans l’austère ! De l’austère à 3,10 € les 75 pages en très petit format… Ça se veut œuvre pour bibliophile ou pour « Proustolâtre » mais dans la postface de Gérard Berréby (qui par ailleurs n’est pas présenté ; qui est-ce ?), il y a deux énormes coquilles : d’abord l’article du Figaro est daté de 2013 et ensuite le Directeur du journal est appelé Gaston Camelette… Pas très sérieux !

Sur le fond, l’histoire est curieuse ; Marcel Proust, dans un article du Figaro de février 1907, s’intéresse à un fait divers sordide : un homme riche et connu poignarde sa vieille mère et se donne la mort.
Alors que les journaux des jours suivants voient dans le drame la conséquence d’un dérèglement psychiatrique (mélancolie, schizophrénie ? je ne sais pas trop), Marcel Proust, qui se rappelle d’abord qu’il a croisé cet homme que connaissait son père et avec lequel il a échangé quelques billets courtois de condoléances à l’occasion du décès qu’ils venaient l’un et l’autre de subir, interprète l’acte parricide comme la réédition du geste antique rendu célèbre par les mythes grecs d’Ajax et d’Œdipe.
C’est l’occasion pour lui de déployer en un long article son écriture caractéristique et ses références culturelles.
Mais quelle bizarre démonstration !
C’est au point que le directeur du Figaro, le fameux Gaston Calmette, lui demandera de supprimer sa chute, qui était celle-ci : « Rappelons-nous que chez les Anciens, il n’était pas d’autel plus sacré, entouré d’une vénération, d’une superstition plus profondes, gage de plus de grandeur et de gloire pour la terre qui les possédait et les avait chèrement disputés, que le tombeau d’Œdipe à Colonne et que le tombeau d’Oreste à Sparte, cet Oreste que les Furies avaient poursuivi jusqu’aux pieds d’Apollon même et d’Athênê en disant : Nous chassons loin des autels le fils parricide ».
En fait, donc, Marcel Proust « ne vit pas en M. van Blarenberghe uniquement un homme malade, dont la folie l’aurait mené à tuer sa pauvre mère. Non seulement il ne le présenta pas comme le meurtrier d’un sordide fait divers mais il l’envisagea comme un héros tragique. Son empathie ne se manifesta pas tant à l’égard de la victime que du criminel en faveur duquel, pour citer une expression utilisée dans un autre article du Figaro (…), il rédigea une défense lyrique ».
À moins de vouloir absolument utiliser un fait qui a frappé les esprits de l’époque pour publier un essai censé démontrer l’actualité et l’intemporalité des grands mythes psychologiques et pour réaffirmer son attachement à l’Antiquité, M. Proust, à part les qualités littéraires de son article, semble enfourcher l’habit commode des intellectuels qui ont toujours pu, de tous temps, du fond de leur splendide isolement, afficher de nobles sentiments inaccessibles au vulgaire…
Ou bien vole-t-il, égoïstement et tout simplement, au secours d’un membre de sa classe sociale, ancien élève de Polytechnique, membre du Conseil d’administration d’une grande compagnie de chemins de fer présidée par Papa ?
07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Livre, Proust Marcel | Lien permanent | Commentaires (0)
03/03/2016
Vive la République, vive les Lettres (II)
Le livre de Marc Fumaroli, en plus d’être remarquablement bien écrit, est, bien sûr, une synthèse sur l’histoire littéraire du Moyen-Âge à l’époque classique, dans laquelle on sent sa sympathie pour ces esprits savants, passionnés et solidaires. Il ne le dit pas mais leur réseau d’hommes cultivés est, dans sa pratique, aux antipodes de la mondialisation sans foi ni loi, de la concurrence exacerbée et des divertissements faciles.
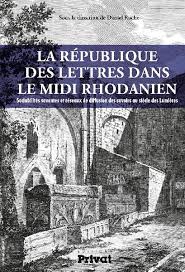 Il y a de l’élitisme, sans doute, chez Marc Fumaroli et chez ceux qu’il admire : les Pétrarque, Erasme, Nicolas de Peiresc, Bembo, Budé, Lipse, Gassendi… mais aussi de la solidarité, un goût pour la recherche et pour la « conversation » en marge de ce qui se fait à l’Université de l’époque… Ils vont utiliser l’imprimerie, la correspondance, les voyages, et constituer des bibliothèques privées. Leur langue va rester longtemps le latin. La « conversation » entre lettrés est à ce point un mode prioritaire d’échange et d’entretien de l’amitié que M. Fumaroli lui consacre un chapitre entier.
Il y a de l’élitisme, sans doute, chez Marc Fumaroli et chez ceux qu’il admire : les Pétrarque, Erasme, Nicolas de Peiresc, Bembo, Budé, Lipse, Gassendi… mais aussi de la solidarité, un goût pour la recherche et pour la « conversation » en marge de ce qui se fait à l’Université de l’époque… Ils vont utiliser l’imprimerie, la correspondance, les voyages, et constituer des bibliothèques privées. Leur langue va rester longtemps le latin. La « conversation » entre lettrés est à ce point un mode prioritaire d’échange et d’entretien de l’amitié que M. Fumaroli lui consacre un chapitre entier.
À l’origine, il y a le souhait de retrouver les textes des auteurs antiques, qui ont été protégés dans les monastères mais à l’occasion déformés et interprétés. Cet effort se fait dans le cadre de l’Europe chrétienne, sans opposition avec l’Église.
« L’alliance entre RESPUBLICA LITTERARIA et Respublica christiana fut dès les origines étroite. Pétrarque et ses héritiers n’ont opposé leurs studia humanitatis à la science scolastique des universités du nord de l’Europe que pour réformer et revivifier l’Église par l’étude savante des Pères des premiers siècles , et par une véritable résurrection érudite de l’Antiquité chrétienne, inséparable de la civilisation gréco-latine de l’Empire romain ».
Cependant…
« Cette grande aspiration des humanistes italiens à renouer avec le génie et la foi antiques, une fois transplantée dans le nord gothique et scolastique de l’Europe, a pris un tour infiniment plus dangereux pour l’unité de la Respublica christiana et pour l’orthodoxie romaine. Beaucoup moins tenu par la tradition italique, l’humanisme du Nord a penché très tôt vers le libre examen et une « modernité » théologique littéraire et scientifique difficile à admettre par l’Église romaine » (page 70).
(À suivre)
07:30 Publié dans Essais, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)
29/02/2016
Vive la République, vive les Lettres (I)
La République, tout le monde connaît : la Première (1792-1804), la Deuxième (1848-1852), la Troisième (1870-1940), la Quatrième (1944-1958), la Cinquième et actuelle (1958- ).
Les Lettres, tout le monde connaît : Corneille, Chateaubriand, Balzac, Hugo, Zola, Proust et tant d’autres ; la littérature quoi !
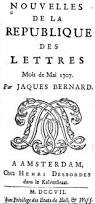 Mais la République des Lettres, kézako ?
Mais la République des Lettres, kézako ?
Il faut, pour le savoir, se plonger dans le merveilleux dernier livre de Marc Fumaroli « La République des Lettres » (Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 2015).
En 459 pages grand format, l’Académicien et ancien professeur au Collège de France, en compilant et révisant des articles qu’il a déjà donnés sur le sujet, nous explique qu’il s’agit d’un réseau de personnes savantes qui ont cultivé, à travers l’Europe, à la fois la connaissance, la recherche et l’amitié, avant la création des Académies officielles, puis en parallèle avec elles.
Cette République des Lettres, qui s’est dégagée du latin pour s’exprimer progressivement dans les langues romanes, est donc le précurseur, à la fois des Académies (mais sans leur rapport au Pouvoir), des Sociétés savantes, du tourisme culturel, des réseaux de recherche, de l’Europe sans frontière et du travail en réseau.
« Dans les trois derniers siècles de l’Ancien Régime, on appelait République des Lettres, cette société qui se cooptait elle-même dans la société et qui réunissait, pour coopérer dans le même usage studieux du loisir, par-delà les professions et les conditions ecclésiastiques et laïques, et même par-delà les frontières et les confessions, par la correspondance et les voyages, tous ceux qui œuvraient pour le bien commun de l’Europe de l’esprit, érudits et savants…
… de leur propre chef, sur leurs propres ressources, ces abeilles collaborant et conversant entre elles, dans le même otium studiosum (NDLR : loisir studieux) infatigable, accumulaient et augmentaient le miel et la cire de la remémoration historique, source vivante et sans cesse renouvelée des lumières du savoir et de la douceur des mœurs civiles.
Le syntagme « République des Lettres » eut un synonyme au XVIIIème siècle : l’Europe littéraire, où l’adjectif « littéraire » embrasse à la fois les belles-lettres et l’ensemble des disciplines érudites et savantes, théologie, droit, histoire, histoire naturelle, philosophie morale et politique, rhétorique et poétique des lettres et des arts, etc. »
On l’a vu dans ces quelques lignes, l’écriture de Marc Fumaroli est élégante, harmonieuse, balancée, riche ; c’est un plaisir renouvelé à chaque chapitre de le lire, même si la concaténation des différents articles nuit un peu à l’homogénéité de l’ensemble.
Nous en verrons d’autres exemples dans de prochains billets, qui éclaireront le concept de République des Lettres.
---------------------------
Remarque : « kézako », écriture phonétique de « quèsaco », vient de la locution occitane « Qu’es aquò ? » qui signifie « Qu’est-ce que c’est ? ». Attesté en 1730 (A. Piron) (Source : wiktionary)
07:30 Publié dans Essais, Histoire et langue française, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0)



