04/07/2016
"Un été avec Victor Hugo" (L. El Makki, G. Gallienne) : critique
J’avais « dévoré », dans la même série, « Un été avec Marcel Proust », dont je vous rendrai compte ultérieurement. Il faut dire que ce volume avait été conçu par un grand spécialiste de Proust, le professeur au Collège de France, Antoine Compagnon, qui avait confié à d’autres spécialistes des dissertations sur un certain nombre de thèmes permettant d’éclairer la Recherche. C’était dans le cadre d’une série d’émissions de France Inter, durant l’été 2013.
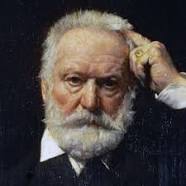 Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.
Ici, dans « Un été avec Victor Hugo », rien de tel ; c’est une productrice à France Inter, Laura El Makki, et un sociétaire de la Comédie française, Guillaume Gallienne, qui sont à la barre ; ce n’est plus de l’analyse littéraire mais plutôt un survol « journalistique » de la vie et de l’œuvre de Victor Hugo.
Pour se remémorer la trajectoire de ce géant de l’écriture et de ce militant de la lutte contre la misère ou tout simplement pour la découvrir, c’est très bien ; en plus de quarante chapitres courts, on balaye toutes les facettes de ce titan : la fameuse bataille d’Hernani, à cause de son souhait de révolutionner le théâtre, son attirance irrépressible vers les femmes et sa double vie avec Juliette Drouet, actrice de son état, son amour brisé pour sa fille Léopoldine (cf. le célébrissime poème des Contemplations : « Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne, je partirai… » et « Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps »), noyée lors d’une traversée en bateau près du Havre, ses démêlés avec la dynastie Bonaparte (Napoléon 1er et Napoléon le Petit) et l’exil à Jersey et Guernesey (pendant dix-neuf ans), son combat contre la peine de mort (cf. « Les derniers jours d’un condamné »), sa fascination pour la mer (cf. « Oceano nox » dans « Les travailleurs de la mer »), l’Art d’être grand-père, les honneurs et la gloire (député, pair de France, Académicien… et le million de Français qui l’accompagnent vers sa dernière demeure, le Panthéon) et tant d’autres événements – joyeux et douloureux – qui ont jalonné une vie extraordinairement remplie.
On découvre aussi dans ce petit livre des aspects inconnus du grand homme, par exemple ses expériences de spiritisme, au cours desquelles il fera tourner des tables !
Hélas, la compilation est plutôt plate et sans âme : on saute du coq à l’âne et surtout l’œuvre littéraire reste dans l’ombre (même si quelques extraits figurent par ci par là) ; nos auteurs sont sans doute fascinés par le personnage mais ne se risquent à aucune analyse approfondie de sa production littéraire ni de son importance au milieu du XIXème siècle ; ce n’était pas leur but et ce n’est pas leur spécialité.
Leur propre style d’écriture est d’ailleurs plutôt médiocre ; on croit retrouver, souvent, l’un de nos manuels scolaires : « A-t-il vraiment aimé ? N’était-ce qu’un rêve ?... Nous sommes ici en plein romantisme » (page 174).
Certaines phrases sont bancales : « En un mot : trouver la vérité du grand fil mystérieux du labyrinthe humain. Il a en tête, c’est La légende des siècles » (page 181).
Tout à coup, page 202, un chapitre entier sur Théophile Gautier… qui se termine par cette construction bizarre : « Dix ans plus tard, le jour de l’enterrement de Gautier, il arborera les mots d’un ami » (page 207).
Un autre chapitre est consacré au peintre Delacroix, ami de Hugo. « Delacroix expose La mort de Sardanapale et son audacité déclenche les foudres » (page 210). C’est vrai qu’un des logiciels que j’utilise se nomme « Audacity » mais bon…
 En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…
En conclusion, le principal intérêt de ce livre est de nous rappeler quel génie était Hugo et de nous donner envie de relire ses textes ; mes préférés sont « Les contemplations » et « Notre Dame de Paris » mais il m’en reste tellement encore à découvrir…
07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Hugo Victor, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
06/06/2016
"Le sanglot de l'homme noir" (Alain Mabanckou) : critique (2/2)
Dans « Le sanglot de l’homme noir » Alain Mabanckou parle de la place des Noirs, en Europe et en Amérique, de leur comportement face à l’histoire, de leurs relations avec les Blancs et entre eux, de la binationalité, de l’identité nationale, de l’attrait de l’Europe pour les Africains (je précise en passant que pour lui, l’Afrique, c’est l’Afrique noire ; il n’évoque que très rarement le Maghreb, pourtant francophone, et jamais l’Afrique du Sud), du sort de l’immigré, de la diversité, du droit du sol, du commerce triangulaire (ironie de l’histoire, il commence ses études à Nantes !), de la francophonie (voulue ou subie)… le tout en 175 pages denses et néanmoins alertes.
 Et il raconte ses études de droit économique et social à Nantes, puis à Dauphine, passe très rapidement sur les dix ans passés à Suez-Lyonnaise des Eaux pour arriver à son recrutement comme professeur de littératures francophones en Californie : « Si j’ai accepté d’aller enseigner aux États-Unis, c’est parce que je ne me couperais pas pour autant de cette langue d’écriture qui est la mienne : le français. J’ai exigé d’enseigner en français – ce qui est toujours le cas à ce jour. J’ai aussi souhaité enseigner, outre les auteurs africains, certains auteurs français que j’apprécie. Il se trouve que j’allais, bien malgré moi, devenir l’ambassadeur d’une culture et d’une langue que j’avais reçues par la colonisation. En enseignant les textes d’écrivains africains d’expression française, j’avais pour mission indirecte de veiller à la diffusion de la langue auprès des étudiants américains » (pages 113-114).
Et il raconte ses études de droit économique et social à Nantes, puis à Dauphine, passe très rapidement sur les dix ans passés à Suez-Lyonnaise des Eaux pour arriver à son recrutement comme professeur de littératures francophones en Californie : « Si j’ai accepté d’aller enseigner aux États-Unis, c’est parce que je ne me couperais pas pour autant de cette langue d’écriture qui est la mienne : le français. J’ai exigé d’enseigner en français – ce qui est toujours le cas à ce jour. J’ai aussi souhaité enseigner, outre les auteurs africains, certains auteurs français que j’apprécie. Il se trouve que j’allais, bien malgré moi, devenir l’ambassadeur d’une culture et d’une langue que j’avais reçues par la colonisation. En enseignant les textes d’écrivains africains d’expression française, j’avais pour mission indirecte de veiller à la diffusion de la langue auprès des étudiants américains » (pages 113-114).
Enfant unique d’une famille « compliquée » mais aimante, Alain Mabanckou est quelqu’un qui recherche et prend des positions modérées, équilibrées, objectives… sur le colonialisme, la négritude, l’immigration, son pays d’accueil (la France), les Français, sur son pays natal (le Congo), sur la littérature et sur la langue. Concernant ce dernier point, il s’insurge, dans le chapitre « La littérature à l’estomac », sur un courant « africaniste » qui prêche l’abandon du français, langue du colonisateur, en tant que langue d’écriture. Et son argument est double : ce qui compte avant tout, c’est le talent (« Si dans le terme écrivain francophone, l’adjectif francophone est de trop pour certains, peut-être faudrait-il commencer par être écrivain tout court ») (page 138) ; et ensuite, pour lui « Il y a longtemps que la langue française est devenue une langue détachée de la France et que sa vitalité est également assurée par des créateurs venus des cinq continents » (page 137).
Après avoir lu un roman et deux essais d’Alain Mabanckou, je me demande s’il n’excelle pas, surtout, dans l’analyse des idées – ce qui légitime sa position de professeur de littérature – et si ses essais ne sont pas plus intéressants, pour un lecteur français ou européen, que ses romans où les thèmes récurrents restent pour nous exotiques et magiques. Je vais essayer de confirmer cela en lisant un autre roman, « Lumières de Pointe-Noire ».
07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Francophonie, Littérature, Livre, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)
02/06/2016
"Le sanglot de l'homme noir" (Alain Mabanckou) : critique (1/2)
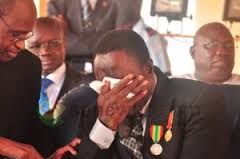 Deuxième livre cité dans sa leçon du 10 mai 2016, « Le sanglot de l’homme noir » a été publié par Alain Mabanckou dans la collection « Points » des éditions Fayard, en 2012. Il y revient sur les causes et les conséquences de l’esclavage (commerce triangulaire occidental mais aussi rôle des Arabes et des notables africains). Les 175 pages de son livre sont un régal de langue française, d’érudition, d’humour et de rhétorique. Il a emprunté son titre à Pascal Bruckner, pour signifier qu’il reprenait le même thème : le sentiment de culpabilité, la mauvaise conscience, la haine de soi, le repentir, lorsque les Européens se penchent sur leur passé colonialiste. Mais là, il s’adresse aux victimes, les Africains eux-mêmes et il leur dit que les « Blancs » ne sont pas les seuls responsables, que l’esclavage existait avant leur arrivée sur le continent et qu’ils doivent maintenant construire quelque chose et arrêter « l’inventaire ». C’est une sorte de suite à sa « Lettre à Jimmy » (voir mon billet du 30 mai 2016). Il cite le roman du Malien Yambo Ouologuem « Le devoir de violence », prix Renaudot 1968 (pour la première fois un auteur d’Afrique noire francophone obtenait un des grands prix littéraires français) : « C’était également la naissance de l’autocritique, indispensable si l’on veut que soient fondés les reproches adressés aux autres. C’était une hardiesse, au moment où tout écrivain africain était censé célébrer aveuglément les civilisations africaines et décrire un continent où tout était calme et pacifique avant l’arrivée des méchants Européens, boucs émissaires de prédilection lorsqu’on ne s’explique pas l’enlisement des États africains après leur émancipation, à partir de la fin des années cinquante » (page 128).
Deuxième livre cité dans sa leçon du 10 mai 2016, « Le sanglot de l’homme noir » a été publié par Alain Mabanckou dans la collection « Points » des éditions Fayard, en 2012. Il y revient sur les causes et les conséquences de l’esclavage (commerce triangulaire occidental mais aussi rôle des Arabes et des notables africains). Les 175 pages de son livre sont un régal de langue française, d’érudition, d’humour et de rhétorique. Il a emprunté son titre à Pascal Bruckner, pour signifier qu’il reprenait le même thème : le sentiment de culpabilité, la mauvaise conscience, la haine de soi, le repentir, lorsque les Européens se penchent sur leur passé colonialiste. Mais là, il s’adresse aux victimes, les Africains eux-mêmes et il leur dit que les « Blancs » ne sont pas les seuls responsables, que l’esclavage existait avant leur arrivée sur le continent et qu’ils doivent maintenant construire quelque chose et arrêter « l’inventaire ». C’est une sorte de suite à sa « Lettre à Jimmy » (voir mon billet du 30 mai 2016). Il cite le roman du Malien Yambo Ouologuem « Le devoir de violence », prix Renaudot 1968 (pour la première fois un auteur d’Afrique noire francophone obtenait un des grands prix littéraires français) : « C’était également la naissance de l’autocritique, indispensable si l’on veut que soient fondés les reproches adressés aux autres. C’était une hardiesse, au moment où tout écrivain africain était censé célébrer aveuglément les civilisations africaines et décrire un continent où tout était calme et pacifique avant l’arrivée des méchants Européens, boucs émissaires de prédilection lorsqu’on ne s’explique pas l’enlisement des États africains après leur émancipation, à partir de la fin des années cinquante » (page 128).
Ce livre, retiré de la vente en France pour une vague accusation de plagiat, a eu beaucoup de succès à l’étranger et a été enseigné dans les universités du monde entier. « (Il) est un des romans incontournables de l’histoire de la littérature africaine d’expression française, avec Les soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma, La vie et demie de Sony Labou Tansi et Le pleurer-rire d’Henri Lopes » (page 129).
Bien sûr, il y a une présence noire dans la France d’aujourd’hui mais, selon lui, la « France noire » n’existe pas, à cause de l’histoire, qui est bien différente de celle des Noirs américains (qu’il appelle les Africains-Américains). Pour la France métropolitaine, les Noirs ont d’abord été des sauvages et des indigènes, puis des tirailleurs, et c’est ainsi qu’est née à Paris, en réaction, la notion de « négritude », dont on a déjà parlé.
Bien sûr Alain Mabanckou évoque la situation de l’immigré, fustige les position de l’extrême-droite et proclame son attachement aux vertus républicaines et à la France, son pays d’adoption (ses parents, Congolais, étaient français puisque nés avant l’indépendance).
Mais il raconte surtout ses rencontres avec des Français, ici ou là, qui lui demandent inlassablement de quel pays il est. Il raconte ses déboires d’étudiant noir arrivant à Nantes pour étudier, puis ses débuts d’enseignant à Ann Arbor dans le Michigan.
Une anecdote sur le français est intéressante : « La langue (française) que nous utilisions était raillée (à Nantes) aussi bien en cours qu’au restaurant universitaire. On n’employait plus l’imparfait du subjonctif en France… Or nous y tenions comme à la prunelle de nos yeux ! De notre côté, la langue des autochtones nous paraissait pauvre, pervertie par une paresse désolante. Ces jeunes gens avaient appris le français dans les jupes de leurs mères, et adopté, selon nous, les raccourcis les plus abominables, ainsi que cette manie de contourner la difficulté des concordances de temps en se réfugiant derrière une prétendue évolution de la langue… Cette attitude nous chagrinait, nous qui avions enduré le fouet pour un participe passé mal accordé » (page 107).
07:30 Publié dans Écrivains, Essais, Francophonie, Histoire et langue française, Littérature, Livre, Mabanckou Alain | Lien permanent | Commentaires (0)



