04/12/2023
"Ciné-club" (François Souvay) : critique I
Que voici un livre original ! Je parle de « Ciné-club » de François Sauvay, publié chez Champ Vallon en 2022. L’auteur nous propose une suite de chroniques sur le cinéma, de son apparition à la fin du XIXème jusqu’aux années 60, et même un peu plus. Vingt-cinq courts chapitres fourmillent d’anecdotes sur le milieu du cinéma aux États-Unis, c’est-à-dire à Hollywood, et sur ses vedettes. L’auteur raconte ces histoires à la façon d’un journaliste de la presse culturelle (les Cahiers du cinéma, Télérama, etc.), sauf que TOUT est inventé. Et c’est à s’y méprendre tellement le pastiche est crédible, tellement le ton est juste, tellement les événements, les patronymes, les noms de films, le comportement des divas comme des producteurs, et les situations, sont vraisemblables. L’histoire tourne autour d’une petite compagnie de production, Olympic Movies, de son patron Elmer Polack, d’un curieux conseiller en textes sacrés et caution religieuse, Matthieu de Lenoncourt, et d’une pléiade de scénaristes et de stars, plus ou moins éphémères.
Quelle imagination, quelle inventivité ! Comme un musicien qui improvise, François Sauvay multiplie les motifs, les angles d’attaque, les ambiances, les personnages... C’est un régal.
Certaines descriptions sont vertigineuses, comme quand il nous parle d’un film sur un film (c’est-à-dire dont le héros est lui-même un acteur ou un scénariste en train de faire son métier).
J’ai noté quelques coquilles, qui sont loin de gâcher le plaisir de notre lecture.
- page 19 : une répétition malvenue « elle s’était fait remarquer, d’apparitions notables en rôles secondaires remarqués ». Notons avec satisfaction que notre auteur écrit bien « elle s’est fait remarquer... » et non pas comme tant de journalistes malheureusement « elle s’est faite » (le wokisme en l’occurrence n’a rien à y voir !).
- page 29 : « parmi les acteurs habituels du studio, catalogué jusque-là dans des personnages de cow-boy... ». Je pense qu’il aurait mieux valu écrire « cantonné jusque-là dans des personnages de cow-boy ».
- page 98 en italique, et aussi pages 133, 167 et 171 : la curieuse expression « department story » semble vouloir désigner un département des scénarios... mais en anglais cela donnerait plutôt « Story Department », voire « Storyboard Department ».
- page 138 : manifestement il y a un « s » en trop au verbe demander : « Puis je me demandais si la nouvelle qu’elle m’avait confiée était si mauvaise ». « Puis je me demandai », c’est du passé simple (sur dans le contexte où la relative concerne également un événement unique), donc sans « s » ! Un peu plus loin l’auteur écrit à juste titre : « Quand Polly Griffin en sortit timidement, je l’abordai enfin ». Mais, plus loin encore, il écrit : « déconcerté par cette réponse ambigüe, je la laissais s’échapper à nouveau ». Non ! « je la laissai s’échapper », c’est du passé simple (événement unique) et non de l’imparfait (répétition, habitude), donc sans « s ». À vrai dire, j’avais déjà tiqué page 116 : « Elle m’offrit un thé auquel je préférais une Budweiser ». Non, ce n’était pas une habitude chez ce conducteur de tramway entiché de Noreen Venice de refuser des tasses de thé, alors même qu’elle ne lui en a proposé qu’une seule fois. Donc pas de « s » !
C’est l’inverse page 171 : « alors que je pensai lui administrer une correction » ; le verbe « penser » mérite l’imparfait, donc il faut écrire « je pensais » avec un « s ». Et re page 299 ! « Je serai rassurée si vous me disiez que je vous ai aidé ». La relative est au conditionnel, alors la principale ne peut pas être au futur ; donc « Je serais » avec un « s » qui modifie le mode du verbe (de l’indicatif on passe au conditionnel). La phrase suivante, en revanche, est correcte : « Je serai touchée si vous m’envoyez un exemplaire ». - page 153 : « les nombreux incidents qui ont gâché le tournage d’Achille et les Amazones etc. ». Sauf que, à plusieurs endroits page 152 et aussi dans le haut de la page 153, le film s’appelle « Achille contre les Amazones »... y’a une petite erreur.
- page 155 : « ... plus exactement récit éclaté et mise en abîme ». Le mot « abîme » est écrit avec un « y » au lieu d’un « î ». Rappelons-nous le collège : « le circonflexe de cime est tombé dans l’abîme ».
- page 173 : l’auteur écrit « presque mal la tête », donc manifestement il faut lire « presque mal à la tête »
- page 197 : « Telles des proies, ils sont lâchés dans les ruelles désertes. « Telles » ne devrait pas être au féminin puisque le sujet de la phrase principale, c’est « ils ».
- page 206 : « épluchant les entretiens... de nombreuses incohérences la frappaient ». Cette phrase est incohérente justement ! Comme elle commence par « épluchant les entretiens », sa principale devrait être : « elle a été frappé par des incohérences ». C’était déjà la même chose page 128, quand la relative était « après s’être retrouvés sur la plage » et que la principale commençait par « Lamont lui signifia son congé ».
- page 226 : « On espère que la suite de sa carrière confirmera ce talent prometteur ! Or, voilà l’article paru dans Hollywood ScreenLand ». Il aurait fallu écrire « voici l’article » puisqu’on va seulement expliquer le problème (« voilà » se rapporte ce qui s’est déjà passé, tandis que « voici » annonce ce qui va se passer).
18:21 Publié dans Écrivains, Film, Littérature, Livre, Roman, Sauvay F. | Lien permanent | Commentaires (0)
21/09/2023
"Attaquer la terre et le soleil" (Mathieu Belize) : critique
Quelle déception !
J’avais beaucoup aimé « Notre terre » de Mathieu Belezi (voir mon billet du 31 août 2015), qui racontait la fin de la guerre d’Algérie, vue des deux côtés.
J’avais appris depuis que M. Belezi n’était pas historien et n’avait pas vécu en Algérie mais qu’il avait consacré trois romans à ce thème, pour la raison, semble-t-il, que la littérature ne s’y était pas beaucoup intéressée (?).
J’avais lu aussi le roman de Leïla Slimani, « Le pays des autres », paru en 2020, en partie autobiographique sans doute, qui se passe lui au Maroc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je l’avais trouvé moins bon…
C’est dire si je me suis plongé avec impatience dans « Attaquer la terre et le soleil », tout auréolé du Prix du Livre Inter, que NR venait de m’offrir. Un rapide coup d’œil sur l’enregistrement de l’entretien à France Inter, de l’auteur et de quelques membres du jury (présidé sauf erreur par David Foenkinos, Prix Renaudot), ne m'avait pas enthousiasmé ; j’avais eu l’impression que le jury avait surtout récompensé une œuvre « dans l’air du temps » (à savoir, rappeler le mauvais rôle de colonisateur de la France en Afrique …), sachant par ailleurs que les premiers commentaires des débatteurs étaient que « le livre n’avait aucun défaut » et qu’ils avaient été emballés par la forme et le ton du texte. Bon, rien de très motivant, d’autant que la brièveté du roman (153 pages seulement chez Le tripode, avec beaucoup de blancs sur chaque page…) m’avait déjà refroidi.
Le titre d’abord. On peut penser que M. Belezi veut décrire la conquête de l’Algérie, en 1830, comme une lutte pour y introduire l’agriculture sous un soleil de plomb, ce qui va rendre l’aventure extrêmement pénible pour les premiers colons. Le roman est composé de courts chapitres donnant à voir, alternativement, la vie d’une femme et de sa famille arrivées de métropole, et celle d’un militaire dont le chef répète à tout propos : « Vous n’êtes pas des anges ». Quand le narrateur reprend la parole, M. Belezi utilise les italiques.
La forme est déconcertante car la ponctuation est absente, ainsi que les majuscules en début de phrase. C’est sans doute cela qui a tant plu aux jeunes lectrices du jury… Heureusement, les paragraphes successifs sont « indentés », ce qui aère le texte. On a échappé aux tics insupportables d’un Claude Simon (« La route des Flandres », « Histoire »).
Sur le fond, il faut bien reconnaître que les autochtones, bien qu’envahis, ne sont pas présentés comme des enfants de chœur. Comme dans « C’était notre terre », Mathieu Belezi ne recule devant aucune des horreurs de la guérilla (femmes éventrées, etc.). L’armée française n’est pas en reste : représailles, villages rayés de la carte, ripailles, jeunes femmes gardées pour la troupe… Pour être réaliste, oui, c’est réaliste !
Le choléra frappe aussi, avec son cortège d’hommes et d’enfants emportés au cimetière, et des femmes qui pleurent et implorent le Ciel.
Petit à petit, les colons se voient attribuer des parcelles et s’établissent, il y a des mariages, sans que cela n’interrompe ni les assassinats ni les représailles. Et certains ne résistent pas à la peur permanente, aux drames et à la difficulté de vivre… ils renoncent à leur concession et reprennent le bateau pour la métropole.
On ne peut contester à Mathieu Belezi sa maîtrise pour rendre l’horreur et le déchaînement de violence qui ont accompagné cette conquête. Et il est sans doute indispensable d’en rendre compte parce que ce n’était pas écrit dans nos manuels scolaires. Mais d’où vient cette impression que l’on n’apprend pas grand-chose et que le roman aurait pu être situé n’importe où. Peut-être a-t-il manqué à l’auteur une documentation plus fournie ou une intime connaissance des lieux, tels que pourrait les rendre, par exemple, un Boualem Sansal ? Ou alors il a voulu écrire une métaphore de toute conquête ? (Pas celle des États-Unis parce que les Américains se sont empressés de nous endoctriner avec leurs « westerns » !).
Au total, je suis resté sur ma faim et n’aurai pas envie de relire ce roman-reportage.
PS. Le jour de la publication de ce billet (21 septembre 2023), je vérifie dans le calendrier que le prénom de celui que l’on fête s’écrit bien avec deux t. Facétie, ignorance ou négligence de l’État-civil, notre « Mathieu » ne comporte qu’un seul t. Dans le domaine des prénoms aujourd’hui, on ne peut plus s’étonner de rien ni rien déplorer. Cela étant, nom et prénom de l’auteur sont empruntés…
07:00 Publié dans Belezi Mathieu, Écrivains, Histoire et langue française, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)
31/03/2023
Emily, jolie !
Il y a plusieurs semaines j’ai vu le film américano-britannique « Emily » de la réalisatrice Frances O’Connor. Il s’agit d’une biographie (les franglophones disent un « biopic », d’une part parce que « c’est américain », donc bien, et d’autre part parce que la racine « graphie » de « biographie » renvoie à l’écrit et non à l’image ; mais on parle bien « d’écriture cinématographique »…) de l’une des célèbres sœurs Brontë, celle qui a écrit « Les Hauts de Hurlevent » en 1847, son unique roman. [Somerset Maugham le citait en 1954 comme l’un des dix plus grands].
Le film, plutôt long (plus de deux heures), est captivant parce que l’histoire l’est et parce qu’elle est traitée « sans longueurs » (!), avec un souci esthétisant de bon aloi : beaux paysages, belle photo, belle musique, beaux costumes, mise en scène et déroulé impeccables, comme on les aime depuis… Barry Lindon. C’est dire que l’on passe un bon moment, que l’on s’instruit et que le dépaysement est au rendez-vous (pas de crise énergétique ni financière, pas de menace climatique ni démographique, pas de wokisme, pas de violence physique… uniquement les sentiments, la littérature et les drames de la vie).
Je raillais plus haut les franglophones mais je dois dire que nous autres, Français francophones, savourons aussi ce film parce que notre langue y est à l’honneur, étant l’objet d’un apprentissage assidu de la part de nos héroïnes et avec des résultats d’une qualité étonnante. Un film quasi bilingue, sachant que, précisément, les leçons de français jouent un rôle non négligeable dans le destin, plutôt funeste, des membres de cette famille.
L’héroïne, c’est Emily Brontë, jeune fille peu loquace, timide, renfrognée, frondeuse mais qui à la fois obéit à son père et cherche son amour. Elle est précédée et suivie de plusieurs sœurs (on ne parle pas dans le film des deux aînées décédées de tuberculose à l’âge du collège) et d’un plus jeune frère, qui nourrit pour elle une affection excessive qui fera son malheur (à elle) et décidera sans doute de sa vocation littéraire. En résumé, on est en compagnie de Charlotte, d’Emily, d’Anne et de Branwell (curieusement il porte comme prénom, le patronyme de sa tante). Leur mère, fragile, étant décédée précocement, c’est donc leur père, pasteur, qui les élève, de façon plutôt sévère et rigoriste.
Ah, encore un point sur le film : les acteurs sont crédibles et touchants, bref excellents. La critique a particulièrement salué l’héroïne, Emma Mackey, qui est effectivement remarquable.
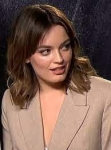
Soulignons en passant qu’on a l’impression de l’avoir déjà vue quelque part… En effet :

Mais ce blogue n’est pas dédié à la critique cinématographique... Pourquoi donc ce billet sur le film « Emily » ?
Tout simplement parce qu’il m’a rappelé ce que j’ai lu dans « Suite anglaise », livre dans lequel Julien Green présente cinq écrivains anglais qui, en 1927, lui semblent peu connus du public français (cela est toujours vrai aujourd’hui !). Parmi ces écrivains, Charlotte Brontë (1816-1855)… Tiens, tiens, la sœur aînée d’Emily, qui a écrit plus tard Jane Eyre ! Je ne vais pas ici commenter à nouveau « Suite anglaise » (se reporter au billet du 10 novembre 2021) mais je veux seulement souligner comme les personnages de Charlotte et d’Emily y sont traités de manière bien différente. D’abord Julien Green parle essentiellement de Charlotte, qui, selon lui, n’était ni insignifiante ni jalouse. Au contraire elle s’est dévouée à l’éducation de ses sœurs et a tenu la maisonnée à la place de la mère disparue. Sa fin de vie a été horrible ; son père, qui avait longtemps refusé qu’elle se marie avec l’élu de son cœur, avait fini, au bout d’un an ou deux, par y consentir ; Charlotte s’est donc mariée mais, épuisée, s’est éteinte quelques mois plus tard. Quant à Emily, présentée dans le film comme fantasque, provocatrice, adepte du mysticisme et surtout immaîtrisable, voici ce qu’en dit Julien Green : « Emily, au contraire, souffrait tellement de vivre loin de Haworth [NDLR : la maison familiale] qu’il fallut l’y renvoyer au bout de trois mois. Elle ne se plaignait pas mais elle s’affaiblissait de jour en jour et l’on comprit enfin qu’on abrégeait sa vie en la gardant à Roe Head [NDLR : le pensionnat]. Elle retourna donc à la maison de son père, honteuse, malgré tout ce que l’affection de ses sœurs trouvait à lui dire pour la consoler ; elle se mit alors à travailler de toutes ses forces. Elle s’occupa de la cuisine [NDLR : Charlotte est, à ce moment-là, gouvernante au pensionnat], repassa le linge de la famille et, comme la vieille servante Tabby devenait infirme, Emily prit sa place et se chargea elle-même de faire le pain. Toutefois, elle n’oubliait pas ses études et on la voyait, les mains dans la pâte, jeter de temps à autre un coup d’œil sur une grammaire allemande qu’elle avait posée devant elle ». Quand Charlotte est de retour à la maison « Les deux sœurs avaient bien des choses à se confier et elles attendaient pour cela que tout le monde fût couché ». Emily approuva de tout son cœur le projet de sa sœur de solliciter l’avis du poète lauréat d’Angleterre sur des textes qu’elle avait écrits. On lit cependant que « Emily ne parvenait jamais à dire un mot. Elle n’ouvrait son cœur à personne et vivait repliée sur elle-même. Elle n’était pas accoutumée à la soumission qu’on attendait d’elle au pensionnat mais elle sacrifia sa volonté sans protester un instant ». Son frère Branwell, artiste, beau garçon, éloquent, ne semble pas aussi instable et détraqué que veut bien le montrer le film mais sans doute le diagnostiquerait-on aujourd’hui comme « bipolaire ». Toujours à propos de Branwell, une anecdote amusante : il fut renvoyé de là où il avait trouvé une place de précepteur. Devinez pour quelle raison ? Il était tombé amoureux de la mère de son élève et l’avait séduite, tel Julien Sorel. Et ce n’est pas tout. Comment donc s’appelait cette femme de vingt ans son aînée ? Mrs Robinson, oui ! Est-ce donc là l’origine de l’épisode du film « Le lauréat » et de la célèbre chanson de Paul Simon ?
C’est la honte dans la famille, les trois sœurs se replient sur elles-mêmes, se mettent à écrire et publient ensemble. Puis chacune leur tour : « Jane Eyre » d’abord, « Wuthering Heights » ensuite, et plus tard « The Tenant of Wildfell Hall ». Mais la critique londonienne s’obstinait à considérer qu’ils étaient tous l’œuvre d’un seul écrivain, et évidemment masculin… « On voyait dans « Wuthering Heights » un premier essai plein de promesses dont Jane Eyre était en quelque sorte l’accomplissement ; et il y a en effet dans Jane Eyre plus d’habileté technique, quelque chose de plus poli que l’art un peu sauvage de Wuthering Heights, mais l’opinion a changé depuis et beaucoup n’hésitent plus à placer le roman d’Emily au-dessus de celui de sa sœur aînée ».
C’est donc peut-être là la justification de la remise au premier plan d’Emily…
Les trois sœurs Brontë moururent dignement, l’une après l’autre, mais avec la même résignation et le même courage.
18:13 Publié dans Brontë E., Écrivains, Film, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)



