05/12/2016
"Comment peut-on être français ?" (Chahdortt Djavann) : critique II
« Mon arrivée à Paris fut une fête (…). On pouvait à loisir se promener où l’on voulait quand on voulait ? Aucune police des mœurs ne décidait à votre place de ce qu’il vous était loisible de dire ou de faire ? Il faut avoir connu les rigueurs de l’obscurantisme pour apprécier à leur juste valeur les joies simples de la vie quotidienne, dont ceux qui n’en ont jamais été privés, à mesure qu’ils en perdent la saveur oublient la nécessité. Marcher tête nue sous la bruine d’automne ou au premier soleil du printemps, prendre un verre à la terrasse d’un café, faire la queue à la porte d’une salle de spectacle en bavardant avec ses voisins sans considération de leur sexe, se laisser aller, chantonner, rêver, prendre le bras de celui qui vous plaît et, pourquoi pas ? l’embrasser en public sans gêne particulière : toutes ces attitudes, tous ces gestes qui paraissent naturels aux jeunes Parisiennes d’aujourd’hui sont impensables dans le pays d’où je viens, le pays de la peur et de la honte (…). Les femmes ne naissent toujours pas libres dans les pays musulmans. Elles restent soumises à la nécessité de leur condition, établie par les dogmes. Les fillettes sont souvent voilées dès l’âge de six ans car, aux yeux des religieux, il n’est jamais trop tôt pour priver les gens de la liberté. » (page 156).
Le passage à la forme épistolaire fait basculer le roman et l’oriente, une fois de plus, dans une autre direction. Car, dans ses lettres à Montesquieu, Roxane décrit et dénonce le cauchemar imposé par les mollahs au peuple iranien. Dix ans après la publication de ce livre « Comment peut-on être français ? », c’est toujours d’actualité, malheureusement.

Roxane raconte l’histoire de sa famille et, au-delà, de son pays : « Pendant plus de cinquante ans, de 1925 à 1978, des réformes et des évolutions de tout genre ont balayé les lois féodales qui avaient régi la société iranienne durant des siècles. L’Iran a connu un essor important et beaucoup de nouveaux riches ont grimpé sur les collines d’Alborze, au nord de Téhéran, et se sont installés dans des villas (…). Le voyage de l’Iran à Paris n’était pas simplement un déplacement dans l’espace et un changement de pays mais surtout un voyage dans le temps. La preuve : nous sommes en l’an 2000 en France et en Iran en 1379. Comment peut-on vivre en 1379 en l’an 2000 ? Les mollahs ont tout falsifié dans ce pays, le temps et l’histoire, même les actes de naissance des Iraniens, même le calendrier. Sur les photos d’identité, toute femme, toute fillette est voilée, et sur le passeport de tout Iranien, la photo de Khomeini, le mollah des mollahs, apparaît en filigrane sur toutes les pages (…). Lorsqu’ils ont usurpé le pouvoir, nous étions en 2538, selon la datation qui partait de la création de la dynastie des Sassanides et de la fondation de Persépolis. Les mollahs ont rembobiné la marche du temps et nous ont ramenés en 1357, selon la datation qui partait de la création de l’islam et du départ de Mahomet de Médine vers La Mecque » (pages 171 et 172).
Roxane a un oncle d’Amérique, qui s’appelle Sam (évidemment) et qui vient leur rendre visite : « Le séjour de la famille de l’oncle Sam (…) m’a permis de comprendre les avantages qu’il y avait à ne pas comprendre la langue de sa famille. Comme il était déjà trop tard pour que je ne comprisse pas le persan, je me suis dit que, quand je serai grande, j’irai moi aussi à l’étranger, loin, et apprendrai une autre langue (NDLR : il y a ici l’une des rares fautes de français de l’ouvrage ; une faute « bien française » ! C’est évidemment le conditionnel qu’il aurait fallu employer : que, quand je serais grande, j’irais moi aussi ; la faute vient de la confusion entre les styles de narration direct et indirect). (…) À l’époque, pour être honnête, je croyais que ce serait l’anglais. Mais aujourd’hui, je préfère que ce soit le français » (page 191).
Page 217, je retrouve des souvenirs personnels : « Tous les dimanches, à l’exception des jours de grand froid ou de pluie torrentielle, Roxane se levait de bonne heure. Elle allait au Luxembourg. Elle se préparait un sandwich royal : une demi-baguette fraîche garnie de feuilles de salade, de tomates coupées en rondelles, de fins cornichons, et, bien sûr, de deux tranches de jambon (NDLR : savourez le bien sûr…). (…) Elle emportait son viatique préféré, À la recherche du temps perdu – le temps perdu, Roxane savait ce que c’était –, ainsi que son compagnon de toujours, son Micro-Robert ». N’est-ce pas un miracle qu’une jeune Iranienne, traumatisée par ses années de jeunesse sous le règne des mollahs, porte aux nues l’œuvre qui est comme la quintessence du génie littéraire français, et qu’elle la lise, comme tous les étudiants du Quartier latin que nous avons été, sur un banc du Luco, armée d’un sandwich ?
« C’est une chose bien étrange : dans ce même moment de notre histoire où certains hommes s’emploient à triompher des maladies jusqu’ici invaincues, à visiter les astres ou à reproduire l’énergie du soleil, d’autres ne se soucient que du voile des femmes ; ils se demandent quel tissu, quelle couleur, quelle longueur seraient aptes à mieux dissimuler la chevelure des femmes, de quel pied, le droit ou le gauche, il faut entrer dans les toilettes, et s’il est permis de manger une volaille sodomisée… » (page 266).
Que n'a-t-on lu Djavann plus attentivement en 2006 ! Ses mots résonnent aujourd'hui de cruelle façon : "(...) Il ne manque pas de mollaks, comme vous dites, pour les pousser dans cette voie, et quelques-uns sont même partis faire la guerre qu'ils appellent Djihad en Afghanistan. Les malheureux ! S'ils avaient la plus petite idée de ce qu'est un régime religieux, je pense qu'ils rougiraient de prétendre échapper aux duretés de l'exclusion par les folies de l'aliénation. Je crois bien que, s'ils jugeaient les pays qui leur servent de modèles et d'inspirateurs à l'aune de leurs exigences lorsqu'ils jugent celui où ils vivent, ils se persuaderaient aisément que leur avenir n'est pas ailleurs et qu'ils ont mieux à faire, ici, que de veiller à la vertu de leurs sœurs faute de les égaler à l'école" (page 247).
Envahie par la nostalgie, tiraillée par ses souvenirs, écartelée entre deux cultures si différentes, isolée, seule, Roxane va de plus en plus mal. Les lettres à Montesquieu ne suffisent plus à adoucir son mal-être.
Le drame est proche. « Être arrêté sans avoir rien fait est si familier aux Iraniens que l’univers kafkaïen est leur lot quotidien. Nuit et jour, il y a des situations tout droit sorties des romans de Kafka dans les rues de l’Iran » (page 274).
Je ne dirai rien des derniers chapitres ; le conte de fées bascule dans l’horreur ; on comprend l’itinéraire de Roxane, pourquoi et comment elle est arrivée à Paris, pourquoi et comment elle ne peut surmonter son traumatisme initial, pourquoi et comment la névrose s’est installée, et on espère qu’elle va réussir à en triompher, un jour, sans en être complètement sûr.

J’ai été épaté par l’excellence de la construction de ce roman, qui brouille les pistes et ne cible son vrai sujet qu’à sa moitié. Par la qualité de sa langue aussi, deuxième langue seulement de son auteur. Par l’intensité et l’actualité de son sujet. On comprend le choix de Chahdortt Djavann de le présenter sous la forme d’un roman, alors que c’est un cri de douleur et protestation, un témoignage, un livre militant pour la liberté et contre l’oppression religieuse. Seul le titre m’a dérouté, et d’ailleurs induit en erreur ; je pensais qu’il s’agissait d’un livre sur la langue française ou, au moins, sur le mode de vie français… Bien sûr, c’est une allusion à Montesquieu mais cela induit une sorte de malentendu sur le vrai sujet du livre.
À lire et à recommander !
07:30 Publié dans Djavann Chahdortt, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)
21/11/2016
"Comment peut-on être français ?" (Chahdortt Djavann) : critique I
C'est présenté comme un roman ou même un conte mais, vu le parcours de son auteur, Chahdortt Djavann, on ne peut pas s'empêcher d'y voir un peu ou beaucoup d'autobiographie.
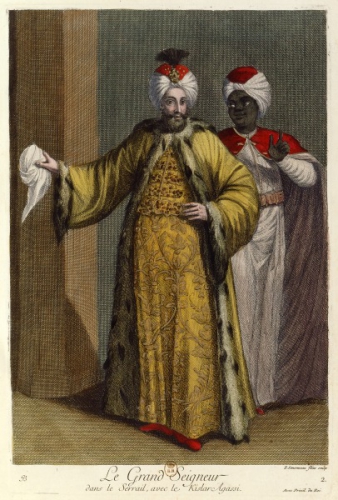 Comment peut-on être français ?" est l'histoire d'une jeune Iranienne, qui après avoir rêvé de Paris si longtemps franchit le pas et vient en France. Sa découverte de la Ville éternelle et de la vie des Français, ajoutée à l'obtention inespérée de sa carte de séjour sans délai, est un émerveillement.
Comment peut-on être français ?" est l'histoire d'une jeune Iranienne, qui après avoir rêvé de Paris si longtemps franchit le pas et vient en France. Sa découverte de la Ville éternelle et de la vie des Français, ajoutée à l'obtention inespérée de sa carte de séjour sans délai, est un émerveillement.
Elle ne connaissait Paris que par les livres : "dans les Misérables, Le Père Goriot, Les trois mousquetaires, Notre-Dame de Paris ou L'âme enchantée, qu'elle avait lus et relus pendant les longs après-midi chauds et humides de son adolescence" (page 12).
Mais bientôt viennent les désillusions, la solitude et surtout l'incapacité qu'elle croit culturelle et définitive de s'approprier la langue française, malgré un travail acharné, des cahiers et des cahiers noircis de mots à apprendre, des phrases psalmodiées matin et soir... trop de vocabulaire nouveau, trop de conjugaisons, trop d'exceptions et de bizarreries... Et plus que cela, le français est autant précis et exact que le farsi (le persan) est poétique et vague.
"Avec sa grammaire aux structures implacables, elle se prêtait extraordinairement à la démonstration, à l'analyse. Elle était la langue même de la littérature. Une langue maîtresse, une maîtresse, une traîtresse. Il fallait se plier aux exigences des articles, obéir à la grammaire" (page 120).
"C'est dans la langue que tout s'enracine, se disait-elle. Si les Français ne parlaient pas français, ils ne seraient pas des Français. Sa patrie à elle serait la langue. Cette patrie qui l'excluait, la bannissait. Cette patrie qui dénonçait sans pitié sa condition d'exilée" (page 72).
"Une langue n'existe que dans un lieu, dans un pays, dans le cœur et la bouche des gens qui l'a parlent, elle raconte l'histoire d'un peuple, traduit le monde où elle vit, dit la vie, la vie des gens" (page 114).
Au détour de la page 54, encore un coup de la synchronicité : rappelez-vous que mon billet littéraire précédent parlait d'André Gide et de sa "Porte étroite" ; et quel est le premier livre français que lit Roxane, la jeune Iranienne arrivée à Paris ? "La symphonie pastorale" !
C. Djavann intercale des souvenirs de l'enfance de Roxane dans les péripéties de son initiation laborieuse à la vie parisienne. Cette enfance a été baroque mais pas malheureuse. C'est plus tard que les raisons de partir vont devenir impérieuses.
À bout de patience et de souffrance, Roxane a l'idée folle de s'adresser à Montesquieu, auteur, comme chacun sait, des fameuses "Lettres persanes", en lui écrivant des lettres qu'elle envoie à des adresses réelles au nom des écrivains qu'elle est en train de lire (Molière, Voltaire, Hugo). Roxane en effet suit des cours de littérature française en Sorbonne. 
07:30 Publié dans Djavann Chahdortt, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)
14/11/2016
"La porte étroite" (André Gide) : critique II
On est loin du romanesque – ou alors c’est du roman psychologique – on est loin aussi d’un livre de souvenirs… c’est une œuvre classique, par son style aussi bien que par son thème : les tourments croisés de l’amour terrestre et de la foi religieuse. Et l’on pense à la « Symphonie pastorale » du même Gide (pour qui « La porte étroite » était le pendant de son « Immoraliste »), au « Lys dans la vallée » de Balzac, voire aux tragédies du XVIIème siècle et aux romans de Mme de La Fayette. Amateurs d’actions, de mystères, de rebondissements, et même de poésie, s’abstenir.
Ces « tempêtes sous un crâne » et même sous deux crânes, paraîtront bien désuètes et ne passionneront sans doute guère nombre de lecteurs d’aujourd’hui. C’était une époque où les jeunes filles cousaient et brodaient docilement au salon, se lassaient de fiançailles trop longues (si elles sont courtes, « cela permet de faire comprendre – oh ! discrètement – qu’il n’est plus nécessaire de chercher pour elles »), où l’on se fiançait ou plutôt où l’on était fiancé souvent sans pouvoir donner son avis, où correspondance et rapports entre les jeunes gens n’étaient acceptés que dans cette situation. Et, à cette époque, certains jeunes, exaltés, s’interdisaient le bonheur qui semblait à portée de leurs mains et semblaient s’adonner à ce que l’on appellerait aujourd’hui du masochisme, au nom de sentiments élevés et d’une haute exigence spirituelle. Tandis que d’autres, dociles, se soumettaient à la dictature des convenances et de la bonne éducation, refoulant leurs passions et leurs aspirations profondes. Ridicule, tout cela ? Peut-être. Dépassé ? sans aucun doute. Mais peut-on se réjouir de l’impatience, de la légèreté, de l’égoïsme modernes, à l’œuvre dans les mêmes circonstances ?

L’écriture classique et fluide de Gide n’exclut pas quelques bizarreries, comme par exemple cette phrase page 49 : « Déjà la plupart des champs étaient vides, où la vue plus inespérément s’étendait »… On peut dire à cette occasion que Gide était un passionné des adverbes. Ainsi, page 54 : « Et je me remémorais inquiètement nos paroles » et page 63 : « Elle était au fond du verger, cueillant au pied d’un mur les premiers chrysanthèmes qui mêlaient leur parfum à celui des feuilles mortes de la hêtraie. L’air était saturé d’automne. Le soleil ne tiédissait plus qu’à peine les espaliers, mais le ciel était orientalement pur », et encore page 65 : « Mais le sourire qui l’illuminait restait si sereinement beau… », page 73 « mes mains qu’elle pressa pathétiquement dans les siennes » et « Hum ? fit ma tante interrogativement »...
Rien que dans la moitié de la page 75, je trouve : précisément, tristement, clairement, doucement. La page 81 nous assène : fixement, confusément, violemment et immensément. À la page 82, c’est hostilement, anxieusement, furieusement. « Tout me paraît dérisoirement provisoire » (page 111). « Alissa était déplaisamment colorée » (page 116). Et encore « incurablement » (page 121). Mais, à vrai dire, ce qui surprend, c’est sa propension à inventer des adverbes comme « inquiètement » ou peut-être à en utiliser de peu connus.
Pour le reste la langue est belle et sure, usant de toutes les possibilités d’enchevêtrement et de circonvolution des phrases : « Il me plaisait que cette habitude quasi monacale me préservât d’un monde qui, du reste, m’attirait peu et qu’il m’eût suffi qu’Alissa pût craindre pour m’en apparaître haïssable aussitôt » (page 66). « Je ne pus retenir ma plainte, montrant du deuil de quel bonheur mon malheur d’aujourd’hui se formait » (page 141).
André Gide mène son récit vers son implacable dénouement avec virtuosité et on le quitte la gorge nouée.
Au terme de ce billet, je m’étonne d’avoir consacré autant de lignes à un récit lu cet été et que j’ai dû relire pour en retrouver mes impressions initiales. Je ne dirai rien de plus de ses rebondissements, des états d’âme de ses protagonistes ni bien sûr de son épilogue. « La porte étroite » traite avec subtilité et élégance des passions humaines éternelles et témoigne d’une époque révolue où l’on ne lésinait pas sur les principes (en tous cas, la trame du roman tourne autour d’eux, ceux de la société bourgeoise européenne de la fin du XIXème siècle, à l’exception près de l’infidélité de la sensuelle tante Lucile). Et ses personnages sont loin d’être ridicules ou antipathiques ; même si l’on ne comprend plus leurs choix, on les respecte, à un siècle de distance, et l’on n’est pas loin de les admirer, par comparaison.
« Elle passa ses mains sur son visage et il me parut qu’elle pleurait…
Une servante entra, qui apportait la lampe ».
07:30 Publié dans Écrivains, Gide André, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)



