29/05/2017
"Pourquoi je préfère rester chez moi" (Benoît Duteurtre) : critique II (les yéyés)
Le chapitre 4 du livre de Benoît Duteurtre, « Pourquoi je préfère rester chez moi », s’intitule « Les yéyés de la politique » et cache bien son jeu.
Ça commence comme au premier chapitre « On aura moins entendu souligner (NDLR : à l’occasion des Primaires de la Droite de 2016) que le progrès en question consistait, comme tant d’autres, à importer un usage des États-Unis. Ce n’est pas un choix, c’est un phénomène historique. Tout ce qui a commencé là-bas doit continuer ici, sous les applaudissements, comme un grand bon en avant. Cela concerne aussi bien les zones fumeurs, les lignes de confidentialité à ne pas franchir dans les administrations, les rubans de plastique rouge qu’on déploie sur les lieux des accidents, les plaintes pour harcèlement sexuel, la monnaie barrée de deux traits, la généralisation des autocars dans le transport urbain, le port de tennis et de survêtements en ville, les frigos à boissons fraîches dans les magasins, les sirènes de recul sur les poids lourds, le remplacement des képis par des casquettes sur le crâne des policiers (…). On ne dit jamais toutefois que c’est américain, mais seulement que c’est moderne » (page 44).

Avouez que c’est bien vu (je n’avais pas en tête l’exemple de la monnaie : €…). Avouons-nous que les Américains inventent toutes sortes de choses astucieuses ou d’évolutions souhaitables ; pas question à mon sens de les refuser en France (comme si on le pouvait…) au motif qu’elles seraient américaines ; mais je me suis toujours étonné qu’on ne négocie jamais rien en échange, à savoir leurs trouvailles contre les nôtres (Michel Jobert, reviens !). Par exemple, qu’est-ce qu’on attend pour exiger des Américains qu’ils adoptent le système métrique, deux siècles après notre Révolution ?
Et Benoît Duteurtre d’ajouter à propos des primaires : « (Quelques observateurs animés de sens critique) se seront inquiétés de voir appliquer aux élections les lois de la consommation, invitant les électeurs à faire leur marché parmi un éventail de personnalités plus ou moins aguichantes… pour finalement retrouver la réalité immuable du néo-libéralisme. Encore une étape et la gauche n’aurait plus qu’à se rebaptiser démocrate, tout comme la droite venait de se rebaptiser républicaine » (page 45).
Son analyse de la fameuse « recomposition politique » me semble pertinente, de même que celle de la construction européenne depuis De Gaulle, de même que l’accélération de l’emprise du soft power dans notre pays permise par internet, Facebook, Twitter and co. « Ainsi se généralise une vision du monde à deux vitesses : une culture internationale produite aux États-Unis et une actualité locale qui réduit chaque pays au rang de province » (page 49). Et il cite Michel Lancelot, fan à la fois de l’Amérique et de la chanson française, qui constatait que l’Europe suivait systématiquement ce qui se passait là-bas, à vingt ans de distance. Cet écart s’est sans aucun doute réduit. Mais qui sait si d’autres forces tout aussi redoutables ne sont pas en train de transformer la France de façon moins visible et peut-être moins sympathique (l’influence chinoise, nouveau géant, ou l’influence de l’Islam) ?
 Puis Benoît Duteurtre aborde un sujet très différent et en apparence moins sérieux mais qui lui tient à cœur, à lui comme à nous : la chanson française. « Johnny, contrairement à Piaf, Chevalier (NDLR : bof…) ou Trenet, n’a pas apporté à la chanson française un rayonnement mondial. Quasi inconnu au-delà des frontières, il impressionne par son engagement physique et peut ensorceler par sa voix… mais il suscite le sourire pour cette vie entière consacrée à l’imitation du rock’n’roll (…). La chanson française, pourtant, continuait son cheminement poétique. En ces mêmes années 60, Brassens, Brel ou Adamo (NDLR : bof…) connaissaient d’immenses succès populaires, en Italie, en Allemagne ou au Japon » (pages 50 et 51). On ne saurait mieux dire. Et pour lui, nos hommes politiques sont comme des yéyés de droite et de gauche, des imitateurs fascinés de l’Amérique des cow-boys.
Puis Benoît Duteurtre aborde un sujet très différent et en apparence moins sérieux mais qui lui tient à cœur, à lui comme à nous : la chanson française. « Johnny, contrairement à Piaf, Chevalier (NDLR : bof…) ou Trenet, n’a pas apporté à la chanson française un rayonnement mondial. Quasi inconnu au-delà des frontières, il impressionne par son engagement physique et peut ensorceler par sa voix… mais il suscite le sourire pour cette vie entière consacrée à l’imitation du rock’n’roll (…). La chanson française, pourtant, continuait son cheminement poétique. En ces mêmes années 60, Brassens, Brel ou Adamo (NDLR : bof…) connaissaient d’immenses succès populaires, en Italie, en Allemagne ou au Japon » (pages 50 et 51). On ne saurait mieux dire. Et pour lui, nos hommes politiques sont comme des yéyés de droite et de gauche, des imitateurs fascinés de l’Amérique des cow-boys.
Tout cela continue de plus belle…
Encore récemment (le 17 mai 2017 matin pour être précis), France Inter nous chantait le couplet, habituel à pareille époque, sur le Festival de Cannes, la montée des marches et l’importance culturelle de cette événement sur la Croisette. Et bien plus car cette année, c’est le 74ème anniversaire du « plus grand festival de cinéma du monde » et on va faire une photo historique avec tous ses acteurs les plus marquants… Vous vous prenez à rêver ; on va réunir Sophia Loren, Luchino Visconti, Ettore Scola, Jean-Louis Trintignant, Sergio Leone, les lauréats de la Palme d’Or et les Présidents du Jury danois, polonais, suédois, etc. Et peut-être même qu’on verra sur la photo Monica Bellucci et Sophie Marceau ! Eh bien non ! Mille fois non ! Dans son reportage enamouré, la journaliste ne nous nommera que des représentants du cinéma américain, du modèle américain et donc mondial, de la culture (!) dominante ! Oui, rien que des Américains !
07:30 Publié dans Actualité et langue française, Duteurtre Benoît, Écrivains, Essais, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (2)
15/05/2017
"Pourquoi je préfère rester chez moi" (Benoît Duteurtre) : critique I (la langue du Brexit)
Mes lecteurs les plus fidèles se souviennent qu’en septembre 2015 (le 2 très précisément), j’avais commenté le livre de Benoît Duteurtre intitulé « L’été 76 », qui racontait ses années d’adolescence pendant les Trente Glorieuses. J’y avais trouvé plusieurs résonances avec mon histoire et mes goûts (les Vosges, Giono, Verne et Lupin, Pink Floyd…) et avais néanmoins conclu sur une sorte de « peut mieux faire ». À la fin du livre Benoît Duteurtre devenait critique musical…
Pas mal de livres plus tard, on le retrouve dans « Pourquoi je préfère rester chez moi » (Fayard, 2017), paru en pleine campagne électorale présidentielle française. Voulue ou non, l’incitation à déserter les isoloirs était troublante. C’est Jack Dion, dans le Marianne du 17 mars 2017, qui m’a donné envie de lire ce livre : il avait fort bien rendu compte des « irritations » de l’auteur et résumé son avis d’une formule percutante « À force de cultiver son jardin, comme Candide, Benoît Duteurtre a fini par avoir un dégoût très sûr ».
En avant donc pour découvrir ce coup de gueule, un peu de nostalgie, de résistance et d’anticonformisme, ça ne fait pas de mal. « Il est possible que je m’attache trop à des plaisirs disparus, voire à l’idée que certaines choses étaient mieux avant. Je n’ai pourtant rien contre la notion de progrès, et je suppose que notre époque en apporte beaucoup, dont d’autres se chargent de faire l’apologie… Quant à moi, en rassemblant ces diverses polémiques, j’ai voulu épingler certaines réformes qui ne rendent pas le monde meilleur, des évolutions fâcheuses qui n’étaient pas toujours inéluctables. Cherchant à peser, à chaque bond en avant, ce que nous gagnons et ce que nous perdons, je me livre à une critique de la vie quotidienne qui voudrait au moins inviter à réfléchir. Voici donc, en ce sens, un livre de combat » (Avant-propos, page 11).
« Dès l'aérogare
J'ai senti le choc
Un souffle barbare
Un remous hard-rock »
Eh oui, dès le chapitre 2, Benoît Duteurtre nous prend par les sentiments et sonne la charge dans « La langue du pouvoir ». « Sur un ton enjoué, l’animateur (de Fun Radio…) enjoignait ses auditeurs adolescents de raconter leur life – concept visiblement plus style que celui de vie. Après chaque chanson, une publicité les invitait à découvrir un nouveau dance floor » (page 15). Page 18, il nous apprend qu’un débat du 15 mai 2014 sur Euronews (société française…) rassemblait quatre dirigeants européens parlant impeccablement allemand et, pour trois d’entre eux, également français. Ces deux langues, comme chacun le sait et fait tout pour l’oublier, sont les plus parlées en Europe, sont celles des pays fondateurs et sont deux langues de travail officielles. « Pourtant, ce débat européen allait se dérouler entièrement en anglais, sous la houlette d’un journaliste américain et d’une journaliste britannique (…) Certes, l’anglais est la langue étrangère partagée par le plus grand nombre d’Européens. Les vrais anglophones n’en restent pas moins très minoritaires, sauf aux Pays-Bas et en Scandinavie (…). Quant au pragmatisme, régulièrement invoqué, la discussion aurait donc pu se dérouler en allemand, commun à tous les participants, et se voir traduite dans chaque pays (y compris en anglais pour les Britanniques et les Irlandais du Sud !) ; elle aurait pu également mêler le français et l’allemand, ce qui aurait illustré la diversité linguistique du continent. Loin d’accomplir ce choix pratique, la chaîne Euronews et les candidats ont effectué un acte militant visant à nous dire : l’Europe possède une langue commune qui est l’anglais ». Tout le reste du chapitre pourrait être cité : l’organisation du débat derrière des pupitres, à l’américaine, pour laisser entendre « L’Europe est une grande puissance, à l’image des États-Unis » ; le refrain mille fois entendu, incantatoire : « la grandeur de l’Europe, la singularité de l’Europe, la puissance de l’Europe, l’influence de l’Europe, la voix de l’Europe » ; le bourrage de crâne sur la nécessité d’être plus grand, plus gros, plus vaste pour « peser » : « mais cet argument de communication recouvre souvent, pour le citoyen, une réalité tout autre : celle de la fusion-acquisition et des économies d’échelle ».
Benoît Duteurtre fait remarquer que toutes les grandes puissances, auxquelles l’Union européenne prétend se mesurer, s’expriment et s’administrent dans leur propre langue (la Chine en mandarin, la Russie en russe et les États-Unis en anglais) ; l’Europe est la seule à s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne, « la langue du plus lointain de ses partenaires : le Royaume-Uni, entré dans l’Union sur la pointe des pieds, avant d’en ressortir quarante ans plus tard. Les Britanniques ont d’ailleurs usé de ce pouvoir inespéré pour exercer leur influence à Bruxelles où ils sont devenus les maîtres du langage ». Ils y auraient par ailleurs trouvé un avantage financier de plusieurs dizaines de milliards d’euros selon le rapport du professeur François Grin sur « L’enseignement des langues étrangères comme politique publique » (page 26).
« Mais l’anglais de l’Union européenne est surtout ce sabir mondial des affaires qui prétend s’imposer partout comme seul mode d’échange. En le choisissant comme véhicule de son administration, l’Union renonce à son identité politique et culturelle pour nous dire ce qu’elle est : une colonie pilote, un chantier de la mondialisation débarrassé des pesanteurs nationales ».
Il rappelle ce que disait Umberto Eco : la traduction doit devenir la langue de l’Europe !
« L’Europe n’est-elle qu’un regroupement de provinces unifiées par l’anglais, l’économie de marché, les forces de l’OTAN et la protection américaine ? » (page 23).
Après le choix anglais du Brexit (anglais et non écossais… choix et non encore réalité…), l’abandon de l’anglais comme langue officielle s’impose ! Il paraît que l’excellent J.-C. Juncker aurait décidé de ne plus utiliser que l’allemand et le français dans ses discours officiels… Veut-il se faire pardonner les accommodements fiscaux du Luxembourg avec les multinationales américaines sous son mandat de Premier Ministre ? En même temps (comme dit l’autre), il paraît que certains voudraient profiter du Brexit pour renforcer le statut de l’anglais, devenu une langue « neutre » (non nationale), de façon à devenir vraiment les États-Unis d’Europe, à l’image de ceux d’Amérique… Au fou ! Il faut au contraire s’en protéger ! Il paraît que le commandement dans les bataillons franco-allemands se fait en anglais ! Halte au feu !
« La domination d’une langue est en effet davantage qu’un choix pratique. Elle impose une façon de parler mais aussi de penser. On le voit à l’occasion des négociations sur les traités commerciaux, au cours desquels la référence anglaise contraint les négociateurs, français ou italiens, à se fondre dans la syntaxe et les habitudes juridiques de leurs interlocuteurs, qui en tirent un avantage stratégique évident ».
À la fin du chapitre, Benoît Duteurtre se penche sur les aspects pratiques de l’anglomanie et particulièrement sur ses effets chez les jeunes. Il craint par exemple qu’un jour ils ne finissent « par écrire « ediot » à la place d’idiot » (page 27). Il note que, pendant les Printemps arabes (mais où est donc passé le Printemps ?), les journalistes français interrogeaient systématiquement des anglophones, en Égypte et ailleurs, les forçant par la même à utiliser une langue qui n’est pas la leur. Et idem en Ukraine.
J’aime sa conclusion. À la question de savoir s’il faut « tout accepter, sans états d’âme et s’exprimer avec cent mots venus d’Amérique » ou « obstinément, tenter d’ouvrir les yeux », il donne sa réponse : « savoir que nous ne pouvons rien apporter au présent que des inflexions minuscules mais aussi que cet effort traduit, du moins, notre désir de vivre dans un monde divers, attaché à toutes les richesses de son histoire ».
Bravo, M. Dutertre !
07:30 Publié dans Actualité et langue française, Duteurtre Benoît, Écrivains, Essais, Francophonie, Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (0)
11/05/2017
"Un été à Lesmona" (Marga Berck) : critique
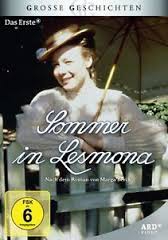 Marga Berck – de son vrai nom Magdalena Pauli – est une jeune Allemande de la fin du XIXème siècle. Nous sommes en 1893. C’est l’époque du début des souvenirs de Stefan Zweig, « Le monde d’hier », dont j’ai promis de vous rendre compte un jour, une époque qui a la réputation d’avoir été « la belle époque ». Marga vit dans une famille aisée de la grande bourgeoisie, qui se déplace d’une résidence à l’autre (dont la maison de vacances à Lesmona) et fréquente des amis et des parents du même monde. Elle a dix-sept ans, des parents aimants mais qui l’éduquent comme on le faisait alors ; c’est dire qu’elle est chaperonnée et priée de respecter les codes de la bonne société. Seul îlot de liberté et de sincérité totale, son amitié avec « sa chère et unique Bertha ». Elles échangent inlassablement par lettre et se disent tout. Leur courrier de juin 1893 à mars 1896 fait l’objet de ce roman autobiographique, « Sommer in Lesmona ». Je ne vous dis pas pourquoi la correspondance s’arrête alors ; l’important est qu’il s’agit d’une part d’une histoire vraie (et malheureusement la réalité qui suivra ces années heureuses dépassera la fiction) et d’autre part d’un genre littéraire peu courant : le roman par lettres. J’ai appris à cette occasion qu’il était considéré en Allemagne comme un classique. Resté inédit pendant un demi-siècle, il a été édité seulement en 1951 sans la moindre retouche, par la vieille dame qu’était devenue Marga (on pense à la forme narrative du beau roman de Leslie Hartley, « Le messager », magnifiquement transposé au cinéma par Joseph Losey et son inoubliable Julie Christie) et traduit en 1994 seulement sous le titre « Un été à Lesmona ».
Marga Berck – de son vrai nom Magdalena Pauli – est une jeune Allemande de la fin du XIXème siècle. Nous sommes en 1893. C’est l’époque du début des souvenirs de Stefan Zweig, « Le monde d’hier », dont j’ai promis de vous rendre compte un jour, une époque qui a la réputation d’avoir été « la belle époque ». Marga vit dans une famille aisée de la grande bourgeoisie, qui se déplace d’une résidence à l’autre (dont la maison de vacances à Lesmona) et fréquente des amis et des parents du même monde. Elle a dix-sept ans, des parents aimants mais qui l’éduquent comme on le faisait alors ; c’est dire qu’elle est chaperonnée et priée de respecter les codes de la bonne société. Seul îlot de liberté et de sincérité totale, son amitié avec « sa chère et unique Bertha ». Elles échangent inlassablement par lettre et se disent tout. Leur courrier de juin 1893 à mars 1896 fait l’objet de ce roman autobiographique, « Sommer in Lesmona ». Je ne vous dis pas pourquoi la correspondance s’arrête alors ; l’important est qu’il s’agit d’une part d’une histoire vraie (et malheureusement la réalité qui suivra ces années heureuses dépassera la fiction) et d’autre part d’un genre littéraire peu courant : le roman par lettres. J’ai appris à cette occasion qu’il était considéré en Allemagne comme un classique. Resté inédit pendant un demi-siècle, il a été édité seulement en 1951 sans la moindre retouche, par la vieille dame qu’était devenue Marga (on pense à la forme narrative du beau roman de Leslie Hartley, « Le messager », magnifiquement transposé au cinéma par Joseph Losey et son inoubliable Julie Christie) et traduit en 1994 seulement sous le titre « Un été à Lesmona ».
Mais on n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans… et à quoi donc rêvent les jeunes filles ? À l’amour fou bien sûr et au chevalier qui viendra les enlever. Le drame de Marga, c’est qu’elle va en rencontrer deux, à peu près au même moment, après avoir éconduit pas mal de soupirants, deux hommes fort différents entre lesquels son cœur va balancer longtemps au gré des séparations et des retrouvailles. L’un des élus, Rudi, est impressionnant, cultivé, froid, secret. L’autre, Percy, est brillant, artiste, merveilleux danseur, passionné… C’est un scénario effectivement « classique » mais il est traité avec simplicité, spontanéité et force par la narratrice à travers ses lettres. Devinez qui va choisir Marga ?

On est ému par cette histoire qui nous rappelle aussi « La porte étroite » d’André Gide (j’en ai rendu compte dans ce blogue) et « Tess d’Urberville » de Thomas Hardy. Mais l’histoire autour de l’histoire est tout aussi émouvante : imaginez-vous que le grand Thomas Mann, celui de « La montagne magique », s’enthousiasme pour le roman de Mme Pauli à sa sortie et lui écrit. Leur échange a été publié et la fille de Thomas Mann enverra à Magdalena un exemplaire de sa « Correspondance » en 1966. Le grand écrivain voit dans ce roman, non seulement une charmante et sincère composition autour des amours adolescentes mais aussi « une part de critique (inconsciente) de la société », et il y retrouve son propre combat contre les préjugés bourgeois. Il conclut sa première lettre par un questionnement sur la suite, sur ce que sont devenus les protagonistes. Dans sa réponse Marga raconte les épreuves épouvantables qu’elle a dû surmonter (je laisse mes lecteurs les découvrir la gorge serrée dans les annexes au roman) et, étonnamment (mais est-ce vraiment étonnant ?), écarte toute idée de rancune envers ses parents : « Mes parents m’ont portée à bout de bras tout au cours de mon existence. Les erreurs qu’ils ont pu commettre pendant mes années de jeunesse, ces erreurs sont liées à l’esprit de l’époque ». Elle confie que, au final, tout est bien. Le jeu de miroirs continue : son mari avait rencontré Thomas Mann dans l’entre-deux guerres et lui avait lu et commenté « La montagne magique ».

Pour toutes ces raisons, le petit livre de Marga Berck est un enchantement – et la préface de l’éditeur Phébus, qui signe modestement de ses initiales, J.P.S, tout autant –. Il vous tient du début à la fin dans les intermittences du cœur d’une jeune fille d’il y a si longtemps et on a envie de le garder pour le relire un jour de mélancolie…
09:36 Publié dans Berck Marga, Écrivains, Littérature, Livre, Roman | Lien permanent | Commentaires (0)



